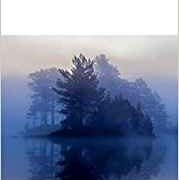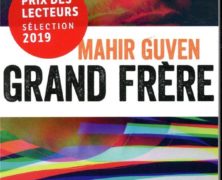Huis clos, suspense, récits alternés, rebondissements… L’anniversaire de Imma Monso est indubitablement un thriller haletant, mais pas seulement. C’est aussi un roman qui analyse avec finesse les rapports de couple et les liens entre réalité et fiction. Ils sont ensemble depuis plus de vingt-cinq et les enfants ont quitté la maison quand la crise éclate. Elle ne le supporte plus, ils ne se comprennent pas et achoppent sur chaque mot, chaque expression. Parce qu’ils ne veulent pas se séparer mais que toute discussion tourne à l’affrontement, elle propose qu’ils ne se parlent plus et communiquent seulement par écrit. Après trois semaines de cohabitation silencieuse, il lui adresse un message énigmatique : « Nous fêterons l’anniversaire en dehors de la maison, loin. Nous partirons à neuf heures. » Quel anniversaire? Dans quel lieu? Avec quel cadeau? Etonnée, agréablement surprise par son mari qu’elle a toujours trouvé « prévisible comme une pendule », Raquel s’embarque avec curiosité dans ce voyage (et le lecteur aussi). Mais l’aventure enthousiasmante devient peu à peu angoissante lorsque Mateu révèle à sa femme l’inquiétant cadeau qu’il a préparé pour elle. Tous deux se retrouvent alors prisonniers dans le huis clos de la voiture et Raquel découvre une facette de son mari qu’elle ne connaissait pas. Cet homme pragmatique, concret et maladroit, capable d’élaborer un scénario terriblement précis et glaçant, qui est-il vraiment? Un sadique? Un psychopathe? Ou, simplement, un mari qui cherche à reconquérir sa femme et à obtenir son admiration? Un enfant blessé? « En vérité, cet étranger n’est pas vraiment « lui ». Tout au moins, il n’est pas l’homme qu’elle connait depuis plus de vingt-cinq ans. » Au cours des chapitres, l’auteure fait alterner le récit du voyage d’anniversaire et celui de l’enfance de Mateu qui éclaire peu à peu sa personnalité. Enfant solitaire, délaissé par ses parents très occupés, il partageait ses loisirs avec Guillem, un ami étrange, passionné de lecture. Sous la direction de ce dernier, les deux garçons apprenaient, reconstituaient et revivaient jusqu’à l’obsession des scènes de Moby Dick. Mais une catastrophe les sépare et laisse Mateu marqué à jamais par ce traumatisme, hanté par la culpabilité et la défiance à l’égard des mots. Pour ne plus souffrir, il refuse alors toute lecture de fiction, toute expression artistique, choisit des études scientifiques et s’applique à ne voir que la simple réalité. A l’opposé de son mari, Raquel est habitée par le langage et se réfugie dans l’imaginaire : elle a la curieuse habitude d’inventer mentalement des phrases de poème et de les traduire. C’est justement cette différence qui a séduit Mateu, Raquel lui a rappelé Guillem, son goût pour les jeux avec les mots : « Mateu se sentit délicieusement complété et illuminé par cette femme qui le ramenait dix ans en arrière ». Raquel a été rassurée par Guillem : « Tout en toi était propre, ordonné, et transparent…tout ce dont j’avais alors un grand besoin… » Aventure singulière mais aussi symbolique que celle de ces deux personnages: le plus souvent désignés par les pronoms « il » et « elle », Raquel et Mateu deviennent emblématiques de tous les couples « usé(s) par la routine du quotidien qui rend tout invisible et inaudible ». Malgré les années passées ensemble, ils s’aperçoivent qu’une part de l’autre échappe, cette part qui vient du plus profond de l’enfance et que chacun a voulu oublier. La troublante mise en scène élaborée par Mateu pose aussi la question de la réalité et de la fiction. Peut-on vivre un livre? La « réalité objective » existe-t-elle? Qu’est-ce qui différencie le mensonge de la fiction? « Dans la fiction, on participe d’une convention établie et dans le mensonge il n’y a pas de consensus: c’est une tyrannie unilatérale. » explique Raquel. Mais parfois la réalité semble moins crédible que la fiction et les frontières sont brouillées. Avec son écriture limpide, sa construction au cordeau, L’Anniversaire de Imma Monso surprend, inquiète et ravit le lecteur. L’Anniversaire, Imma Monso, traduit du catalan par Maria Vila Casas, Jacqueline...
La Montagne Magique, Thomas Mann
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lecture idéale pour temps de confinement que La Montagne magique, paru en 1924, le chef-d’œuvre de Thomas Mann, à la fois par sa taille et son sujet. On plonge dans cette somme de mille pages que son auteur mit plus de dix ans à écrire, à la fois roman de formation et réflexion sur le temps. Interminable et fascinant. Hans Castorp, jeune ingénieur allemand de vingt-quatre ans fraîchement diplômé, va passer trois semaines au Berghof, le sanatorium de Davos, en 1907, pour rendre visite à son cousin Joachim Ziemssen qui y soigne sa tuberculose. Et là, il découvre un autre monde : le « monde d’en haut » qui s’oppose au « pays plat », un monde différent, comme hors du temps. Peu à peu, il se laisse gagner, envoûter par le rythme lent et régulier de cette vie jusqu’à refuser de retourner dans la plaine. Il passe sept ans parmi « ceux d’en haut », sept ans de formation pendant lesquels il fait l’expérience de la maladie, de l’amour, de la mort et du temps suspendu. Au Berghof, Hans Castorp, « notre insignifiant héros » comme le nomme Thomas Mann, découvre des usages étonnants, un vocabulaire, des objets nouveaux (les confortables et ingénieuses chaises longues, les deux couvertures en poil de chameau et le sac de fourrure…) Comme dans un couvent retranché du monde, la vie s’y écoule avec ses rites quotidiens qui rythment la journée, (les cinq repas copieux, les cures de repos, les prises de température) ses grands messes (les conférences d’initiation à la psychanalyse, les concerts…) et ses grands prêtres (les médecins). Il s’intègre au groupe des malades, galerie de portraits, parfois presque des caricatures, venus de différents pays et milieux, sorte de société en miniature avec ses usages codés, sa hiérarchie – il y a la table des « Russes bien » et celle des « Russes ordinaires », même ici on ne se mélange pas! Parmi eux, quelques figures se distinguent et particulièrement les deux mentors antagonistes qui se disputent son éducation et s’affrontent dans de longues joutes verbales : Settembrini, l’italien beau parleur, franc-maçon humaniste et Naphta, le jésuite fanatique, obscurantiste inquiétant. Et puis, au trois quart du livre, après de longs développements philosophiques, comme si l’auteur voulait réveiller l’attention du lecteur, surgit un nouveau personnage, fascinant, grandiose, charismatique : Mynheer Peeperkorn, un riche commerçant hollandais accompagné de son valet de chambre malais, sorte de dieu païen qui lui donne une dernière leçon de vie. L’autre figure majeure est celle de Claudia Chauchat, la jeune russe dont il tombe instantanément et désespérément amoureux. Fasciné par les pommettes saillantes et les yeux bleu gris de la jeune femme, ces yeux de « loups des steppes » qui lui rappellent ceux de Pribislav Hippe, son camarade de collège. A l’intérieur du sanatorium, la mort, pourtant fréquente, se fait discrète, presque habituelle et banale ; elle emporte les jeunes filles malades que le médecin appelle ses « petits pinsons poitrinaires ». Seul signe visible « une chambre « abandonnée », une chambre devenue libre, une chambre que l’on désinfecte. » Elle devient présente et prégnante quand le narrateur décrit et accompagne les derniers moments de l’un de ses protagonistes. En vingt-quatre heures, la maladie fait du jeune homme un vieillard : « il franchissait au galop les âges qu’il ne lui était pas accordé d’atteindre dans le temps. » Curieusement, pour Hans Castorp, la prise de conscience de sa finitude passe par la radiographie : lorsqu’il voit l’image de sa main « (il) vit ce qu’il n’aurait jamais dû s’attendre à voir, mais ce qui, en somme, n’est pas fait pour être vu par l’homme, et ce qu’il n‘avait jamais pensé qu’il fût appelé à voir; il regarda dans sa propre tombe (…) et, pour la première fois de sa vie, il comprit qu’il mourrait. » Mais surtout, même si la maladie et la mort rôdent à chaque moment, il semble que le but de Thomas Mann ait été d’écrire un roman sur le temps, comme il le...
Journal, Sandor Marai
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De 1943 à sa mort en 1989, le grand écrivain Sandor Marai tient son Journal, dont de larges extraits sont aujourd’hui publiés en français. Ce premier tome, intitulé Les années hongroises 1943-1948, couvre la période de la guerre, de l’occupation allemande à l’occupation soviétique. Passionnant. Durant ces cinq « années hongroises », que l’on pourrait aussi nommer années tragiques ou décisives, Sandor Marai est au cœur des grands drames du XX° siècle. Dans la capitale et à la campagne, il vit l’occupation nazie, la déportation des Juifs (dont son beau-père), les bombardements alliés, le siège de Budapest, la libération par l’armée rouge et la prise de pouvoir des communistes. Son beau-père est déporté, son appartement détruit par les bombes, sa maison de campagne réquisitionnée pour loger seize soldats de l’armée soviétique (plutôt sympathiques ces jeunes Russes admiratifs de l’écrivain). Ecoeuré par le nouveau régime, par la nationalisation des esprits et la confiscation des libertés, attaqué par la presse communiste, l’écrivain bourgeois (comme il aime à se qualifier) fuit ce pays dans lequel il n’a plus sa place. Il s’exile, la mort dans l’âme, et part vers la Suisse et l’Italie n’emportant que cinq livres dont L’Odyssée (lui qui possédait avant les bombardements une bibliothèque de plus de cinq mille livres.) Quitter la Hongrie est pour lui la seule manière de continuer à faire vivre la langue et la littérature hongroise. Ce qui surprend dès les premières pages, c’est la forme originale de ce journal sans indications de dates. Constitué de paragraphes séparés par un trait, l’ouvrage est fait de notations plus ou moins brèves, de réflexions (entre Choses vues de Victor Hugo et Maximes de La Rochefoucauld), parfois de micro-récits, presque des nouvelles avec chute. Ce qui étonne aussi c’est l’humour dont fait preuve l’auteur (humour...
Mon Nouveau Testament, Simone
écrit par Marie-Odile Sauvajon
C’est un petit livre étrange, découvert par hasard. Petit par son format et son nombre de pages. Etrange par son titre et le nom de son auteure. Après quelques recherches, on apprend vite que « Simone » est en fait le pseudonyme de Pauline Benda, actrice et femme de lettres du siècle passé. A quatre-vingt-treize ans, elle écrit ce dernier livre, Mon Nouveau Testament, confession autobiographique sur son parcours de vie et ses croyances. Issue de la bourgeoisie juive parisienne, Pauline Benda est marquée très jeune par la mort de son père. Sa foi est ensuite ébranlée sous l’influence de son frère aîné, étudiant en philosophie. Elle entreprend des études à la Sorbonne, suit les cours de psychologie expérimentale de Théodule Ribot au Collège de France et les expériences de ce dernier sur les malades à la Salpêtrière et à Sainte-Anne. Au grand dam de sa mère, qui exige que sa fille mette fin à ses visites à l’hôpital et suive des cours de diction… si bien qu’elle devient actrice et épouse son professeur de diction. Mais le grand amour de sa vie est Alain-Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes de dix ans son cadet avec lequel elle vit à partir de 1913 une brève liaison passionnée (1); le jeune officier meurt prématurément en septembre 1914. Revenant sur les événements qui ont marqué sa vie, elle raconte dans son ultime ouvrage comment la mort brutale des deux hommes qu’elle a le plus aimés et l’importance de la science et de la raison l’ont éloignée de la religion. Même si ne plus croire en un au-delà veut dire se résigner à ne jamais retrouver les êtres chers disparus, elle refuse les fausses consolations : « Je ne me rappelle pas être jamais retournée au pays où tout est possible,...
Kaputt, Malaparte
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Témoin privilégié, spectateur désabusé, Curzio Malaparte raconte dans un roman terrible et magnifique ce qu’il a vu entre 1941 et 1943 sur le front de l’Est. Paru en 1944, controversé et trop oublié, Kaputt est le premier roman sur la seconde guerre mondiale et l’un des plus grands, « un livre horriblement cruel et gai » selon son auteur. L’histoire du manuscrit est à elle seule un roman : commencé en Roumanie, caché par un paysan, confié à un diplomate espagnol. Objet de polémique dès sa réception, le livre souffre sans doute de la réputation de son auteur mégalomane, brièvement partisan de Mussolini avant de critiquer le régime. Le titre Kaputt donne le ton « Aucun mot (…) ne saurait mieux indiquer ce que nous sommes, ce qu’est l’Europe, dorénavant : un amoncellement de débris. » Les titres de chaque partie « Les chevaux, Les rats, Les chiens, Les rennes » disent la déshumanisation, la barbarie à l’oeuvre. Partout, le froid, la faim, la mort et surtout le cynisme, la bonne conscience des bourreaux, l’entreprise rationnelle d’extermination. Dans ce roman qui raconte l’horreur et la cruauté de la guerre, il y a cependant encore place pour la beauté des choses. Admirateur de Chateaubriand dont il dit s’inspirer, Malaparte tient aussi de Proust pour les descriptions somptueuses. Un chapitre s’intitule d’ailleurs « Du côté de Guermantes ». Dans une langue virtuose et souvent métaphorique, il transfigure le champ de bataille en gravure de Dürer : «Les chars et les troupes d’assaut avançant dans les sillons tracés par les chenilles semblaient gravés au burin sur la plaque de cuivre de la plaine ». En esthète, Il évoque les notes pures et légères d’un prélude de Chopin écouté par les dignitaires nazis ou le rouge sanglant d’un vin de Bourgogne qui rappelle, dans la nuit blanche...
Le Hussard sur le toit, Giono
écrit par Marie-Odile Sauvajon
En Italie, l’épidémie de coronavirus a fait grimper les ventes de La Peste de Camus. D’un mal peut -il sortir un bien, un classique comme antidote en temps de crise sanitaire? Mais à Oran et aux rats, au docteur Rieux et à Tarroux, on peut préférer Angelo et la Provence de Giono. Les deux romans paraissent aux lendemains de la seconde guerre mondiale, l’un en 1947, l’autre en 1951 et donnent du nazisme, du Mal en général la même représentation métaphorique : celle de la maladie contagieuse, de l’épidémie redoutée. Mais là où Camus illustre, à travers ces personnages prisonniers dans la ville, les différentes réactions humaines face au malheur collectif (courage, solidarité, opportunisme, égoïsme, mysticisme…), Giono nous entraine dans une folle aventure faite d’héroïsme, de joie de vivre insolente et de légèreté. Angelo Pardi, le colonel des hussards, le carbonaro piémontais en fuite qui traverse la Provence, c’est tout cela à la fois : quelqu’un qui n’hésite pas à soigner les malades, à laver les cadavres mais qui garde toujours la tête haute, l’allure, la grâce, tel « un épi d’or sur un cheval noir ». Son remède contre la contagion? Ne pas avoir peur, mépriser la maladie. Il est dans la mêlée mais il la domine puisqu’il gambade sur les toits de Manosque et il lui échappe en galopant de collines en villages. On en arrive à ce paradoxe curieux : même si Giono décrit avec précision (et invention) les symptômes de la maladie, le détail des agonies, même si l’on découvre des villages abandonnés, des régions dévastés, Le Hussard reste un livre alerte et presque joyeux, irrigué par la jeunesse et l’énergie de son héros. Et par la beauté lumineuse de Pauline de Théus. Car c’est aussi une grande histoire d’amour, même si les deux protagonistes ne se rencontrent qu’au bout de deux cents pages et que leur relation reste idéale. Jamais sordide, toujours sublime. Peut-on choisir entre la peste et le choléra? Lisez (ou relisez) Le Hussard sur le toit. Le Hussard sur le toit, Jean Giono, 1951, Folio, 512 pages. La Peste, Albert Camus, 1947, Folio, 416...
Par les routes, Sylvain Prudhomme
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Roman fluide et prenant, Par les routes de Sylvain Prudhomme évoque, à travers l’histoire croisée de deux amis, la multiplicité des possibles et les aspirations contraires. Sacha, écrivain parisien, la quarantaine, décide de tout quitter. « Envie de table rase. De concentration. De calme. » Il vide ses placards et ses étagères, part avec deux sacs de livres et de vêtements dans un meublé à V., petite ville du Sud-Est de la France. « En route pour la vie que je voulais. Ramassée. Sobre. Dense. » Mais il y retrouve par hasard un ancien ami perdu de vue depuis depuis dix-sept ans. Apparemment installé – une femme, un enfant, une maison (en location) – celui qu’il nomme « l’autostoppeur » est régulièrement pris de l’envie de partir à travers la France en auto-stop. Au cours de ses voyages, de ses échappées, il envoie des cartes postales et des polaroïds, portraits des automobilistes qu’il a rencontrés. Peu à peu, les liens se tissent entre Sacha et la famille de son ami, sa femme Marie, son fils Agustin; Sacha devient de plus en plus présent, l’autostoppeur, de plus en plus absent; il s’éloigne jusqu’à disparaître. Le propos du livre est cependant moins de raconter une histoire d’amour qu’une histoire d’amitié, on pourrait presque dire de gémellité. Sacha et l’autostoppeur, celui qui reste et celui qui part, sont à la fois proches et opposés. Leurs désirs semblent contraires mais dans les deux cas il s’agit de liberté, d’indépendance, de solitude et de rencontres nouvelles. On peut même parfois se demander, puisque l’auto-stoppeur n’est jamais nommé, s’ils ne sont pas au fond qu’un seul et même personnage, incarnant les facettes contradictoires d’un même individu. Comme dans le Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, cet ami ne serait-il qu’un double « une figure de sa jeunesse, de...
La Mer à l’envers, Marie Darrieussecq
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Marie Darrieussecq a le don d’être en résonance avec les sujets d’actualité et de nourrir ses romans de son expérience. Son dernier roman, La Mer à l’envers, croise ainsi l’itinéraire d’un migrant nigérien et l’histoire d’une femme au tournant de sa vie. Partie en croisière sur la Méditerranée avec ses deux jeunes enfants, Rose, quadragénaire en pleine crise conjugale, fait une rencontre qui la bouleverse. Le 24 décembre, quand l’énorme paquebot recueille des migrants naufragés d’un petit chalutier, son regard croise celui de Younès, un adolescent nigérien. Et c’est une reconnaissance immédiate : « Si j’adoptais un enfant, ce serait lui. » Elle lui donne des vêtements, le portable de son fils. Les migrants débarquent en Italie, la croisière continue. Alors qu’elle est revenue à Paris, Rose reçoit un appel de Younès sur son portable. D’abord, elle ne répond pas, elle fuit, elle élude, elle hésite. Quelques mois plus tard, alors qu’elle a déménagé avec sa famille dans le Pays Basque, nouveau coup de fil : Il est blessé, épuisé. Elle part à Calais, le ramène, l’installe dans la chambre d’ami, le nourrit, le soigne. Le jeune migrant noir serait-il en train de devenir un nouveau personnage de roman? On pense aussi à Arcadie d’Emmanuelle Bayamack-Tam, à L’Archipel du chien de Philippe Claudel et à bien d’autres… Comme Vendredi, il est celui qui trouble, éblouit et remet en question. Mais Marie Darrieussecq n’écrit pas un livre sur les migrants et encore moins un livre à thèse. Dans La Mer à l’envers (que l’on peut entendre aussi comme la mère à l’envers) le personnage principal c’est Rose Goyenetche la « psychologue bizarre » qui soigne par imposition des mains, don qu’elle tient de sa grand-mère, la mère aimante et désarmée face à l’évolution de ses enfants, la quadragénaire qui...
Souvenirs dormants, Modiano
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Un petit Modiano, mais un Modiano tout court. Quelques pages, quelques phrases, quelques mots simples et, dès la première ligne : « Un jour, sur les quais, le titre d’un livre a retenu mon attention », c’est tout un univers. Un univers fait de déambulations intimes dans Paris et dans le passé ( la collaboration, la guerre d’Algérie) avec un soupçon de roman noir (des personnages louches, un cadavre dans un appartement). Un univers peuplé de rencontres et de fantômes. Les souvenirs, en s’éloignant, se confondent avec l’imaginaire. Le narrateur tente de retrouver, cinquante ans après, les personnages et les lieux de sa jeunesse; l’écriture s’efforce de fixer, malgré la fuite du temps, les noms des disparus et leurs adresses. Cet univers est aussi le nôtre puisqu’il s’agit de souvenirs d’enfance et de l’histoire de France. N’avons-nous pas tous en nous des « souvenirs dormants » qu’un rien peut éveiller? « Après des dizaines d’années, ils remontent à la surface, comme des noyés, au détour d’une rue, à certaines heures de la journée. » Souvenirs dormants, Patrick Modiano, Folio, juillet 2019, 109...
Sous le volcan, Malcom Lowry
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Chef-d’oeuvre d’une modernité stupéfiante dans lequel on s’engouffre avec délice, et que l’on savoure chapitre après chapitre (l’idéal serait de le lire en douze jours, un chapitre par jour), Sous le volcan de Malcolm Lowry raconte la dernière journée de Geoffrey Firmin, consul de Grande-Bretagne à Quauhnahuac. Naufrage grandiose et pathétique d’un homme en proie à ses démons. Tout tient en une journée (ou plutôt en deux puisque le premier chapitre rappelle cette journée exactement un an plus tard), une journée qui contient aussi tout le passé des protagonistes. Le 1er novembre 1939, jour des morts, dans la chaleur étouffante d’une petite ville du Mexique, trois personnages déambulent : Geoffrey Firmin, l’ancien consul, Hugh, son demi-frère, et Yvonne l’ex-femme de Geoffrey. Leurs points de vue alternent au cours des chapitres, se croisent, se superposent. Ce matin-là, Yvonne tant espérée est revenue alors que le Consul émerge d’une nuit d’ivresse. Mais dès le premier chapitre, on sait qu’il est trop tard et que l’on s’achemine inéluctablement vers la tragédie : « Et l’amour pouvait bien vous priver de parole, vous aveugler, vous rendre fou, vous tuer (…) cela n’étanchait pas votre soif de pouvoir dire l’amour trop tard venu. » Le Consul, marqué par la guerre de 14, appartient à cette génération perdue qui sombre dans l’alcool comme Fitzgerald ou Hemingway, qui s’embarque comme Céline ou Conrad pour un voyage au bout de la nuit, au bout de l’enfer. Comme lui, Yvonne et Hugh ont leurs fêlures, leurs blessures secrètes et leurs désillusions. A l’image de sa vie, le jardin du Consul, laissé à l’abandon, est en ruines: Eden devenu Enfer, métaphore de l’amour passé devenu impossible. Sous l’emprise de l’alcool, Geoffrey entend des voix, est en proie à des hallucinations. La réalité et l’imaginaire se mêlent...
Les Invisibles, Roy Jacobsen
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Comme le roman victorien, russe ou picaresque le roman scandinave constitue presque un genre à part entière. Il est fait de récit initiatique, d’évocation de la vie rustique au rythme de la nature, des tempêtes et des saisons, de lutte incessante et toujours recommencée contre les éléments. Les Invisibles du norvégien Roy Jacobsen raconte ainsi la vie âpre et rude de la famille Barroy, paysans-pêcheurs au début du XX ème siècle, sur une petite île au sud des Lofoten. Ingrid a trois ans quand le roman commence, « une longue chevelure de la couleur du goudron, des yeux pétillants et des pieds qui ne connaitront pas de chaussures avant octobre. Mais d’où tient-elle ces yeux, où la bêtise morne de la pauvreté est tellement absente? » A sept ans, elle sait vider les poissons, mailler les filets de pêche, nettoyer le duvet d’eider, retourner les briques de tourbe; à douze ans, « elle sait à peu près tout faire. » Elle rêve de découvrir le vaste monde mais « lorsque l’on vit sur une île on n’en part jamais, on ne sait pas qu’une île s’accroche à ce qu’elle a, de toutes ses forces. » Quand le roman finit, elle est devenue mère, elle a connu l’irruption de la tragédie, l’adversité et les fantaisies du destin et avec cette force de vie qui est sienne, elle a fait face. C’est simple et beau, limpide et fort. Les Invisibles, Roy Jacobsen, traduit par Alain Gnaedig, Folio, 2019, 298...
Un pied au paradis, Ron Rash
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Le Fleuve de la liberté raconte l’histoire de May, jeune couturière qui s‘émancipe peu à peu, trouve un travail, découvre un nouveau milieu, celui des acteurs du Théâtre flottant. Mais surtout, il crée une atmosphère, celle du fleuve, l’Ohio- au fond n’est-ce pas lui le personnage principal comme le suggère le titre?- et du bateau-théâtre. Au fil de l’eau, il nous entraine entre les deux rives que tout sépare, le Nord abolitionniste et le Sud esclavagiste, dans l’Amérique des années 1830. La découverte de l’asservissement des Noirs se fait peu à peu, pour le lecteur comme pour l’héroïne; la jeune femme est embarquée progressivement, par un enchaînement de circonstances, à faire traverser clandestinement des enfants noirs. Et l’on tremble pour May, personnage attachant dont on craint à tout moment qu’elle soit découverte. Certes, ce n’est pas le premier roman qui traite de la question de l’esclavage et de l’aide aux fugitifs mais Martha Conway le fait avec nuance et délicatesse, comme indirectement et d’autant plus efficacement. Les attitudes des différents personnages incarnent toute la palette des réactions humaines face à l’injustice : indifférence, laisser-faire, appât du gain, cruauté, engagement militant ou soutien indirect. C’est habile, et non sans charme. Prenant. Le Fleuve de la liberté, Martha Conway, traduit de l’anglais par Manon Malais, Le Livre de poche, mai 2019, 473 pages. Le Serpent de l’Essex a tout le charme d’un roman anglais, entre Jane Austen et Conan Doyle, avec un soupçon de Dickens. Amour, suspense, plongée dans la vie du XIX° siècle, des demeures aristocrates aux quartiers ouvriers de Londres en passant par un presbytère de campagne. Sarah Perry sait décrire avec précision les états d’âme de ses personnages comme les paysages au cours des saisons. Sa langue fluide et poétique nous entraîne dans...
Grand Frère, Mahir Guven
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans une narration alternée, deux frères racontent leur histoire : « Grand frère » (le narrateur principal, conducteur VTC) et « Petit frère » (infirmier parti en Syrie). Deux frères, deux parcours mais la même blessure depuis la mort de leur mère et le silence du père. La même fracture : des rêves avortés (l’armée, la chirurgie) et une échappatoire (le shit pour l’un, le Cham -la Syrie- pour l’autre.) Sans manichéisme ni misérabilisme, les deux personnages incarnent les failles et les dérives contemporaines : destins empêchés, travail uberisé, dérive identitaire. Le récit de leurs trajectoires, à la fois proches et opposées, entretient un suspense qui monte en puissance. Il y a indéniablement de l’énergie, un souffle, une voix dans ce premier roman de Mahir Guven. Quelque chose de l’ordre de la sincérité, de la nécessité, loin des romans à succès fabriqués. Et surtout une langue inventive et plastique qui fait flèche de tout bois, qui emprunte autant au verlan qu’à l’anglais, à l’arabe, à l’espagnol, au gitan, au wolof. Une langue à l’image du protagoniste moitié syrien, moitié breton qui a grandi à Paris entre un père communiste exilé politique, une grand-mère catholique parlant français, l’autre musulmane parlant arabe. Un roman actuel et percutant. Grand Frère, Mahir Guven, Le Livre de poche, février 2019, 308 pages. Goncourt du Premier Roman...
Manuel à l’Usage des Femmes de ménage, Lucia Berlin...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Des nouvelles? Genre peu prisé des lecteurs français… Et pourtant, quoi de plus adapté à notre époque frénétique que cette forme brève, efficace et percutante, dans laquelle excellent les auteurs américains? Lucia Berlin est de ceux-là. Les textes de Manuel à l’usage des femmes de ménage inspirés par sa vie mouvementée et par les nombreux métiers qu’elle a exercés entre USA, Chili et Mexique, sont autant de flashs de vie. Elle sait évoquer un univers, donner vie à des personnages et nous toucher en quelques pages. Au fil des histoires, on retrouve une jeune femme qui lui ressemble avec ses quatre fils, sa mère alcoolique, ses liaisons passionnées, ses galères et son énergie combative. On rencontre aussi des paumés, des cabossés de la vie : vieillard sénile, jockey blessé, toxicos, alcooliques, patients des urgences, vieux couple fragile … De ceux que l’on croise sans les voir dans les bus, les hôpitaux, les laveries automatiques et qu’elle sait regarder. Cela pourrait être sordide, désespéré ou larmoyant. Tout est une question de distance et de style : dosage entre humour et empathie, sens des dialogues et du petit détail vrai. C’est à la fois drôle et terrible, émouvant et généreux. Humain, tout simplement. Manuel à l’usage des femmes de ménage, Lucia Berlin, traduit de l’américain par Valérie Malfoy, Le Livre de poche, octobre...
La Douce Indifférence du monde, Peter Stamm
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Avec La Douce Indifférence du monde le romancier suisse Peter Stamm compose un récit subtil, plein de charme et de mystère, une réflexion sur le temps, le réel et l’imaginaire. Envoûtant. Toute l’histoire de ce roman inracontable est celle d’un dédoublement. A l’issue d’une représentation de Mademoiselle Julie, Christoph, le narrateur, romancier d’une cinquantaine d’années, donne rendez-vous à Lena, jeune actrice qui lui rappelle Magadalena, la femme aimée une quinzaine d’années auparavant. Dans un cimetière de Stockholm puis dans un café, il lui raconte son histoire, son amour passé pour Magadalena et ses rencontres obsédantes avec un jeune homme qui ressemble étrangement à celui qu’il a été. Au fil du récit et de leur déambulation, des similitudes troublantes apparaissent entre les vies des deux protagonistes, à la fois semblables et différentes. Il y a tout d’abord le titre -inspiré de Camus (1)- qui attire, puis l’atmosphère étrange qui séduit et l’écriture qui entraîne. Même si l’on se sent quelque peu désarçonné(e) dans ce roman qui tient de Vertigo et de Mulholand Drive, même si l’on se perd parfois, dans l’alternance des récits, entre les couples, les époques et les lieux, on se laisse emporter jusqu’au dernier chapitre. Au cours du livre, le narrateur, l’héroïne, et le lecteur, s’interrogent sur la réalité et la fiction. Qu’est-ce qui est vrai ou inventé, souvenir ou imagination? Christoph a-t-il vraiment vécu l’histoire qu’il raconte à Lena? Au fond, chacun a le désir de faire de sa propre vie une histoire, qu’il soit écrivain, acteur, lecteur ou simple noctambule un peu ivre et bavard. Mais « il n’y a que dans les livres que les histoires ont une fin. (…) Dans la réalité, il n’y a pas de fin, sauf la mort. Et elle est rarement heureuse. » L’homme mûr est...
ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman unanimement salué par la critique et cité pour les prix, Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard évoque une passion dévorante entre deux jeunes femmes dans un rythme et un style fiévreux. C’est une histoire d’amour fou qui surprend, bouleverse et emporte les deux protagonistes : la narratrice, jeune professeure de lycée, mère d’une petite fille et récemment séparée de son compagnon, et Sarah, violoniste concertiste dans un quatuor. Sarah, la tornade trentenaire aux allures d’adolescente, passionnée et imprévisible, fascinante et tyrannique. Sarah, vivante et mortifère. Cette passion se vit pendant deux ans sous le signe de l’urgence et de l’excès : des courses éperdues, des nuits volées entre deux avions ou deux trains, des retrouvailles et des départs, des larmes et des étreintes. Peu à peu, l’euphorie amoureuse fait place à la douleur d’aimer. Après les débuts idylliques, viennent les désaccords, les orages, les scènes de plus en plus fréquentes et la rupture. C’est une histoire d’amour torride, tumultueuse et tragique, forcément tragique car, comme dans le théâtre antique, l’issue fatale en est annoncée dès la première page. A l’image de la passion qu’il raconte, le roman de Pauline Delabroy-Allard se déroule et se lit à toute allure, en courts chapitres superposés et numérotés comme autant de flashs de vie – quatre vingt-deux dans la première partie, trente dans la deuxième où le temps semble suspendu à Milan et à Trieste. A l’image des quatuors de Beethoven et de Schubert que la narratrice écoute en boucle, des leitmotivs obsessionnels (mots, phrases ou paragraphes) scandent la narration comme autant de refrains entêtants. Sarah, envahissante, prend toute la place dans l’histoire. Son prénom résonne dans le titre, comme dans tout le livre, avec le S sifflant et la première syllabe :« ça raconte ça, je me souviens de ça». Son portrait est repris avec des variantes « Ça raconte Sarah, sa beauté inconnue, cruelle, son nez d’oiseau de proie, ses yeux comme des silex, ses yeux meurtriers, assassins, ses yeux de serpent aux paupières tombantes.» Sa volonté impérieuse et contradictoire rythme la phrase : « Elle veut qu’on aille au cinéma, elle veut qu’on fasse l’amour, elle veut qu’on s’endorme ensuite dans les bras l’une de l‘autre, elle veut qu’on arrête de s’écrire et de se parler pendant quelques jours, elle veut qu’on mange japonais, elle veut qu’on parte en week-end à la campagne pour se reposer, elle veut que j’arrête de pleurer, elle veut aller à une fête sans moi, elle veut ne pas avoir de responsabilité, elle veut être légère, elle veut être libre. » Omniprésente, éblouissante, Sarah prend toute la lumière et éclipse tous les autres personnages; la narratrice elle-même n’a pas de nom ni sa petite fille, tous les personnages secondaires sont effacés, réduits à leur rôle d’acteur dans cette passion aveuglante et dévoratrice. Enfermé(e) dans le point de vue de la narratrice qui raconte à la première personne, le lecteur/la lectrice partage sa subjectivité, son obsession (on pourrait presque dire sa possession) et n’a pas accès à la réalité des faits. L’une des forces du roman est ainsi de maintenir jusqu’à la dernière page la tension et l’incertitude, aux confins de la folie. Peu importe qu’il s’agisse d’une relation entre deux femmes, « Sarah » devient le symbole de toute passion, du désir impérieux, de l’impossible fusion et de la souffrance de l’absence. Même s’il n’est pas dépourvu de quelques maladresses et de tics d’écriture contemporains (comme l’usage du copier coller Wikipedia pour définir un film, une ville), ce court roman aux accents durassiens emporte et séduit le lecteur. Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard, Les Editions de Minuit, 2018, 188...
Arcadie, Emmanuelle Bayamack-Tam
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Notre coup de coeur en cette rentrée littéraire, Arcadie, le onzième roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam, nous entraîne dans une communauté libertaire à travers le regard d’une adolescente. Eden ou secte, en tout cas miroir révélateur et voyage en utopie mené avec brio. A Liberty House, zone blanche située quelque part dans le sud-est de la France, se retrouvent tous les exclus, les marginaux, les laissés pour compte de la modernité – malades, toxicos, obèses, nonagénaires… Autour d’Arcady, leur guide charismatique qui arbore en tatouage la devise latine « Omnia vincit Amor », ils cultivent leur jardin (bio, évidemment) et pratiquent l’amour libre. Farah, la narratrice adolescente, y est arrivée à l’âge de six ans avec sa mère souffrant d’électro- sensibilité, son père dyslexique passionné d’horticulture et sa grand-mère naturiste. Elle y a grandi sans contrainte, vivant une enfance heureuse entre les arbres et les livres, loin des Mac Do et des réseaux sociaux. Mais, à l’adolescence, son physique disgracieux se précise : loin d’embellir, la jeune fille se virilise et se pose alors, à l’heure des premiers désirs, la question de son identité sexuelle. A quatorze ans, elle rêve de défloration, tour à tour attirée par Arcady, figure paternelle qu’elle vénère depuis des années, puis par la jeune Maureen rencontrée hors de la communauté et enfin par Angossom, l’étranger à peine entrevu. Le récit a ainsi des airs d’adieu à l’enfance qui s’éloigne et que l’on enterre – comme les objets que les pensionnaires enfouissent dans la capsule temporelle pour les générations futures – « en cette fin d’été qui voit quatre d’entre nous battre pavillon vers les rives, sans charme ni mystère, de l’âge adulte. »Le temps, le lieu de l’innocence s’éloignent, remplacés par celui du désir ; le « nous » fait place au « je » ; l’ailleurs attire irrésistiblement au-delà de...
Le Lambeau, Philippe Lançon
écrit par Marie-Odile Sauvajon
7 janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo. Gravement blessé à la mâchoire, le journaliste Philippe Lançon passe neuf mois en hôpital et subit de nombreuses interventions chirurgicales. Le Lambeau est le récit – précis, factuel, terrible et magnifique – de cette lente et douloureuse reconstruction. Il faut tout d’abord dire que Le Lambeau n’est pas, ce que l’on aurait pu craindre, pathétique, idéologique ou résilient. Ici, ni complaisance larmoyante, ni analyse socio-politique , ni optimisme volontariste. Philippe Lançon recueille les faits, les sensations, le vécu au jour le jour depuis ce moment où la violence a fait irruption dans la salle de rédaction d’un hebdomadaire satirique, la transformant en scène de guerre. Fracassé corps et esprit, le survivant entame un long combat fait de persévérance, d’échecs et de recommencements. Entouré par ses proches – parents, frère, amis –, pris en charge par les soignants, il vit au rythme de l’hôpital. En relatant ce combat, il rend hommage au personnel hospitalier qui l’accompagne pendant ces longs mois de greffes, rejets, cicatrisation, rééducation… Dieux omnipotents qui fabriquent une mâchoire nouvelle à partir d’un os du péroné, doigts de fée qui réussissent un pansement impossible et trouvent une veine invisible, anges gardiens qui dispensent le sommeil bienfaisant de la morphine mais aussi personnages bien vivants dont il brosse les portraits. Tout l’univers de l’hôpital est là, un monde fait de professionnalisme, de compétence extrême et de bricolage. Un monde qui accueille les blessés de la vie, victimes d’accidents, de cancers, d’AVC ou de suicides ratés, qu’il croise dans les couloirs et dont les descriptions évoquent les gueules cassées de la Grande Guerre. D’ailleurs « sa » chirurgienne, personnage central avec qui se noue une belle relation, le lui rappelle : « Vous êtes un mutilé ». Roi dérisoire, défiguré, diminué, comme...
Le Complot contre l’Amérique, Philip Roth...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Déjà classique, Philip Roth? Non parce qu’il est récemment décédé ni parce que ses romans connaissent un immense succès mais parce que, quatorze ans après sa parution, son roman Le Complot contre l’Amérique n’a rien perdu de sa force et de son actualité. S’inspirant de sa propre enfance à Newark dans le New Jersey, Philip Roth imagine ce qui serait advenu à sa famille entre 1940 et 1942 si l’aviateur Charles Lindbergh, isolationniste et antisémite, avait été élu président des Etats-Unis à la place de Roosevelt. A partir de faits historiques – le comité America First, les sympathies de Lindbergh pour le régime nazi, son discours de septembre 1941 désignant les juifs comme groupe fauteur de guerre – le romancier construit une uchronie glaçante. D’abord insidieuse, la menace antisémite se précise, la parole se libère, les premières mesures contre les juifs sont prises et la violence explose. Quand Hermann Roth, le père du jeune héros, prend conscience du danger, il est déjà trop tard. En fin de livre, un post-scriptum bienvenu et documenté propose la véritable chronologie des personnages historiques ainsi que l’intégralité du discours de Lindbergh;le lecteur peut ainsi faire la part de la réalité et de la fiction et découvrir cette face sombre et peu connue de l’Amérique. De l’aveu même de l’auteur, Le Complot contre l’Amérique est, comme Némésis1, un roman de la peur. « La peur perpétuelle » enserre le roman de la première phrase jusqu’au dernier chapitre et maintient le lecteur dans un suspense haletant, angoissant. Elle s’étend de l’ancien au nouveau continent, n’épargnant aucun territoire. La peur ancestrale de la persécution s’abat sur le jeune Philip Roth âgé de sept ans lorsqu’il se découvre juif, lui qui croyait être « l’enfant américain de parents américains, qui fréquentai[t] l’école américaine d’une ville...
Eugenia, Lionel Duroy
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lionel Duroy délaisse l’autobiographie qu’il poursuivait depuis son premier ouvrage Priez pour nous publié en 1990 et évoque indirectement ses obsessions à travers l’histoire d’Eugenia dans la Roumanie des années 1940. Il y est question de la montée du nazisme et de l’antisémitisme, de l’engagement de l’écrivain et, encore et toujours, du poids de la famille et de la complexité des relations dans la fratrie. L’histoire se déroule entre 1935 et 1945, à Bucarest et Jassy, deuxième ville de Roumanie. Eugenia, la jeune héroïne âgée de dix-huit ans au début du récit, est aussi la narratrice de ces dix années terribles sur lesquelles elle se penche. Etudiante à l’université de Jassy, sa vie bascule quand elle rencontre le grand écrivain roumain d’origine juive Mihail Sebastian, invité par sa professeure de littérature à l’occasion de son dernier livre, Deux mille ans. Pour la jeune fille naïve, issue d’une famille où les propos antisémites sont monnaie courante, c’est une découverte intellectuelle et le début d’une histoire d’amour. S’éloignant peu à peu de son milieu d’origine et surtout de son frère Stefan, militant d’extrême droite pro-hitlérien, elle devient journaliste, couvre le pogrom de 1940 dans sa ville natale puis pousse encore plus loin l’engagement en participant activement à la résistance contre l’armée allemande. A la fin de la guerre, parce qu’elle veut tenter de comprendre, elle écrit le récit de ces dix années. Dans ce roman historique, l’auteur mêle fiction et réalité: il invente le personnage d’Eugenia qu’il place aux côtés de figures historiques, parmi lesquelles Mihail Sebastian, auteur roumain au destin tragique[1]. Avec ces personnages et le choix de la Roumanie, Lionel Duroy opère un double décentrement, à la fois biographique et géographique. On découvre l’histoire méconnue de ce pays pris en étau entre l’Allemagne et...
Les Passeurs de livres de Daraya, Delphine Minoui...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
C’est une histoire incroyable que nous rapporte la journaliste Delphine Minoui: dans la ville de Daraya assiégée par les forces syriennes, de jeunes combattants créent une bibliothèque clandestine. Des livres sous les bombes, rempart fragile et dérisoire; une histoire tragique et cependant pleine d’espoir. Daraya, ville de la banlieue de Damas réputée pour ses terres fertiles et son doux raisin, est devenue ville martyre. Dès 2002, les premiers mouvements d’opposition ont entraîné une répression sanglante. Après les manifestations de 2011 et 2012, la ville est assiégée et bombardée sans trêve par l’armée de Bachar al-Assad. Bombes barils, armes chimiques, la ville est en ruines. Dans la cité qui comptait 250 000 habitants avant la révolution ne subsistent plus que 12 000 survivants qui manquent de tout. Beaucoup ont pris le chemin de l’exil, d’autres sont morts. Sous les gravats, sous les décombres des écoles et des maisons, les combattants trouvent des livres, les récupèrent. Peu à peu, des milliers d’ouvrages sont stockés. Qu’en faire? En 2013, dans le sous-sol d’un immeuble, ils aménagent une bibliothèque avec ses rayonnages, son classement, son règlement comme un îlot d’ordre au sein du chaos, un îlot de culture et de démocratie. C’est ainsi qu’ils deviennent Les passeurs de livres de Daraya. Pour pallier la pénurie d’ouvrages et de papier, les titres les plus demandés sont téléchargés, consultés sur les portables, imprimés sur des feuilles A4 en caractères minuscules. Pour répondre à la soif de savoir de ces étudiants privés d’université, des cours d’anglais, de science politique, des projections de courts métrages sont organisés. La bibliothèque devient lieu de rencontre, de résistance et même d’édition d’une petite revue photocopiée où se mêlent poésie, conseils pratiques et auto-dérision. Mais que lit-on sous les bombes? Bien sûr, des classiques – Shakespeare,...
Article 353 du Code Pénal, Tanguy Viel
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Construit, dense et efficace, Article 353 du Code pénal, le dernier roman de Tanguy Viel, est une réussite. Il tient du roman social, du policier et fait entendre, entre confession, dialogue et plaidoyer, un ouvrier licencié, un homme floué dans la France des années 1990. Devant le juge d’instruction, Martial Kermeur, que l’on vient d’arrêter pour homicide, s’explique. Pour répondre à la question de ce dernier – «Bon sang, Kermeur, mais qu’est-ce qui vous a pris?» – il lui faut revenir sur les six années précédentes. Depuis le jour où Antoine Lazenec, l’homme providentiel, a débarqué en Porsche dans ce coin du Finistère sinistré par la fermeture de l’arsenal. Lisse et souriant, le promoteur achète le château et les deux hectares du parc avec vue sur la rade dans le but de transformer le bourg endormi en «station balnéaire». Habile manipulateur, il séduit et fait rêver en parlant avenir, investissement et rendement. Le maire lui-même est conquis et Martial Kermeur, l’ancien ouvrier spécialisé de l’arsenal, le socialiste de 1981, investit tout son argent – les 400 000 francs de l’indemnité de licenciement – dans ce projet immobilier. Et puis un jour, après six ans d’attente et de désillusion, lorsqu’il comprend qu’ils ont été bernés, qu’autour de lui des vies ont été brisées, Martial Kermeur pousse Lazenec dans l’eau froide à cinq milles des côtes parce qu’ «un type comme ça, monsieur le juge, un type comme ça, j’ai compris depuis: si ce n’est pas vous qui le faites disparaître, il ne disparaitra jamais. Il reviendra. Toujours.» Un dossier parmi beaucoup d’autres, «une vulgaire histoire d’escroquerie… rien de plus» comme le dit Kermeur au juge? Mais si l’on prend le temps d’écouter, de retracer l’enchaînement des événements depuis le début, le fait divers devient un...
Zero K, Don DeLillo
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Sujet d’époque au centre de plusieurs ouvrages de la rentrée littéraire, le transhumanisme est aussi le thème de départ de Zero K, dernier livre de Don DeLillo. Mais, pour le grand romancier américain, aborder le sujet des expérimentations contemporaines c’est aussi traiter de questions universelles dans un roman métaphysique. Bouleversant et magistral. L’histoire se situe au bout du monde, à Tcheliabinsk, près de la frontière kazakhe, dans un lieu souterrain nommé la Convergence qui tient à la fois de l’hôtel, de l’hospice et de l’installation d’art conceptuel. Tout y est blanc, vide, aseptisé. Jeffrey, le narrateur, retrouve là son père, le richissime et puissant Ross Lockhart qui lui a demandé de le rejoindre. Il souhaite la présence de son fils au moment du départ de sa compagne adorée, Artis. Souffrant de maladies invalidantes, celle-ci a choisi que son corps soit cryogénisé dans l’attente d’une renaissance future. Ross, bien que sexagénaire en excellente santé, est lui-même tenté de partir avec elle, pour faire partie de ces hérauts qui tracent la voie, pour «entrer dans une autre dimension. Puis revenir. Pour toujours.» Ni utopie ni science fiction, le livre de Don DeLillo évite et dépasse les clichés du roman d’anticipation. Sa phrase blanche, efficace et rythmée, évoque à merveille l’univers glacé de la Convergence. Sa narration nous entraîne, à travers l’histoire des trois protagonistes, dans une réflexion sur le temps, la mort et l’humain. Artis, qui a exercé la profession d’archéologue, s’apprête à reposer dans un sarcophage, au sein de ce laboratoire où biologistes, généticiens et neuro scientifiques élaborent une autre façon de vivre et de mourir: «Ils fabriquent le futur. Une nouvelle idée du futur. Différente des autres.» Face aux préparatifs de ce passage, Jeffrey se souvient de la mort de sa mère Madeline, la...
L’Art de perdre, Alice Zeniter
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Entre la France et l’Algérie, c’est une histoire d’amour et de haine, d’attirance, de violence et surtout de silences. Une histoire omniprésente qui, à travers ses multiples acteurs, travaille souterrainement la société française et resurgit à la moindre occasion. A cette rentrée, parmi d’autres ouvrages, L’art de perdre d’Alice Zeniter, roman familial sur trois générations, fait entendre la mémoire occultée des harkis. Il y est question de guerre, d’immigration, d’intégration et surtout d’identité. Dans son livre de facture classique, l’auteure retrace en trois parties plus de soixante ans de l’histoire de l’Algérie, à travers les destins de trois personnages. Ali, le grand-père, Hamid, le fils aîné et Naïma, la petite-fille, incarnent respectivement trois figures de l’immigration. Forcé de quitter son village de Kabylie au moment de l’Indépendance, le paysan aisé, l’ancien combattant de Monte Cassino devient un ouvrier silencieux, un homme humilié. Son fils en révolte, pur produit de l’école républicaine, s’écarte de la tradition, découvre Paris dans l’après 68, épouse une Française et prend ses distances avec la famille. A la troisième génération, la petite-fille parisienne se penche sur ses origines et prend le bateau dans l’autre sens pour découvrir d’où elle vient, ou plutôt d’où viennent ses ancêtres. Du destin subi au destin assumé la route est longue et douloureuse. Un demi-siècle d’humiliation et de silence que vient rompre ce gros roman, fruit des recherches de l’auteure. Des champs d’oliviers de Kabylie à la cité HLM de Basse-Normandie, en passant par les camps de Rivesaltes et de Jonques, la narratrice reconstitue, comme en une nouvelle Enéide, l’épopée tragique de sa famille déracinée. A partir d’images éparses et de souvenirs décousus, «vignettes» de l’ancien temps, elle tisse un récit inscrit dans le contexte de l’Histoire. Elle part à la recherche du village perdu,...
Entre eux, Richard Ford
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Réunissant deux textes écrits à plus de trente ans de distance, Richard Ford érige un tombeau à la mémoire de ses parents. Avec pudeur et sincérité, il reconstitue l’histoire de ces deux personnes qui lui ont appris, simplement, à accepter la réalité telle qu’elle est. Eternel sujet que celui des parents, mais sujet difficile, relevant autant de l’autobiographie que de la fiction, surtout quand il s’agit de raconter, de reconstituer le temps d’avant sa naissance ou celui de sa petite enfance. Ce récit, forcément hypothétique et lacunaire, ne repose que sur quelques indices: bribes de souvenirs, rares photos. Il est parsemé de «peut-être, je crois que, j’ignore...», jalonné de questions sans réponses dont la principale est celle de la raison de sa venue au monde: pourquoi, au bout de quinze ans de vie commune, ce couple fusionnel a-t-il éprouvé le besoin d’avoir un enfant? Fils unique et tardif d’un couple formé à la fin des années vingt, le petit Richard voit le jour en 1944. Pendant plus de dix ans, Parker et Edna, ses parents, ont mené d’hôtel en hôtel une vie itinérante, heureuse et insouciante, sillonnant en voiture les sept Etats du Sud que couvrait son père, représentant en amidon. A la naissance de leur enfant, leur vie s’adapte, simplement: ils prennent un appartement à Jackson, Mississippi. Edna devient femme au foyer; Parker rejoint sa famille le vendredi soir, attendu et fêté par sa femme et son fils: «Il était bel et bien une présence, sinon un père présent.» La vie s’assombrit avec la première crise cardiaque de son père puis reprend son cours pendant douze ans, jusqu’à son décès en 1960. Le texte consacré à sa mère évoque alors les années de veuvage, la relation de Richard adulte avec Edna jusqu’à sa...
Quelques jours avec Tomas Kusar, A.Choplin
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De livre en livre Antoine Choplin poursuit son exploration des rapports entre engagement et création et donne la parole aux gens simples. Dans Quelques jours avec Tomas Kusar, il évoque dans la Tchécoslovaquie communiste la rencontre d’un jeune garde-barrière avec l’écrivain dissident Václav Havel. Une belle histoire d’amitié, de courage et d’humanité. Quel personnage plus approprié en effet que celui de Václav Havel, écrivain, homme de théâtre, militant des droits de l’homme et premier président de la république tchèque pour poser les questions de l’art et de l’engagement? Mais, comme l’indique le titre, le personnage principal du roman n’est pas Václav Havel mais Tomas Kusar, le cheminot taiseux de Trustov, «un petit gars valable», amoureux de la forêt, des oiseaux et de la jolie Lenka. Un homme simple que rien ne destinait à se retrouver un jour au balcon du Château de Prague aux côtés du président. Tout commence par une brève rencontre entre le dramaturge pragois et le garde-barrière, lors d’une représentation interrompue de la troupe de la Balustrade, à l’occasion du bal des cheminots. Un verre de vodka, une poignée de mains et quelques propos échangés. Cinq ans plus tard, Tomas reconnaît Václav devenu employé de brasserie; une amitié naît peu à peu au cours de soirées au café entre verres de bière et parties d’échecs. C’est ainsi que le jeune homme va progressivement, insensiblement entrer en dissidence, cacher dans un coin de son atelier des samizdats, poster des exemplaires de la Charte des droits de l’homme, au point de perdre son travail et son logement. Accueilli par Václav et Olga, il vit alors dans la grange de Hradecek à côté de leur maison, partageant leur intimité et leurs activités clandestines, concert de rock, copies manuscrites des pièces interdites, pétition pour la...
Lettres à Anne, François Mitterrand
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Et si Lettres à Anne de François Mitterrand était LE livre de l’année 2016? Mille deux cent dix-huit lettres écrites à la femme aimée pendant plus de trente années! Roman d’amour et roman épistolaire bien sûr, mais aussi autobiographie, essai politique et même œuvre poétique, jouant de tous les styles, longs épanchements lyriques, brèves factuelles, portraits caustiques, poèmes en prose… Une œuvre totale et peut-être la dernière correspondance amoureuse. On est subjugué, submergé par l’intensité de cette passion sans cesse réaffirmée, comme Mitterrand le remarque lui-même : « Et je suis là, à te récrire pour la centième fois, la même lettre ». Mais qu’est-ce que l’amour sinon le ressassement ? La répétition incessante du nom de l’aimée comme une incantation : « Tu t’appelles Anne et je t’aime » ? La déclinaison du verbe aimer, sous une forme simple : « Tu es ma forêt dont j’aime chaque arbre » ou plus alambiquée : « Tu es mon bouquet de fleurs claires. Bouche en forme d’iris, rire au chrysanthème d’or simple, gravité de la tulipe noire, ô mon front de lilas, ô mon corps de varech, mon amour à l’odeur de violette et de mer » ? Lettres à Anne, c’est l’histoire d’un homme et d’une femme et c’est aussi une page de l’histoire de France dans ces lignes qui ressuscitent les années 60 et 70. François Mitterrand appelle le 106 à Château-Chinon, Littré 10-77 à Paris mais comme « le téléphone reste un instrument du Moyen-Age » il a aussi recours au courrier et aux télégrammes ; il roule en DS 21, surnommée « la pantoufle », en 2 CV ou en GS, atterrit en Viscount à Orly, prend le Mistral pour descendre dans le Sud, le Bourbonnais pour aller de Nevers à Clermont-Ferrand ; les filles portent les cheveux « en catogan », en Amérique il découvre les premiers « hippies » et, chroniqueur...
Illska, Eirikur Örn Norddhal
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman traduit en français du jeune romancier islandais Eirikur Örn Norddhal, Illska est un récit étrange, déroutant, décapant, roman à la fois historique et contemporain, mené de main de maître. Le point de départ du roman est l’histoire d’amour d’un couple d’étudiants, Agnes et Omar, qui se rencontrent à Reykjavik par une nuit glaciale de 2009. Au cours de ses interviews pour son mémoire sur le racisme populiste en Islande, Agnes fait ensuite la connaissance d’Arnor, néo-nazi qui devient son amant. Un enfant naît – de qui est-il le fils?- le couple se défait, Omar incendie leur maison et part à travers l’Europe. Encore un roman islandais ! Mais cette fois une Islande loin des clichés, sans volcan ni geyser, sans bélier ni macareux, une Islande contemporaine, mondialisée, aseptisée : « En fait, l’Islande n’est rien d’autre que le Danemark. Rien de plus que la béarnaise. Fabriquée industriellement et conditionnée dans des pots en plastique. » On s’y nourrit d’hamburgers-frites et de pizzas, seules les vieilles grands-mères à la campagne préparent encore « de l’aiglefin et des pommes de terre, le tout arrosé de graisse de mouton fondue » ; les banques sont en faillite, on manifeste en lançant des œufs et tapant sur les casseroles; on rencontre des Lituaniens, des Polonais, des caissières de supermarchés thaïlandaises et les mouvements d’extrême-droite se développent. Grâce à un va-et-vient constant entre passé et présent, l’histoire individuelle et familiale des trois jeunes gens s’inscrit dans l’Histoire collective de l’Europe au XX° siècle; en effet, les parents d’Agnes sont originaires de la petite ville de Jurbarkas en Lituanie où la population juive fut massacrée pendant la seconde guerre mondiale et le souvenir de l’Holocauste hante la mémoire de l’héroïne. Au cœur du roman, la question de l’identité : qu’est-ce qu’être Islandais(e) quand on est...
Le Beau-Fils, Emmanuel Bove
écrit par Marie-Odile Sauvajon
La réédition de son roman Le Beau-fils paru en 1934 est l’occasion de redécouvrir Emmanuel Bove, auteur discret et grand romancier de l’entre-deux-guerres. Un classique méconnu. C’est l’histoire d’un jeune homme sans histoire, Jean-Noël, un déclassé. Enfant illégitime, il est élevé après la mort de son père par l’épouse de celui-ci, Annie Villemur de Falais qui appartient à la grande bourgeoisie. Marqué par sa bâtardise et la modestie de son origine, il éprouve pour sa belle-mère une admiration sans borne. Ce qui le fascine en elle, c’est autant son élégance, son assurance, sa détermination (tout ce qu’il n’est pas) que le prestige de la famille Villemur, l’appartement luxueux avenue de Malakoff et l’impression de sécurité qui en émane. Car Jean-Noël, comme son père, est un homme indécis, indolent, velléitaire. Incapable de prendre une décision, il se laisse porter par les événements : « Ce n’était pas lui qui avait fait sa vie, mais celle-ci qui l’avait fait. » Sur un coup de tête, il devance l’appel et s’engage en 17, refuse d’entrer dans le monde du travail au lendemain de la guerre, commence des études de droit sans les achever, rencontre une jeune fille et se trouve contraint de l’épouser quand celle-ci est enceinte. Il la quitte quelques années plus tard pour vivre avec Laure Mourier, jeune femme distinguée séparée de son mari ; grâce aux relations de cette dernière, il entre comme clerc chez un notaire. Toujours insatisfait et aspirant à une autre vie, il épouse Odile Wursel, jeune fille fortunée rencontrée par les Villemur, après avoir, non sans difficulté, convaincu sa femme de divorcer. Mariage d’intérêt sans véritable amour – mais, comme le lui demande sa fiancée : « Etes-vous seulement capable d’aimer ? » – cette nouvelle union se termine elle aussi par une séparation. Harcelé par sa mère...
Le dernier Voyage de Soutine, Ralph Dutli
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Ralph Dutli convoque à travers ses trois dernières journées toute l’existence tourmentée du peintre Chaïm Soutine. Voyage halluciné à travers la vie et l’oeuvre d’un artiste maudit. Violent et passionnant. Août 1943. Alors qu’il souffre d’un ulcère à l’estomac au dernier degré, Soutine est transporté de Chinon à Paris pour y être opéré. Au cours de ce transfert interminable et clandestin, dans un corbillard et hors des routes principales pour éviter les points de contrôle dans la France occupée, il revoit tout : l’enfance misérable dans le ghetto de Smilovitchi, l’académie des Beaux-Arts de Vilna, l’arrivée à Paris en 1913, les années de vache enragée à Montparnasse, l’amitié avec Modigliani, les amours avec Gerda Groth puis avec Marie-Berthe (ex-femme de Max Ernst), la rencontre miraculeuse avec le riche collectionneur Julian Barnes en 1923, les séjours à Cagnes et à Céret, la guerre et les caches successives à Paris et à Champigny. Et tout se confond dans le délire comateux de la morphine d’où n’émergent, à travers un constant aller-retour entre passé et présent, que deux couleurs : le rouge et le blanc. Rouge comme la douleur qui le torture, comme les pogroms de la Russie natale et les carcasses de bœuf ensanglantées qu’il ramène de l’abattoir pour les peindre à la manière de Rembrandt. Blanc comme le lait qui apaise l’ulcère, comme le vêtement du petit pâtissier de Céret et la robe de la première communiante, comme les médecins de la clinique, le lit mortuaire et le paradis de l’oubli. L’histoire mouvementée et tragique de Soutine se confond avec celle de la Ville Lumière, « la ville de ses rêves », « la capitale mondiale de la peinture », Paris où se pressent les artistes venus de toute l’Europe en ce début de XX° siècle. A son arrivée, le peintre...
14 Juillet, Eric Vuillard
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Raconter les événements qui se sont déroulés le 14 juillet 1789, à quoi bon ? On croit tout connaître de cette journée qui s’inscrit dans le roman national — le pont-levis, l’incendie, le gouverneur de Launay… Mais Eric Vuillard en récrit l’histoire, la sort des clichés et des images d’Epinal en se plaçant du côté des sans-voix, des oubliés. Un récit plein de souffle, de vie et d’humanité. Après avoir évoqué dans ses précédents romans la guerre de 14, la colonisation et la conquête de l’Ouest[1], Eric Vuillard raconte la prise de la Bastille. Et, cette fois encore, il déplace le point de vue et déconstruit les mythes : « Au fond, le 14 juillet, on ignore ce qui se produisit. C’est depuis la foule sans nom qu’il faut envisager les choses. Et l’on doit raconter ce qui n’est pas écrit. » Il nous apprend ainsi que la première émeute révolutionnaire n’a pas eu lieu le 14 juillet 1789 mais le 23 avril de la même année. Poussés à bout par la cherté du pain et la baisse de leur salaire, les ouvriers pillent la folie Titon, riche demeure de Réveillon, propriétaire d’une manufacture de papier peint ; les soldats tirent sur la foule, laissant plus de trois cents morts sur le pavé. L’écrivain sort de leur anonymat ces cadavres d’émeutiers entassés, numérotés ; il redonne corps et vie à cette entité souvent abstraite que l’on nomme le peuple. Ce n’est plus une foule indistincte qui s’élance à l’assaut de la Bastille, ce sont des individus que l’auteur fait revivre en leur donnant un nom, une existence, des émotions. De ces petites gens, on sait peu de choses mais assez pour les imaginer : quelques lignes d’état-civil, quelques phrases d’un acte de reconnaissance. Le romancier fouille les archives, sur les pas...
Les Damnés, mise en scène Ivo Van Hove
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans la cour d’honneur du palais des papes Ivo Van Hove met en scène Les Damnés (d’après le scénario de Visconti) avec la troupe de la Comédie-Française. Un grand moment de théâtre. L’histoire de la famille Essenbeck, inspirée de la famille Krupp, a des allures de drame shakespearien. On s’y entretue pour le pouvoir, on fait et défait les alliances entre cousins, on trame des complots, le fils incestueux se retourne contre sa mère. Sur la scène orange, rouge sang puis noire, les personnages s’affrontent dans un paroxysme de violence et passion. Sur l’écran, l’image projette en gros plan le jeu des acteurs, montre l’incendie du Reichstag ou les machines des aciéries et renvoie aussi aux spectateurs leur propre reflet. Chaque acte de cette tragédie est ponctuée par un meurtre, une mise au tombeau suivie par l’avancée silencieuse de tous les acteurs vers le public. C’est alors lui qui est filmé et qui voit son image projetée sur l’écran. Nous les regardons et nous nous regardons. Il faut faire avec cette immense espace où, de part et d’autre du praticable, sont disposés loges et coulisses, musiciens et cercueils, où l’oeil est sollicité de toute part. Et surtout, ce soir-là, il faut faire avec les rafales de mistral qui jouent avec les vêtements des acteurs et frigorifient les spectateurs. Mais malgré cela et en dépit de quelques longueurs, la magie du théâtre opère. Particulièrement dans des moments de fulgurance comme la bacchanale des SA où deux acteurs sur scène démultipliés par la vidéo et la sonorisation donnent l’illusion troublante d’une foule ; la cour d’honneur devient alors le stade de Nuremberg résonnant de chants nazis. Les acteurs du Français, tous impeccables, sont capables de tout, du plus intime -changements imperceptibles évoquant une multiplicité de sentiments sur...
Tristesses, mise en scène Anne-Cécile Vandalem....
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Le 70ème Festival d’Avignon, qui se tient du 6 au 24 Juillet, fait la part belle à la scène belge francophone. Tristesses est un spectacle de théâtre musical qui met en lumière les liens insidieux entre le pouvoir et la tristesse. Une franche réussite. Trois maisons de poupée et un temple dans une île imaginaire du Jutland nommée Tristesse qui ne compte plus que huit habitants depuis la fermeture des abattoirs. Mais il y a quelque chose de pourri dans ce royaume du Danemark, quelque chose d’étrange et d’inquiétant. Les ombres errantes du passé y déambulent lentement. La croix sur le fronton du temple est bizarrement penchée. Tout bascule lorsqu’on retrouve le corps de Mme Heiger pendue et que sa fille, la très ambitieuse Martha, dirigeante du parti d’extrême droite, vient pour enterrer sa mère. Sur le plateau, les acteurs s’affrontent pendant qu’en fond de scène la caméra filme et retransmet sur écran l’intérieur des maisons fermées, l’envers du décor. Les dialogues fusent, les claques volent. C’est drôle et violent à la fois car l’écriture d’Anne-Cécile Vandalem sait mêler dramatique et comique jusqu’à l’humour noir, macabre -au risque de désarçonner le public-. La scène des funérailles, déjantée, riche en gags est particulièrement hilarante. La narration, riche et prenante, tient du huis clos à la Ibsen et du polar noir américain. Ce que montre la pièce c’est le fascisme à tous les niveaux, celui du macho ordinaire, du petit chef, des enfants qui s’acharnent sur un souffre-douleur ; celui surtout qui s’impose peu à peu et parvient au pouvoir par la corruption, l’intimidation et la manipulation, avec le consentement de tous. Un conte cruel, qui nous parle d’aujourd’hui. Tristesses, Compagnie Das Fräulein, Conception, écriture et mise en scène Anne-Cécile Vandalem. Durée 2 h15. Au festival d’Avignon,...
Les Deux Etendards, Lucien Rebatet
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Peut-on encore lire Lucien Rebatet ? Répondre par la négative serait oublier que le pamphlétaire violemment antisémite des Décombres est aussi l’auteur d’un immense roman, Les Deux Etendards, qui s’inscrit dans la lignée de Balzac, de Stendhal et de Proust. Un chef d’œuvre à découvrir. François Mitterrand eut, dit-on, cette formule : «Il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu Les Deux Etendards, et les autres.» On comprend que ce roman ait pu séduire celui qui aimait les livres, les femmes et la France. Tout y est : les interrogations métaphysiques, l’amour fou, la province française aux accents balzaciens, l’entre-deux guerres, la peinture, la musique et la littérature. Et même si l’on peut parfois être irrité par les longs débats théologiques des deux protagonistes, le style alerte entraîne, le lyrisme emporte, l’ironie mordante réjouit. Chef d’œuvre maudit, ébauché en 1937, commencé en 1941 parallèlement à la rédaction des Décombres et aux articles dans Je suis partout, continué en 1944 lors de la fuite au château de Sigmaringen (où Rebatet côtoie Céline), il est achevé en prison à Fresnes dans le quartier des condamnés à mort, puis à Clairvaux où l’auteur en corrige les épreuves transmises clandestinement par sa femme; c’est l’œuvre d’une vie dans laquelle le romancier transpose des événements vécus. Salué lors de sa parution en 1952 par de nombreux auteurs dont Camus, il resta cependant sans succès, livre tabou occulté par le passé collaborateur de son auteur mais réédité régulièrement par Gallimard. Michel Croz, jeune provincial ambitieux, fait ses études à Paris et rêve de gloire littéraire. Puis rupture, tournant inattendu : devenu fou amoureux d’Anne-Marie, jeune lyonnaise que lui présente son ami Régis, Michel part vivre dans cette ville pour se rapprocher d’elle. Mais Anne-Marie aime Régis et est aimée...
La petite Femelle, Philippe Jaenada
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans La petite Femelle, Philippe Jaenada reconstitue avec minutie l’histoire tragique et authentique d’une femme qui a tué son amant. Un portrait en forme de plaidoyer où la rigueur n’exclut pas la fantaisie. Pour avoir tué son ancien amant, Pauline Dubuisson est condamnée en 1953 à la prison à perpétuité après un procès qui connaît un grand retentissement dans la presse et l’opinion publique. Libérée pour bonne conduite après huit ans de prison, elle change de prénom et reprend ses études de médecine à Paris. Mais, rattrapée par son passé, elle part au Maroc où elle exerce comme infirmière. Reconnue à nouveau et repoussée par celui qu’elle s’apprêtait à épouser, elle se suicide en 1963. Au cours des années suivantes, cette histoire inspira à la fois la littérature et le cinéma : dès 1958, En cas de malheur de Simenon est adapté à l’écran par Autant-Lara avec Brigitte Bardot, et surtout en 1960 La Vérité de Clouzot, toujours avec Bardot, remporte un grand succès. Plus récemment, en 1991, Jean-Marie Fitère publie La Ravageuse et Jean-Luc Seigle Je vous écris dans le noir en 2015. Alors, pourquoi un nouveau livre consacré à cette affaire ? Que l’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas ici d’un « roman vrai », d’une fiction à partir d’un fait divers mais de la recherche de la vérité, comme l’annonce l’auteur dans son prologue : «Je m’efforce d’être le plus précis, le plus juste, le plus fidèle qu’on puisse être. » Philippe Jaenada se fait l’avocat pointilleux de l’accusée (celui qui lui a fait défaut lors de son procès puisque son défenseur, le très catholique Paul Baudet, soucieux de sauver l’âme plus que la vie de sa cliente, n’a pas cherché à réfuter l’accusation de préméditation). L’auteur a fouillé les archives, épluché les rapports...
Histoire de la violence, Edouard Louis
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans son deuxième roman, Edouard Louis poursuit son entreprise autobiographique sous une forme plus aboutie et resserrée. Histoire de la violence, c’est l’histoire d’un viol et la réappropriation de cette histoire à travers des récits croisés. Une quête de soi au-delà de la honte. Le soir de Noël, alors qu’il rentre chez lui, Edouard est abordé par Reda. Ils passent la nuit ensemble mais, au matin, la rencontre tourne mal : quand Edouard lui demande de lui restituer les objets qu’il lui a volés, Reda tente de l’étrangler, le menace d’un revolver et le viole. Ce pourrait être un récit sordide ou un ressassement narcissique, mais pour cet héritier de Didier Eribon et d’Annie Ernaux[1] le vécu – fût-il le plus douloureux– devient matériau autobiographique et sociologique. « Porter plainte », comme il le fait dès le lendemain, ce n’est pas se plaindre, c’est se saisir des mots pour se délivrer du fardeau. C’est d’abord une histoire d’attirance entre deux êtres que tout sépare et qui pourtant se ressemblent. Au temps suspendu de l’approche sur la place de la République déserte succède l’évidence et la fulgurance du désir : « Il a su qu’il irait chez lui. Maintenant c’était certain. » Reda/Edouard, deux prénoms inversés pour ces doubles contraires, le kabyle et le picard, celui qui vit de débrouilles et celui qui lit Nietzsche et Claude Simon. Mais tous deux ont connu l’exclusion, la honte, l’humiliation, celle de leur père et de leur mère, et Edouard, auteur de petits vols dans son adolescence, aurait pu devenir Reda. Histoire de la violence sous toutes ses formes – dont le titre fait référence à Histoire de la sexualité de Foucault – ce livre est peut-être avant tout une histoire de la honte : « à croire que ce qu’on appelle la honte est...
A ce stade de la nuit, Maylis de Kerangal
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Le 3 octobre 2013, une embarcation transportant des migrants clandestins africains fait naufrage aux larges des côtes siciliennes. L’écriture naît de cette tragédie, de ce mot entendu à la radio dans la nuit : LAMPEDUSA. Neuf lettres, quatre syllabes qui suscitent l’imaginaire, d’où jaillissent des images contradictoires, des souvenirs et des interrogations sur notre monde et sur la littérature. De quoi Lampedusa est-il le nom ? A cette question Maylis de Kerangal donne des réponses successives, en nous conviant, dans l’intimité nocturne de sa cuisine, à une réflexion par étapes. Paradoxalement, ce mot évoque d’abord un film de légende, Le Guépard de Visconti, adapté du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’auteure confronte ainsi deux figures apparemment inconciliables : celles du prince Salina – le héros du Guépard – et celle du migrant. Mais ces deux images finissent par se rejoindre, puisqu’il s’agit toujours de l’histoire d’un naufrage. Naufrage d’un homme – le prince Salina qui sent la mort approcher –, naufrages des hommes entassés sur des embarcations de fortune et d’un monde : l’aristocratie sicilienne moribonde ou la vieille Europe repliée sur elle-même. De ces deux figures antithétiques du prince et du migrant, Burt Lancaster est l’incarnation à travers ses rôles cinématographiques comme à travers son histoire personnelle : migrant irlandais devenu star de cinéma. Mais le nom de Lampedusa est aussi celui de l’île sicilienne et de l’auteur du Guépard, ce qui amène la narratrice à s’interroger sur les rapports entre les lieux, les livres et leurs auteurs : « Je me dis parfois qu’écrire c’est instaurer un paysage. » Parce qu’un livre est au fond, comme une île, un territoire, un lieu étranger qui devient nôtre lorsqu’on y accoste et qu’on l’investit. Parce que c’est toujours le regard, la mémoire qui transforment les mots en récit et le...