Pour le Vanity Fair, c’est « une Eddie Segdwick coupée avec Gertrude Stein avec un peu de Louise Brooks ». Pour le Los Angeles Times, « une marquise de Sévigné transposée au château Marmont, déjeunant, aimant et pleurant à Hollywood, ce Versailles des Temps modernes ». Version 2015 : une Kim Kardashian avec une machine à écrire et de la […]
The post Jours tranquilles, brèves rencontres, Eve Babitz appeared first on Les heures perdues.
]]>Pour le Vanity Fair, c’est « une Eddie Segdwick coupée avec Gertrude Stein avec un peu de Louise Brooks ». Pour le Los Angeles Times, « une marquise de Sévigné transposée au château Marmont, déjeunant, aimant et pleurant à Hollywood, ce Versailles des Temps modernes ». Version 2015 : une Kim Kardashian avec une machine à écrire et de la cervelle ? Qui est Eve Babitz ? Profitez de la réédition de Jours tranquilles, brèves rencontres chez Gallmeister pour découvrir cet étonnant personnage.
Aujourd’hui, on pourrait dire d’elle que c’est une it-girl, un peu mannequin, un peu graphiste, fêtarde invétérée, dotée du talent d’être toujours là où il faut. Mais ce serait peu valorisant : Eve Babitz a été plus que cela, un mélange irrésistible d’intellectuelle bobo, de LA party girl et d’icône de l’underground californien des années 70. Elle a été la jeune fille qui posa nue avec Marcel Duchamp pour le photographe Julian Wasser, l’entremetteuse à l’origine de la rencontre entre Dali et Frank Zappa, l’amante de Jim Morrison, d’Ed Rusha et d’Harrison Ford. La lecture de ses articles et chroniques fait renaître toute une scène culturelle à la vitalité bouillonnante, biberonné au champagne et à la cocaïne, un monde de nantis à la peau dorée qui ne peut appartenir qu’à Los Angeles. Sa plume, légère et sereine, virevolte de soirées en vernissages, de plages en bars, d’amants en amantes. Il y a une réelle élégance dans cette écriture, faussement limpide et innocente.
Elle s’amuse pourtant de cet étrange statut d’écrivain, beaucoup trop sérieux à son goût. « Mon travail, c’est de regarder par la fenêtre », avoue-t-elle à ceux qui l’interrogent. Elle écrit les matins « où il n’y a rien d’autre à faire », quand elle n’est pas dans les bras d’un homme ou assommée par une foudroyante gueule de bois. Une pose ? Peut-être pas. Pour elle, cette légèreté est l’identité même de Los Angeles : « il est difficile d’être véritablement sérieux quand vous êtes dans une ville qui ne peut même pas ériger un gratte-ciel de peur que la terre ne se réveille un jour et fasse s’écrouler l’ensemble sur la tête de tout le monde». On caresse les mots, les idées, les amants. Dans la première chronique de Jours tranquilles, brèves rencontres, Eve Babitz compare la composition foutraque de son œuvre à la géographie de la ville : impossible d’écrire une histoire sur Los Angeles sans se perdre ou faire demi-tour. « Ce n’est pas une ville, ça », se plaignent ceux qui découvrent la cité des anges. « Alors, est-ce de la littérature, ça ? » semble-t-elle s’interroger à demi-mot.
Jours tranquilles, brèves rencontres est une œuvre faite pour séduire, et en premier lieu celui qu’elle aime. C’est une manœuvre, une stratégie qu’elle décrit avec toute la désinvolture qui la caractérise : « C’est en séduisant un non-lecteur que je compte fixer Los Angeles (…). Je me dois d’être extrêmement drôle et merveilleuse en sa présence, ne serait-ce que pour attirer son attention, et il est dommage de laisser tout cela à la même personne ». L’histoire ne dit pas s’il a apprécié.
Voilà donc une lecture parfaite pour cette fin d’été, légère et sensuelle, gracieuse et subtile, rieuse et mordante. Eve Babitz rappelle Fitzgerald dans son aisance à capturer le monde des très riches, un monde de fêtes, de luxe et d’extravagances – la noirceur en moins. C’est sa scène, elle la traverse en maillot noir, un boa autour du cou. Elle est snob, compare son amie à Madame Verdurin et le panorama de Venice à une toile de Hooper. Elle est méchante, tape sur les hommes, les Républicains, les directeurs artistiques, les designers, les Stones et « leur musique de canette de bière ». Elle est irrésistible. « Tu es parfaite pour Los Angeles, tu sais. Tu es un peu la femme dont tout le monde est amoureux », lui confie son amant.
Virginia Woolf comparait la littérature à une somme de ragots. Savourons donc avec bonne conscience le côté people de ces chroniques. On y croise Stravinsky, Terry Finch, Janis Joplin, Jim Morrison, son « bébé de goudron » (concept fumeux inventé par l’ami gay dont vous trouverez la définition ci-dessous…). Parfait pour cette fin d’été, on vous dit.
Jours tranquilles, brèves rencontres, Eve Babitz, éd. Gallmeister, 2015, 222 pages.
« Les bébés de goudron sont ces gens qui passent leur vie à vous rendre folle en ne réagissant jamais à quoi que vous fassiez, peu importe le genre de démonstration que vous concoctiez pour leurs beaux yeux. Et plus vous tentez d’apprivoiser votre bébé de goudron, plus vous vous enfoncez dans le goudron et plus la situation empire. Jim Morrison fut l’un de mes bébés de goudron, et je comprends maintenant (qu’il est trop tard) qu’il aurait pu être un cher et tendre ami, si dès le départ je n’avais pas créé les germes du goudronnage ».
The post Jours tranquilles, brèves rencontres, Eve Babitz appeared first on Les heures perdues.
]]>On en a lu, ces derniers temps, des biographies romancées – que certains appellent fiction biographique, ou pire, faction[1]. C’est tendance, et surtout, ça ne mange pas de pain. On prend une icône, on construit une trame narrative à partir d’éléments avérés, on laisse libre cours à son imagination pour remplir les blancs, et on […]
The post Eroica, Pierre Ducrozet appeared first on Les heures perdues.
]]>On en a lu, ces derniers temps, des biographies romancées – que certains appellent fiction biographique, ou pire, faction[1]. C’est tendance, et surtout, ça ne mange pas de pain. On prend une icône, on construit une trame narrative à partir d’éléments avérés, on laisse libre cours à son imagination pour remplir les blancs, et on emballe le tout d’une plume efficace et nerveuse. Commode, mais lassant.
Heureusement, certaines d’entre elles font exception, pour la bonne raison qu’elles ne se courbent pas devant leur sujet, mais au contraire, l’affrontent bravement et le soumettent à leur langue et à leur vision. En début d’année, on a salué Le Royaume d’Emmanuel Carrère ; aujourd’hui, on s’incline devant Eroica, de Pierre Ducrozet.
Il fallait du courage[2] pour s’emparer de la vie de Jean-Michel Basquiat, pour se frotter au génie sans se brûler les ailes ; il fallait du talent pour ne pas se faire avaler tout cru par la puissance du mythe. Le jeune romancier avait tout cela.
A la fin des années 70, un soir de défonce, un jeune noir de Brooklyn recouvre les murs de Manhattan de phrases énigmatiques et donne naissance au délire SAMO (Same Old Shit) : s’attaquer au chaos du monde, avaler toute cette vieille merde, devenir la matrice qui aspire le fric et le bourgeois, le grand souffle, le nouveau messie. SAMO intrigue vite. Puis c’est l’ascension, qu’on devine fulgurante : Jay commence à peindre sur de la mousse en polyester et du bois de charpente trouvé dans la rue. Les marchands d’arts, les critiques, les collectionneurs s’excitent, Warhol l’adoube, Madonna s’amourache, il devient l’événement. Ça tombe bien, le garçon a toujours voulu être un héros. Il sera le héros du Street Art, le créateur d’un langage pictural qui dépèce les corps et entaille les phrases, qui recrache toute la saleté et la violence du monde, produits avariés qu’on régurgite parce que c’est trop pour un seul homme. Le garçon capte. Il a des antennes spéciales, ou est-ce une sonde – il saisit le monde entier et il le jette en vrac comme ça sur son bout de bois. Tout absolument tout, rires peurs et cris visions insultes infamies flèches coyotes Casanova Nixon.
C’était écrit : l’ascension, puis la dégringolade. Jay meurt à 27 ans d’une overdose létale. Il a répondu à ce que l’on attendait de lui : du génie, du soufre, du morbide. La combustion interne d’un feu follet. Tout le long du roman, Pierre Ducrozet envisage cette idée d’artiste maudit avec une distance railleuse. Vous voulez de l’artiste maudit ? Il faudra vous contenter de ce que je vous donne : on voudrait vraiment ne pas tomber dans les panneaux : artiste tourmenté /stop/ vie folle /stop /douleur / fulgurances / stop / création intense/ stop/ mort tragique / à vingt-sept ans si possible. On fait ce qu’on peut pour ne pas tomber, mais les faits sont là. La drogue est traitée sans romantisme. Elle est la vie de Jay. C’est tout.
L’itinéraire du junky constitue l’armature d’Eroica, mais il n’est que la logique, et non le sens du récit: l’écriture devient magistrale quand elle met à jour les processus de création, quand elle abandonne les aléas pour se concentrer sur l’essentiel : l’artiste face à sa peinture. Quand le romancier décrit Jay peignant Pégase, ses mots épousent le rythme du large pinceau noir, remplissent la page blanche avec la même urgence, répondent à la même promesse, engagent le même combat : sa danse devant la toile était celle du guerrier plantant sa lame dans le corps des adversaires. Il pensait créer ; il combattait. Pantomime que son corps exécutait comme naturellement sans se douter qu’il reproduisait ainsi l’immémorial rituel : observer, s’armer, fondre sur sa proie.
En dépit de son indéniable modernité, ce récit se lit comme un classique. On pense finalement moins à Burroughs qu’à Balzac – même si l’auteur de Junky constitue une référence explicite. Comme dans la Comédie humaine, la ville et le personnage tendent à se confondre : bientôt on ne distingue plus Jay des rues de sa ville. Teintes grises, manières cool et saccadées, magma intérieur et vitesse d’exécution, ce qui est à l’un est à l’autre. La dernière scène du roman, au cimetière, rappelle dans son âpreté tragique les dernières pages du Père Goriot. Elle émeut aux larmes.
Qui est ce jeune artiste qui vient sabrer une bouteille de champagne sur la pierre tombale et espère ainsi recueillir un peu de la force de celui qui gît là ? Au regard de la qualité d’Eroica, tout porte à croire qu’il s’agit du romancier.
Pierre Ducrozet, Eroica, Grasset, avril 2015, 272 pages.
[1] Faction, condensé des mots anglais fact et fiction
[2] Rien d’étonnant alors à ce que ce roman ait été choisi pour inaugurer la nouvelle collection dirigée par Charles Dantzig chez Grasset dont « le courage » est à la fois le nom et la valeur centrale.
The post Eroica, Pierre Ducrozet appeared first on Les heures perdues.
]]>Ecrit avec le souci d’éviter l’auto-complaisance, l’essai autobiographique de Nancy Huston propose une forme éclatée qui renouvelle en profondeur les codes du genre. En dépit de quelques artifices parfois gênants, l’exercice est réussi et souvent très émouvant. Autant le confesser tout de suite : j’entretiens avec l’œuvre de Nancy Huston un rapport très personnel, qui […]
The post Bad Girl, Classes de littérature, N. Huston appeared first on Les heures perdues.
]]>Ecrit avec le souci d’éviter l’auto-complaisance, l’essai autobiographique de Nancy Huston propose une forme éclatée qui renouvelle en profondeur les codes du genre. En dépit de quelques artifices parfois gênants, l’exercice est réussi et souvent très émouvant.
Autant le confesser tout de suite : j’entretiens avec l’œuvre de Nancy Huston un rapport très personnel, qui peut expliquer l’apparition de ce « je ». Impossible de feindre une distance artificielle, impossible d’aborder ce livre comme je le fais habituellement avec les autres.
Nancy Huston m’a occupée pendant une année universitaire (« Lien entre création littéraire et condition féminine dans Cantique des Plaines et Instruments des Ténèbres » de Nancy Huston » – le titre seul me fait frémir de honte aujourd’hui), mais elle a surtout été une inspiratrice, un mentor, pourrait-on dire, si le terme n’était pas aussi sexué. Tout au long de la vingtaine, j’ai suivi toutes ses publications et je l’ai aimée, démesurément : son tempérament iconoclaste, sa conception si singulière du féminisme, son obsession de la marge, son rejet du nihilisme, tout m’enthousiasmait. Ces dernières années, je me suis un peu éloignée d’elle, elle m’a même souvent agacée. Je n’ai même pas lu son dernier roman, c’est dire. Mais au regard de tout ce chemin tracé ensemble, il m’était difficile de passer à côté de ce qu’on pourrait appeler communément son autobiographie.
Comme son nom l’indique, Bad Girl, Classes de littérature retrace une trajectoire littéraire : comment une enfant née à Calgary au Canada est devenue romancière et essayiste de langue française ? Quels sont les chemins qui peuvent conduire à changer de pays, de langue pour s’ « autoriser » enfin ? Quelles sont les névroses nécessaires à la création ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit, et Nancy Huston ne craint pas les raccourcis : elle est devenue écrivain parce que sa mère l’a abandonnée enfant. Pour elle, « quatre-vingt-dix pour cent de son œuvre » provient de cet après-midi de l’été 1959 où la mère, accablée de douleur, a tendu un bouquet de marguerites à une autre femme et, dans un même geste, lui a confié ses enfants. Petite fille hyperdouée et profondément angoissée, elle lit sans arrêt. Les voix des autres se déversent sur elle et la remplissent. Elle s’accroche à ces voix « comme à une drogue, une perfusion intraveineuse ». Parfois, c’est sa propre voix qu’elle fait résonner, l’enfant se parle à la troisième personne et devient personnage. Tout ce petit monde jacasse et [lui] tient compagnie, dirait Samuel Beckett.
Dans presque tous ses romans, l’écrivain poursuit cette conversation et utilise le « tu » pour s’adresser à des personnages qu’elle désire toujours plus près d’elle. Le « il » ou le « elle » mettrait trop de distance, et elle n’en veut plus, de la distance. Cette pseudo-autobiographie ne déroge pas à la règle : elle s’adresse au fœtus qu’elle a été (qu’elle nomme Dorrit, allez savoir pourquoi) et lui raconte le roman de sa vie future. Cette idée de fœtus m’a peu emballée, voire même gênée : non seulement le dispositif sent l’artifice à plein nez, mais pire, il sous-tend des considérations vaseuses sur l’importance du lien intra-utérin. Voilà un peu le défaut de la Nancy Huston de ces dernières années : le propos ne manque pas d’allant et de fougue, mais parfois, ça déborde sacrément… En témoigne seulement cette comparaison douteuse entre la procréation médicalement assistée et les plus grandes atrocités de l’histoire : « Toujours la maîtrise doit être contrebalancée par le mystère. Chassez le mystère, il vous restera Kolyma, Sobibor, Fort Mc Murray, Sabra et Chatila ».
Allez, Nancy, s’il vous plaît, chassez tous ces artifices, tous ces excès, c’est dans la retenue et le doute que je vous aime le plus. A la lecture des premières pages, j’ai même cru devoir définitivement vous enterrer, et puis, je vous ai retrouvée.
Il y a en effet quelque chose d’infiniment touchant dans l’appel au secours de cette Bad Girl qui se croit coupable de son abandon, devenue une femme de lettres vieillissante qui tente désespérément de recoller les morceaux. Dans son dispositif même, l’autobiographie révèle une identité impossible à recomposer : l’écriture à la deuxième personne marque au contraire l’impossibilité d’assumer le « je ». Pour le coup, le « tu » n’a plus rien d’artificiel: il résonne âprement aux oreilles du lecteur, peu à peu submergé par l’émotion. A la fin du livre, Nancy Huston enfonce le clou, reprenant à son compte les mots de Roland Barthes : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman ».
Bad Girl, Classes de littérature, Nancy Huston, Actes Sud, 2014, 263 pages.
The post Bad Girl, Classes de littérature, N. Huston appeared first on Les heures perdues.
]]>Pas de risque de spoiler : tout le monde sait que la Nouvelle amie de François Ozon est un travesti, incarné par Romain Duris. Le suspense ne réside pas là, mais dans les multiples imbroglios sentimentaux que cette découverte va provoquer dans l’entourage du personnage. Un très beau film qui renoue avec l’esthétique du conte […]
The post Une Nouvelle amie, François Ozon appeared first on Les heures perdues.
]]>Pas de risque de spoiler : tout le monde sait que la Nouvelle amie de François Ozon est un travesti, incarné par Romain Duris. Le suspense ne réside pas là, mais dans les multiples imbroglios sentimentaux que cette découverte va provoquer dans l’entourage du personnage. Un très beau film qui renoue avec l’esthétique du conte pour mieux parler d’amour.
Claire et Laura se connaissent depuis l’enfance, elles rencontrent quelqu’un, se marient… puis Laura décède prématurément. A son enterrement, Claire (impressionnante Anaïs Demoustier), dévastée, promet de prendre soin de son mari et de sa petite fille. Ce qu’elle fera, bien sûr, mais pas tout à fait de la manière dont elle l’entendait. Une histoire d’adultère ? On pourrait s’y attendre, mais on est chez Ozon, et tout est bien plus retors. Préoccupée par l’état mental de David qui ne donne pas de nouvelles depuis l’enterrement, Claire s’introduit chez lui et le découvre donnant le biberon à la petite… habillé en femme. David passe rapidement à confesse : il a toujours aimé ça, se travestir, Laura l’acceptait bien, et depuis qu’elle est morte, il a replongé.
Ambiguïté, tel est le maître-mot du cinéma d’Ozon et Une nouvelle amie ne déroge pas à la règle : le travestissement est-il le signe d’un amour absolu, dans lequel on viendrait se confondre avec l’absent ? Est-ce le déguisement qui permet d’accomplir le travail de deuil ? Est-ce une façon d’aider le bébé à supporter l’absence de sa mère ? Ou est-ce plutôt la réalisation d’un fantasme plus ancien que la perte de l’être cher viendrait autoriser ? L’une des grandes habiletés du scénario repose sur ce lien fécond entre le deuil et le travestissement : les deux idées se mêlent, se confondent et empêchent toute interprétation univoque. La première séquence annonce bien cette esthétique du trouble : on maquille un visage, on habille un corps, mais à qui appartiennent-ils ? A une adolescente qui se prépare à sortir ? A une mariée prête à convoler ? Non… à une jeune femme destinée à la mise en bière. Les fausses-pistes font la matière du film et jouent avec les réflexes conditionnés du spectateur.
Ozon réussit aussi à déplacer la focale sans modifier le cadrage : alors qu’on l’envisageait au début comme le personnage secondaire, Claire prend de plus en plus de place, s’épaissit et concentre bientôt toute l’attention. On l’a pourtant bien lissé, ce personnage, pas un cheveu qui dépasse, pas une tache sur le col blanc, Claire est l’archétype de la jeune fille bien comme il faut. Et pourtant… Plus l’intrigue avance, et plus elle est troublante, plus troublante que le travelo même. Pourquoi se fait-elle complice d’un comportement qu’elle juge elle-même déviant, pervers ? Pourquoi cette « nouvelle amie » ? Est-ce un banal désir freudien ? Un désir morbide pour Laura, celle qu’elle a tant aimée ?
La séquence dans la boîte de nuit permet d’avancer une autre hypothèse. Dans ce lieu où les corps et les genres se mêlent dans une liberté complète, débarrassés de toute pression extérieure, les êtres se révèlent. Un travesti se tortille sur un play-back. Dolan nous a fait aimer « On ne change pas » de Céline Dion, Ozon nous émeut aux larmes sur « Naître une femme » de Nicole Croisille. Tout ce qui constitue le grotesque de la situation se trouve sublimé par la pureté des regards portés sur la scène : elle est magnifique, cette diva, et tous les freaks de la salle sont saisis. Mais au fil de la séquence, une évidence s’impose : au contact du travesti (joué tout en finesse par Romain Duris), c’est Claire qui devient femme. Un rouge à lèvres, un décolleté, une robe rouge, autant de signes d’une certaine féminité nouvellement conquise.
Cette esthétique du trouble, de l’ambivalence, a bien sûr une dimension politique : il n’y a pas de gens normaux, et d’autant moins ceux qui en ont l’apparence. A ceux qui voudraient abroger la loi sur le mariage homosexuel, Ozon répond par une image qui sert aussi de conclusion : un homme, une femme enceinte et un enfant s’éloignent en nous tournant le dos. Quelle est la relation qui les unit ? On n’en sait rien, et au fond, on s’en fout. Peu importe le lien, pourvu qu’il y ait l’amour.
The post Une Nouvelle amie, François Ozon appeared first on Les heures perdues.
]]>Le Constellation, « nouvelle comète d’Air France », se crashe sur l’île de Santa Maria dans l’archipel des Açores le 27 Octobre 1949. Peut-être connaissez-vous l’événement pour son côté people (Marcel Cerdan, le célèbre boxeur, sommé d’annuler son billet de paquebot pour rejoindre au plus vite Edith Piaf à New-York…). Le roman d’Adrien Bosc propose soixante-cinq […]
The post Constellation, Adrien Bosc appeared first on Les heures perdues.
]]>Le Constellation, « nouvelle comète d’Air France », se crashe sur l’île de Santa Maria dans l’archipel des Açores le 27 Octobre 1949. Peut-être connaissez-vous l’événement pour son côté people (Marcel Cerdan, le célèbre boxeur, sommé d’annuler son billet de paquebot pour rejoindre au plus vite Edith Piaf à New-York…). Le roman d’Adrien Bosc propose soixante-cinq ans plus tard le récit complet du dernier vol du F-BAZN et de ses passagers. Un premier roman remarquable, dont on ne peut que saluer l’ambition et la maîtrise.
Un essai ou un roman? L’aspect documentaire de Constellation ne saurait masquer la part laissée à l’imaginaire. Le livre alterne les chapitres consacrés au récit du vol lui-même et de courtes biographies des passagers qu’on devine partiellement romancées. Il y a les Vies illustres de Marcel Cerdan le boxeur et de Ginette Neveu, célèbre violoniste, mais aussi toutes ces Vies Minuscules restées dans l’ombre : citons celle d’Amélie, petite ouvrière bobineuse de Mulhouse appelée à Détroit par sa marraine, directrice d’une usine de bas-nylon qui l’a désignée comme son unique héritière ; celle d’Edward Lowenstein, directeur de tannerie fraîchement divorcé, mais fermement décidé à un ultime aller-retour pour tenter une réconciliation ; celle de Jenny Brandière, propriétaire de champs de canne à sucre qui ramène sa fille très grièvement accidentée à Cuba ; celles de ces cinq bergers basques qui émigrent pour revenir quelques décennies plus tard s’installer dans la vallée. Des bribes, des fragments d’existences qui sont autant d’épiphanies romanesques, autant de romans possibles, mais empêchés. A travers ces biographies fragmentées, Adrien Bosc construit les figures très modernes d’un romanesque sans roman. Il se détache des longs récits pour faire scintiller chaque étoile de manière presque autonome.
Car c’est d’une « constellation » qu’il s’agit – Adrien Bosc ne cesse de jouer sur la polysémie du mot – et le roman interroge sans cesse les relations qui unissent ces étoiles. Pourquoi ces destins ont-ils convergé vers la catastrophe ? Quel redoutable enchaînement de causes a-t-il conduit au drame? Pourquoi certains sont-ils montés dans l’avion, alors que d’autres ont été miraculeusement évincés du voyage ? Edith et Philippe Newton, un jeune couple d’américains de retour d’une lune de miel, comme Madame Erdmann, doivent leur salut au caprice d’Edith Piaf : ils restent sur le tarmac, laissant la priorité au champion. Y a–t-il une logique à l’œuvre dans cet enchaînement d’événements ? Doit-on au minimum s’en remettre à cette idée de « hasard objectif » chère à André Breton ? Constellation multiplie en effet les expériences de synchronicités entre les personnages, les lieux, les dates, les objets même. Certaines sont très convaincantes. On pense à l’union par-delà la mort des deux plus grandes musiciennes de l’après-guerre, Ginette Neveu et Kathleen Ferrier. Le 8 Novembre 1849, à la même heure, le corps de l’une est rapatrié sur Paris escorté par les motards de la garde nationale, tandis que l’autre donne pour la première fois un récital à Paris, salle Gaveau : « Magie de la synchronicité, deux femmes prodiges, l’une violoniste, l’autre contralto, réunies par la coïncidence d’une date, se répondent de profundis ». Parfois cependant, Bosc tire trop les ficelles et les rapprochements semblent artificiels : le F-BAZO, l’avion censé refaire le trajet du « Constellation » pour déterminer les causes de l’accident, est vendu un 27 octobre, jour même de la date du crash. Soit. L’auteur le reconnaît lui-même : « Un concours infini de causes détermine le plus improbable résultat. Quarante-huit personnes, autant d’agents d’incertitudes englobées dans une série de raisons innombrables, le destin est toujours une affaire de point de vue ».
Le roman excelle parce qu’il fait renaître tout un monde de ses cendres. Les quarante-huit passagers sont « un panel représentatif » de la société occidentale de l’après-guerre et Adrien Bosc parvient bien à saisir le climat de l’époque. A l’intérieur de cet avion, on sent l’odeur du bœuf en gelé et du navarin d’agneau – les premiers repas chauds servis en vol ! -, on entend les pilotes évoquer leurs exploits dans l’aéronavale, on espionne le journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace qui interroge Marcel Cerdan sur son état de forme, son camp d’entraînement, son programme, on devine les bas nylons sous les jupes des hôtesses de l’air… Un parfum vintage doux, mais amer. Comment, en effet, ne pas voir dans le F-BAZN une victime expiatoire, réduite en miettes, pulvérisée, parce qu’elle incarne les valeurs de la modernité ? Ce crash ne condamne-t-il pas tous ceux qui, pour paraphraser Valéry dans Le Bilan de l’Intelligence, ne supportent plus la durée, ne savent plus féconder l’ennui ?
Adrien Bosc, Constellation, éd. Stock, 2014, 193 pages.
The post Constellation, Adrien Bosc appeared first on Les heures perdues.
]]>August est le dernier récit de Christa Wolf, l’écrivain le plus célèbre de l’ex-République Démocratique Allemande. Ses mésaventures politiques – on lui a beaucoup reproché son ambivalence face au régime communiste- ont longtemps masqué l’importance de sa voix artistique en Allemagne. Pourtant, Christa Wolf est l’une des plus grandes, et la lecture de ce bref […]
The post August, Christa Wolf appeared first on Les heures perdues.
]]>August est le dernier récit de Christa Wolf, l’écrivain le plus célèbre de l’ex-République Démocratique Allemande. Ses mésaventures politiques – on lui a beaucoup reproché son ambivalence face au régime communiste- ont longtemps masqué l’importance de sa voix artistique en Allemagne. Pourtant, Christa Wolf est l’une des plus grandes, et la lecture de ce bref récit peut suffire à vous en convaincre. Prenez une heure pour lire August, et vous vous plongerez pendant votre été dans Trames d’enfance ou Le ciel partagé.
August a été écrit au début de l’été 2011, quelques mois avant sa mort, et ces quelques pages ont la délicatesse d’une dernière révérence parfaitement maîtrisée. L’émotion est contenue dans un étau que la dédicace finale à son mari, l’écrivain Gerhard Wolf, réussit seule à desserrer : « Que pourrais-je t’offrir, très cher, sinon quelques pages écrites où sont recueillis bien des souvenirs de l’époque où nous ne nous connaissions pas encore ? (…) C’est à peine si je puis dire « je », la plupart du temps, c’est « nous ». Sans toi, je serais quelqu’un d’autre. Mais je ne t’apprends rien. Les grands mots ne sont guère de mise entre nous. Juste ceci : j’ai eu de la chance ». Tout ici a un parfum de crépuscule : l’auteur se demande ce qu’est devenu l’un des personnages rencontrés dans son roman autobiographique Trames d’Enfance écrit vingt-cinq ans plus tôt. A quoi a pu ressembler la vie d’August, ce jeune garçon un peu gauche, presque simplet, croisé dans un château transformé en sanatorium peu après la fin de la guerre, et qui concevait pour elle un si étrange amour?
Le récit navigue entre deux temporalités, les souvenirs déjà lointains du sanatorium et le présent d’un trajet au volant d’un car de tourisme : August a maintenant soixante-huit ans, il transporte un groupe pour l’une des dernières fois, le voyage est propice aux divagations. Le dispositif n’a rien d’original. Ce qui l’est davantage, c’est cette manière de déplacer le regard autobiographique : Christa Wolf vole le regard d’August, personnage jusque là très secondaire, pour donner à voir les restes de sa propre mémoire. Ce château est un mauvais endroit pour des malades des poumons, trop froid, trop humide, trop venteux ; les morts disparaissent en catimini le soir venu, les chambres restées vides au matin ont une odeur âcre que les vivants reconnaissent aisément ; parfois, l’on tente de conjurer le sort en allant toucher, en pleine nuit, les pieds des cadavres exposés dans la chapelle. August a huit ans, il a perdu sa mère lors du bombardement d’un train, et il s’accroche à la vive Lilo comme un naufragé à sa bouée. Lilo, c’est Christa Wolf elle-même : elle s’observe à travers les yeux de ce jeune gamin, et ce portait en biais est particulièrement émouvant. Douce et aimante, peu conformiste, un brin rebelle, la jeune fille est le repère essentiel du petit garçon : elle assure les conditions psychologiques de sa survie. A la mort d’une petite fille particulièrement aimée, Lilo perd pied… et l’enfant s’écroule à son tour.
Ce dispositif au miroir rappelle Trames d’enfance : toute l’œuvre de Christa Wolf exprime avec une grande acuité le paradoxe du rapport à soi-même. Quel lien existe-il entre moi et l’enfant que je fus ? Le sentiment d’identité est impossible, et jamais, même dans cet ultime récit, l’écrivain n’aura pu se raconter sans se mettre à distance. Cette étrangeté à sa propre enfance naît bien sûr de la fracture historique du troisième Reich, et Christa Wolf ne s’en est jamais cachée : « Pour moi, cette époque, c’est le Tertiaire. Il faut apprendre à faire parler les pétrifications, induire à partir d’empreintes l’existence passée de formes vivantes que l’on ne peut plus deviner ». Comment concevoir des souvenirs d’enfance quand tout un peuple est amnésique, est devenu expert dans l’art de fermer les yeux et d’occulter tout ce qui pourrait nourrir sa mauvaise conscience ?
Mais laissons-là ces interprétations psycho-historiques qui peuvent paraître vaseuses : August est surtout un magnifique récit, dans lequel s’inscrit une vision du bonheur très personnelle, intimement liée à la conjugalité. A la fin du roman, August rentre chez lui au terme de son voyage, il se retrouve seul dans un appartement vide : « On s’y fait, lui ont-ils dit, lorsque Trude est morte. August ne s’y est pas fait ». Pourtant, l’heure est à l’apaisement : « Il n’est pas toujours en mesure de mettre des mots sur ce qu’il ressent. Il éprouve une sorte de reconnaissance d’avoir connu dans sa vie quelque chose qu’il appellerait, s’il pouvait l’exprimer, la chance ». Rappelez-vous, « la chance », c’est en ces mêmes termes que, dans sa dédicace, Christa Wolf désignait pudiquement l’amour porté à son mari. En allemand, Das Glück veut dire tout à la fois « chance » et « bonheur ». Heureux choix des traducteurs qui respectent cette conception pudique et intimiste du bonheur individuel.
Laissons les derniers mots à Rilke, cité par Gerhard Wolf dans sa postface à August :
« Eteins moi les yeux, je saurai te voir,
Bouche-moi les oreilles : je saurai t’entendre,
Et même sans pieds saurai venir à toi,
Et même sans bouche t’invoquer encore.
Brise-moi les bras, je te saisirai
Avec mon cœur comme une main,
Obstrue ce cœur, mon cerveau battra,
Embrase ce cerveau,
Mon sang te portera ».
trad. Jean-Claude Crespy, in Rainer Maria Rilke, Œuvres poétiques et théâtrales, Paris, Gallimard, coll. « Bibl.de la Pléiade ».
Christa Wolf, August, éd. Christian Bourgeois, 2014, 43 pages.
The post August, Christa Wolf appeared first on Les heures perdues.
]]>L’invention du spiritisme dans l’Amérique puritaine de la fin du XIXème… Quel sujet ! Surtout quand on sait que le maître d’œuvre de cette vaste entreprise est Hubert Haddad, le styliste délicat du Peintre d’Eventails, un auteur que l’on aime. Et pourtant, Théorie de la Vilaine Petite Fille est le grand roman raté d’un grand écrivain. […]
The post Théorie de la vilaine petite fille, Hubert Haddad. appeared first on Les heures perdues.
]]>L’invention du spiritisme dans l’Amérique puritaine de la fin du XIXème… Quel sujet ! Surtout quand on sait que le maître d’œuvre de cette vaste entreprise est Hubert Haddad, le styliste délicat du Peintre d’Eventails, un auteur que l’on aime. Et pourtant, Théorie de la Vilaine Petite Fille est le grand roman raté d’un grand écrivain. On s’explique.
Hubert Haddad choisit de raconter l’histoire vraie de Kate et Margaret Fox, deux fillettes de l’Amérique profonde qui, investies du pouvoir de communiquer avec l’au-delà, vont inventer le spiritisme sans même s’en rendre compte. Quand Mister Splitfoot (« Pied fourchu »), fantôme d’un représentant de commerce lâchement assassiné dans leur petite maison, les prend en amitié, leur existence s’en trouve entièrement redessinée. Animée d’un solide esprit mercantile et appuyée par les banquiers de Wall Street, la sœur aînée, Leah, prend les deux enfants sous sa coupe et organise des séances publiques de démonstration qui se vendent comme des petits pains. Le spiritisme devient un phénomène de société qui dépasse rapidement les frontières d’Hydesville et remue toute l’Amérique. Le Vieux Continent est bientôt lui aussi gagné par la fièvre. Mais la mécanique du succès ne tarde pas à grincer, les deux jeunes filles perdent pied, victimes expiatoires de la course au progrès qui caractérise l’Amérique de ces années-là. Le libéralisme se propage à toute vitesse dans le monde du surnaturel, les charlatans les plus habiles s’en mettent plein les poches, et les sœurs Fox finissent pitoyablement. Un sujet terriblement alléchant.
L’ambition est là : Théorie de la Vilaine Petite Fille a des accents balzaciens. Le roman est monstrueux, il avale les lieux, les époques, les personnages avec un appétit d’ogre. Hubert Haddad a le désir de peindre toutes les facettes de cette folle Amérique : esclavagisme, abolitionnisme, féminisme, construction des premiers gratte-ciel, spiritisme… L’innocence des sœurs Fox rappelle celle de Lucien Rubempré, jeune héros des Illusions Perdues : jetées dans un monde dont elles ne maîtrisent pas les codes par une sœur à l’ambition comparable à celle de Rastignac, elles ne tardent pas à déchanter. Le sujet, la profondeur, le style, le brio même, tout est là. Mais le lecteur n’éprouve aucune satisfaction, aucune émotion. Il s’ennuie. Si votre serviteur n’avait pas cet article à écrire, s’il n’avait pas fait vœu d’honnêteté intellectuelle, il abandonnerait. Pour sûr.
Qu’est-ce qui ne passe pas ? D’abord, l’aspect tourbillonnant de ce roman total qui, loin d’aspirer le lecteur dans son mouvement, le laisse au bord de la route, pantelant. La somme des personnages empêche toute proximité : on s’occupe d’eux dans un bref passage, puis on les abandonne, avant de les retrouver une centaine de pages plus loin. Entre-temps, le lecteur les a oubliés, et il faut opérer un véritable effort de recoupement pour les identifier. Ils ne marquent pas, malgré leur évident potentiel. Les personnages des sœurs sont comme noyés au milieu de toute cette foule : ils n’ont pas assez d’espace pour gagner en consistance, en profondeur.
Par ailleurs, le roman est saturé de références érudites : l’aspect documentaire prend rapidement le pas sur le romanesque. Tout est extrêmement référencé, brillamment rapporté, mais le lecteur étouffe peu à peu…et n’apprend finalement pas grand-chose. Les nombreuses références sont envisagées comme de simples prérequis, elles ne sont jamais explicitées. Hubert Haddad brosse un portrait panoramique au détriment d’une analyse fine. Le lecteur, lui, reste sur sa faim : par exemple, il aurait bien aimé savoir pourquoi le spiritisme ne pouvait naître que chez des femmes de l’Amérique puritaine ; on mentionne cet état de fait, mais on ne l’explique pas. Débrouillez-vous.
Finalement, tout est histoire de réception. Ce roman est parfait, mais pour l’auteur seulement. Même chose pour le style. Hubert Haddad est un styliste admirable, aucun doute là-dessus, mais mon dieu, quel besoin d’écrire « à sa dextre » quand « à sa droite » serait tout aussi efficace ? La maîtrise formelle est telle qu’elle met à distance et nuit à l’émotion. Nous sommes impressionnés, mais pas touchés. Un seul exemple peut-être. Prédicateur de l’école méthodiste, Alexander Cruik se rend à Hydesville pour sauver les consciences échauffées par le spiritisme des sœurs Fox : « Si, par exception dans le conseil ecclésial méthodiste plutôt enclin à la sobriété en tout chose, son franc-parler et ses fantaisies de mage inspiré avaient été agréés pour services rendus, il savait d’expérience que l’équilibre tenait à presque rien chez ces défricheurs hallucinés, pionniers et fils de pionniers aux barbares appétences et nonobstant pourfendus de superstition et portés par une candeur de croisés ». Ouf. « Barbares appétences » et « nonobstant pourfendus de superstition » sur la même ligne, c’est à la limite du supportable ! On sent bien l’ironie, la quête du mot rare et désuet, mais l’auteur fait ici cavalier seul : il nous a laissés depuis bien longtemps sur le bas-côté, avec l’amère impression d’être un imbécile notoire. Dommage.
Hubert Haddad, Théorie de la vilaine petite fille, Zulma, 2014, 397 pages.
The post Théorie de la vilaine petite fille, Hubert Haddad. appeared first on Les heures perdues.
]]>
Julie Wolkenstein n’a pas choisi de traduire Ethan Frome. Le roman d’Edith Wharton lui tombe dessus un soir d’hiver, alors qu’elle est immobilisée par une jambe cassée : comme elle, le héros éponyme est estropié du côté droit. Curieux hasard qui n’explique pas entièrement la fascination que le personnage exerce sur elle : « En commençant, j’avais oublié […]
The post Ethan Frome, Edith Wharton appeared first on Les heures perdues.
]]>
Julie Wolkenstein n’a pas choisi de traduire Ethan Frome. Le roman d’Edith Wharton lui tombe dessus un soir d’hiver, alors qu’elle est immobilisée par une jambe cassée : comme elle, le héros éponyme est estropié du côté droit. Curieux hasard qui n’explique pas entièrement la fascination que le personnage exerce sur elle : « En commençant, j’avais oublié qu’Ethan était handicapé du côté droit, comme moi, c’était trop beau. Je me suis laissé happer par le texte que j’ai traduit d’une traite, portée par son intensité dramatique ».
Edith Wharton nous a habitués aux salons new-yorkais, et les pérégrinations de la jeune Lili Chez les Heureux du monde n’ont apparemment pas grand-chose à voir avec le chemin de croix du jeune Ethan sur les cimes glacées de la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, ce court roman atypique témoigne des mêmes tourments, des mêmes obsessions : comment échapper à la rigidité de la morale et vivre enfin ? Est-ce même possible ? A cet égard, Ethan Frome est d’une noirceur absolue : pas une once d’ironie pour colorer l’ensemble, le tableau est sans nuance, même de gris. Souvent, on pense aux heures les plus sombres de Maupassant, à toutes ses nouvelles d’un réalisme si âpre qu’elles en deviennent presque insupportables (« Première neige », par exemple).
A la fin du XIXème siècle, Ethan Frome est un jeune homme pauvre qui aime les livres et rêve de voyages. Mais ses aspirations pèsent bien peu face aux laborieuses contraintes qui sont les siennes : la vieille ferme et la scierie, douloureux héritages qui coûtent tant d’efforts et ne rapportent rien ; la femme, vieille cousine épousée au gré des circonstances, hypocondriaque sévère qui transporte sa morbidité dans chacun de ses menus déplacements. C’est une vie sans vie, une existence rugueuse, comme le décor qui l’enveloppe. Mais Ethan tombe amoureux et tout bascule en trois jours. La pulsion de vie vient irriguer ce coeur sec et dégeler ce corps immobile.
Mais les premières pages du roman ont annoncé un « drame » et le lecteur sait que la fatalité pèse sur les humbles. La question n’est pas de savoir si Ethan et Mattie vont pouvoir vivre leur amour au grand jour, mais plutôt d’anticiper la nature de l’événement qui viendra y mettre fin. Le lecteur avale les pages en un souffle, mis en tension par une narration qui ménage savamment les effets d’attente. Rien que du très classique, pensez-vous. Et pourtant, tout est faussement clair, faussement ingénu. Le dénouement est un choc brutal dont les réminiscences vont peser lourd sur le ventre. Qu’est-ce qui peut bien être pire que la mort des jeunes héros ? Edith Wharton écrit l‘épilogue le plus sombre et le plus désespéré de notre mémoire de lecteur.
De la littérature pour neurasthéniques ? Un roman pour sombrer définitivement ? Vous auriez tort de l’envisager ainsi et de tourner le dos à cette lecture. Ethan Frome est réconfortant, parce qu’il fait partie de ces grands romans qui transcendent l‘idée même de bonheur ou de malheur. Le style est sublime, d’une limpidité et d’une justesse trop rares. Face à tant de beauté, le lecteur ne peut que se réjouir d’exister.
Edith Wharton, Ethan Frome (1911), Nouvelle traduction de Julie Wolkenstein, éd. P.O.L., 2014, 224 pages.
The post Ethan Frome, Edith Wharton appeared first on Les heures perdues.
]]>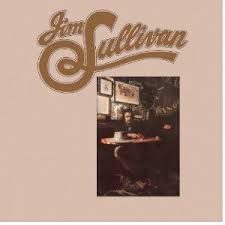
Tanguy Viel nous prévient dès les premières pages de La disparition de Jim Sullivan : il va écrire un roman américain, ou plutôt un roman international, en bref, quelque chose dont la résonance dépassera les frontières de l’hexagone. Parce qu’il faut bien l’avouer : « même dans le Montana, même avec des auteurs du Montana qui s’occupent de […]
The post La Disparition de Jim Sullivan, Tanguy Viel appeared first on Les heures perdues.
]]>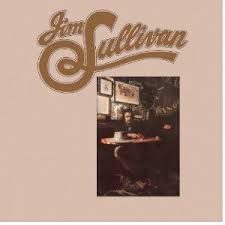
Tanguy Viel nous prévient dès les premières pages de La disparition de Jim Sullivan : il va écrire un roman américain, ou plutôt un roman international, en bref, quelque chose dont la résonance dépassera les frontières de l’hexagone. Parce qu’il faut bien l’avouer : « même dans le Montana, même avec des auteurs du Montana qui s’occupent de chasse et pêche et de provisions de bois pour l’hiver, ils arrivent à faire des romans qu’on achète aussi bien à Paris qu’à New-York (…). Nous avons un pays qui est deux fois le Montana en matière de pêche et de chasse et nous ne parvenons pas à écrire des romans internationaux ». Le défi est lancé : en dépit de sa franchouillardise, Tanguy Viel va essayer de voir grand.
On comprend vite que cette intention est fallacieuse: La Disparition de Jim Sullivan s’apparente plutôt à une dissection méthodique et amusée des codes du genre. L’auteur choisit de se mettre en scène en train d’écrire, exhibant ainsi la mécanique du roman US avec une ironie corrosive. La phrase est longue, méandreuse, elle enchaîne les liens de subordination pour mieux souligner les soubresauts de cette conscience en plein processus de création. Tanguy Viel use et abuse de la prétérition, très utile pour faire ressortir les ficelles : « Même si je n’aime pas trop les flash-backs, je sais qu’il faut en passer par là, qu’en matière de roman américain, il est impossible de ne pas faire de flash-backs ». Le procédé est efficace, mais pas révolutionnaire. Dans les années cinquante, les écrivains du Nouveau-Roman appliquaient cette même recette pour décongestionner le roman traditionnel hérité du réalisme balzacien.
Et pourtant, Tanguy Viel excelle : la petite voix ironique qui se superpose à la narration est absolument tordante, et le lecteur s’amuse tout autant que l’auteur. Espiègle et mutine, elle passe tous les poncifs à la moulinette. Le héros, Dwayne Koster, est un professeur de littérature à l’université. Sa thèse ? Moby-Dick et son influence dans le roman contemporain. Son problème ? Sa femme ou plutôt son ex-femme, qui a pour amant un type qu’il déteste, un collègue, spécialiste de la Beat Generation – plus glamour, cela va sans dire… S’ensuit une longue descente aux enfers, mêlant alcool, porno, guerre en Irak, trafics d’œuvres d’art, course-poursuite avec le FBI et hôpital psychiatrique… La scène d’ouverture elle-même est un mélange de savoureux clichés dont l’auteur se régale. Dwayne Koster espionne le domicile de Susan au volant de sa vieille Dodge. A l’intérieur « une bouteille de whisky sur le siège passager, des cigarettes en pagaille dans le cendrier plein, différents magazines sur la banquette arrière (une revue de pêche bien sûr, une revue de base-ball bien sûr), dans le coffre un exemplaire de Walden et puis une crosse de hockey ». Un condensé d’Amérique, en somme.
On pourrait craindre l’exercice de style, mais il n’en est rien. Le lecteur se trouve pleinement engagé dans cette histoire que la forme ne cesse pourtant de démystifier. Il vit les aventures de Dwayne Koster au premier et au second degré (preuve s’il en est de l’efficacité de la recette). Il éprouve le plaisir subtil d’être pleinement dedans, et en même temps, un peu à l’écart, assis confortablement dans sa posture de lecteur complice qui s’amuse avec l’auteur des codes que celui-ci montre du doigt. La lecture est réjouissante – même s’il faut le reconnaître, le roman a tendance à patiner un peu vers la fin…
Finalement, il n’y a rien de plus français que ce roman américain. On reconnaît bien le romancier hexagonal dans cette mise à distance, cette ironie qui déconstruit tout sur son passage, cette manière un peu agaçante de se regarder en train d’écrire. Dans une interview au Magazine Littéraire, Richard Ford (cité dans le roman… et qui mérite donc bien d’être réhabilité !) semble aller dans le même sens : « Nous, nous ne pensons pas comme des artistes, mais comme des maçons, des artisans. Pas comme en France… ». Fausse humilité ? Pique bien sentie ? Cette séparation semble tracée à gros trait. Il n’empêche que le roman de Tanguy Viel ne la contredit pas, bien au contraire : d’un côté les Américains, au souffle fort et aux muscles vigoureux, de l’autre les Français, les maigrelets qui pensent et théorisent…
Merci à Jessica Martin pour sa précieuse relecture.
Tanguy Viel, La Disparition de Jim Sullivan, éditions de Minuit, 2013, 153 pages
The post La Disparition de Jim Sullivan, Tanguy Viel appeared first on Les heures perdues.
]]>Joe a treize ans, trois amis pour la vie, une passion sans limite pour Star Trek et les seins de sa jeune tante. Il vit sur une réserve amérindienne du Dakota du Nord, entouré d’une famille unie : le père, juge aux affaires tribales, est l’incarnation d’une paternité confiante et solide ; la mère, généreuse et […]
The post Dans le Silence du vent, Louise Erdrich appeared first on Les heures perdues.
]]>Joe a treize ans, trois amis pour la vie, une passion sans limite pour Star Trek et les seins de sa jeune tante. Il vit sur une réserve amérindienne du Dakota du Nord, entouré d’une famille unie : le père, juge aux affaires tribales, est l’incarnation d’une paternité confiante et solide ; la mère, généreuse et aimante, a le don de sacraliser le moindre événement du quotidien. Au-delà des frontières de ce cercle intime, il y a tous les autres : l’oncle pompiste, alcoolo notoire à la trempe facile ; la fameuse tante Sonja, plantureuse jeune femme, objet de tous les fantasmes adolescents ; les grands-parents, grabataires déglingués, dont la lubricité n’a d’égale que la joie de transmettre et de raconter ; et puis tous les autres, les cousins, les parents, les frères des amis, personnages hauts en couleur qui assument tous leur part de responsabilité (ou d’irresponsabilité…) dans la vie du jeune garçon. Toute cette smala vivote plutôt joyeusement dans les limites étroites de la réserve. Pas de misérabilisme de mauvais goût : ici, on n’est pas plus malheureux qu’ailleurs.
Pourtant, le drame survient et renverse tout. Un soir, la mère de Joe est agressée : sauvagement battue et violée, elle doit à son seul sang-froid d’échapper à l’immolation. Enfermée dans le mutisme, elle tait le nom de son bourreau. Le père tente de répondre à cette violence par les armes qui sont les siennes : il participe aux maigres investigations, recueille des témoignages, revisite tous ses dossiers, formule des hypothèses. Mais toutes ses tentatives se heurtent à un hiatus juridique : si tout semble désigner le même homme, le procès ne peut s’ouvrir tant qu’on ne connaît pas l’endroit exact du crime. Or, l’agression s’est produite dans les environs de la Maison-Ronde, haut lieu de la réserve qui accueillait des cérémonies clandestines avant 1978[1]. Comble de malchance, trois types de terrains se trouvent sur cette zone : l’un appartient à la réserve, l’autre à l’Etat et le troisième à une personne privée. Il est donc impossible de désigner le tribunal compétent dans cette affaire. Au sein de cet imbroglio, l’agresseur exulte. Bientôt il revient hanter la communauté.
Face à l’échec de l’institution, il y a Joe, et son incommensurable douleur. Parce que son père ne peut rien, Joe va tout tenter. Ce récit de vengeance est, selon le New-York Times, « une sorte de croisade galvanisée par la colère de l’auteur ». A travers Joe et sa mère, c’est le destin tragique de toutes les femmes amérindiennes que raconte Louise Erdrich. Dans la postface, elle cite ainsi un rapport publié par Amnesty International selon lequel «une femme amérindienne sur trois sera violée au cours de sa vie (…). Quatre-vingt seize pour cent de ces viols sont commis par des hommes non-amérindiens». Le regard juvénile de Joe a en lui suffisamment d’innocence pour porter toute la charge : comment mieux écrire l’indignation qu’à travers le point de vue naïf d’un jeune adolescent ? Le procédé pourrait même paraître facile si le personnage n’était pas aussi complexe. Joe surprend, étonne, et ce, jusqu’à la fin.
Louise Erdrich écrit un grand roman parce qu’elle ranime vigoureusement la veine réaliste. Elle promène son miroir avec finesse et maîtrise, mais surtout avec une grande tendresse. Dans le silence du Vent fait vivre tout un monde, souffrant certes, mais aussi terriblement vivant. L’histoire est portée par un souffle éblouissant, qui procure un immense plaisir de lecture. Les personnages sont particulièrement bien campés ; l’exercice périlleux du dialogue, notamment entre adolescents, est très réussi ; les scènes, relatées avec un sens aigu du détail, s’enchaînent dans une grande fluidité.
Comme sa compatriote Toni Morrison, avec laquelle elle supporte largement la comparaison, Louise Erdrich place une minorité sur le devant de la scène : elle la porte à bout de bras, en montre les blessures, mais lui fait surtout relever fièrement la tête.
Louise Erdrich, Dans le Silence du vent, Albin Michel, 2014, 480 pages.
Sur le même roman, lisez aussi l’article d’Au Mont d’Ottans, excellent blog spécialisé dans la culture américaine sous toutes ses formes, souvent très inspirant.
[1] Date de la mythique Longest Walk qui permit aux Amérindiens d’obtenir le droit fédéral de liberté de religion.
The post Dans le Silence du vent, Louise Erdrich appeared first on Les heures perdues.
]]>