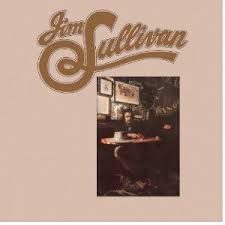Le Hobbit: un Voyage inattendu, Peter Jackson
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Hobbit a été attendu au tournant. L’appât du gain facile, après le succès du Seigneur des Anneaux, a en effet rendu son existence éminemment suspicieuse aux yeux des gardiens de l’esprit de Tolkien ou des pourfendeurs de l’industrie cinématographique. Ajoutez à cela la relative brièveté du roman de Tolkien confrontée à l’annonce tardive d’une nouvelle trilogie, et la coupe des sceptiques était pleine.
Soyons clairs, Le Hobbit, récit picaresque par excellence, n’intéressera pas ceux que la première trilogie de Jackson a laissés froids. Mais il ravira sans doute tous les autres. L’univers de Jackson et sa volonté toujours intacte de respecter l’œuvre de son maître demeurent impeccables. Plus encore que pour la première trilogie, dont la lourdeur mystique et le propos grave faisaient planer un sentiment tout sauf enfantin, il faut se livrer innocemment à cette œuvre pour la goûter pleinement.
Voilà donc ce qui se fait de mieux dans le divertissement grand public. Avec Le Hobbit, on rêve, véritablement. Gageure à une époque où l’imaginaire fait souvent défaut à nos artistes. Gageure car l’entertainment est suspect, voire tricard, depuis la floraison des dénonciateurs de complots capitalistes des années soixante. Gageure, enfin, parce que de nombreux films de « divertissement » prennent effectivement leur public pour des idiots et livrent d’innommables navets sans intérêt. Le genre du divertissement, au cinéma, est sans doute paradoxalement le plus délicat à manipuler.
La présente critique pourrait s’arrêter ici, tant cette excellence-là suffit à justifier l’œuvre de Jackson. Trolls, géants de pierre, aigles fabuleux, les créatures imaginaires et les situations ubuesques fourmillent dans le film. Une compagnie de Nains part en quête de son territoire originel, occupé par la force depuis longtemps par le terrible – et pour l’instant non visible – dragon Smaug. Gandalf, sage magicien, et Bilbon, le Hobbit (ou semi-homme), accompagnent cette équipée. Les effets spéciaux sont extraordinaires d’efficacité et de justesse : mis au service de l’univers de Tolkien, ils ne se remarquent pas, disparaissant humblement au profit de la narration et sont toujours justifiés.
Jackson, en outre, s’affirme à nouveau comme le maître de l’épopée au cinéma. Pas farouche, il n’hésite pas – et réussit admirablement – à instiller une ampleur magistrale à son récit, à coups de plans-séquences à couper le souffle, de paysages toujours grandioses, le tout ponctué par la musique d’Howard Shore, qui, s’il n’atteint pas le génie de sa bande originale du Seigneur des Anneaux, livre une partition réussie, toujours inspirée de l’opéra wagnérien dans sa continuité et ses leitmotivs. Il faut saluer ce culot : depuis le Seigneur des Anneaux, Jackson se lance à corps perdu dans un registre que les meilleurs évitent comme la peste et dans lequel les plus mauvais sombrent de façon grotesque.
Mais Le Hobbit n’est pas qu’un conte pour enfant. Ou plutôt il l’est, mais dans la tradition de ces contes qui disent bien plus qu’ils ne paraissent. Car le Mal plane sourdement sur ce premier épisode. Sans doute désireux de connecter sa nouvelle trilogie à l’ancienne, Jackson instille dans le discours de Gandalf la crainte d’une menace qui dépasse allègrement la farce servie par les Nains. Ainsi, le magicien se fait l’apôtre du concept de guerre préventive : s’il part combattre Smaug, c’est parce qu’il redoute l’éventualité que cette arme de destruction massive tombe entre les mains d’un ennemi plus puissant. Gandalf est donc un faucon, traînant avec lui une morale aussi gênante que pessimiste selon laquelle les temps de paix ne sont qu’une préparation aux guerres à venir.
Cette menace, Saroumane, son maître, la nie vigoureusement. On sait de lui qu’il combattra avec les forces obscures dans la trilogie suivante, et cette position le place dans le costume du mauvais gouvernant, soit parce qu’il conspire déjà, soit parce qu’il est aveugle à la montée des périls. Où donc est la morale ? Du côté du prudent Saroumane ou de celui du faucon Gandalf ? La connaissance des événements suivants oriente notre jugement, mais la confrontation à notre actualité internationale sème le trouble.
Le Hobbit n’est donc pas qu’un conte léger. Davantage que dans le Seigneur des Anneaux, on retrouve de temps à autre une pensée, une allusion, une situation susceptibles de soulever une réflexion, comme cette intéressante définition du courage comme vertu sociale livrée par Gandalf, cette théorie microsociologique du bien et du mal, ou encore cette vision de la nostalgie comme filtre constitutif de l’action politique.
L’intérêt de ce premier volet réside donc notamment dans la tension existant entre son ton badin, carnavalesque, et la gravité qu’elle dissimule. Le film de Jackson demeure fidèle à l’œuvre de Tolkien et en ravira les fans. Sa très grande qualité reste son sens spectaculaire, épique, et son aptitude à réveiller notre béatitude enfantine. Pour l’apprécier, il faut donc ne pas avoir perdu cette part-là, et être capable de déceler la dimension intellectuelle d’une œuvre qui ne se présente pas en tant que telle, fût-elle un blockbuster.
Date de sortie : 12 décembre 2012
Réalisé par : Peter Jackson
Avec : Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage
Durée : 2h45
Pays de production : Etats-Unis, Nouvelle Zélande