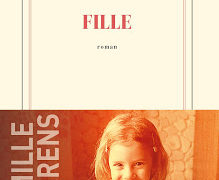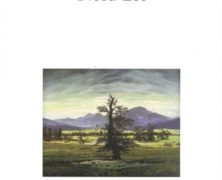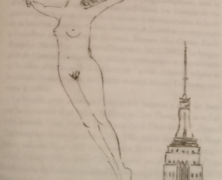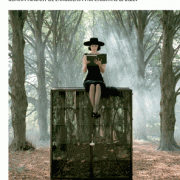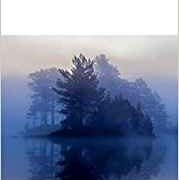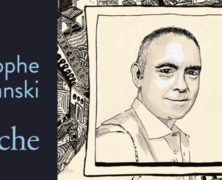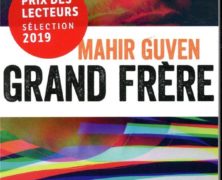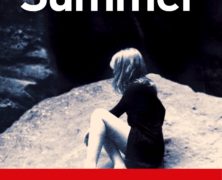En plus de huit cents pages et quatre parties, Ceux de 14 de Maurice Genevoix fait revivre les poilus dans leur quotidien. Témoignage, monument, mais surtout œuvre d’un humaniste et d’un grand écrivain. D’août 1914 à avril 1915, le sous- lieutenant Genevoix, jeune normalien, est sur le front. Il prend des notes dans ses carnets, poussé par Paul Dupuy, secrétaire général de Normale Sup, à qui il envoie régulièrement ses feuillets. Presque écrit sur le vif, son texte étonne par sa vivacité, son style alerte, factuel, surtout dans le premier livre « Sous Verdun » paru dès 1916. Le rythme se ralentit quand la guerre de position succède à la guerre de mouvement. L’élan et même l’allégresse, vite démentie, des premiers combats lorsqu’il ressent avant l’assaut « une excitation fumeuse, et trouble, presque sensuelle » fait place à l’ennui. La routine s’installe : trois jours en première ligne, trois en deuxième ligne, puis trois jours de cantonnement, ces jours tant attendus « nos trois jours » ceux pendant lesquels « chacun se retrouve lui-même ». L’attente dans les tranchées se fait interminable : « Nous nous affaissions sous le poids de l’ennui, de longues somnolences nous abrutissaient, et le fracas des obus qui tombaient derrière nous ne nous faisait même plus lever la tête. N’eût été cette pesanteur d’ennui qui jamais ne s’allégeait, nous eussions perdu la conscience de notre propre existence. » Tous les livres qui composent Ceux de 14 pourraient s’intituler, comme le troisième, « La Boue » . Elle est partout, gluante, enveloppante ; elle colle aux chaussures, on s’y enfonce, on s’y enlise : « Nous sommes des survivants humiliés. Toute cette grandeur s’est en allée de nous. Une guerre sordide nous ravale à son image : comme si en nous aussi, sous une bruine de tristesse et d’ennui s’élargissaient des flaques de...
Ceux de 14, Maurice Genevoix
Venez sur le site du meilleur casino en ligne du Portugal - https://casinozeus.pt. Jouez pour de l'argent réel.
écrit par Marie-Odile Sauvajon
L’Anomalie, Hervé Le Tellier
écrit par Fleur Bournier
Réjouissant et virtuose pour les uns, convenu et gentillet pour les autres, L’Anomalie d’Hervé Le Tellier est un Goncourt controversé, couronnant la littérature ludique et de connivence. La virtuosité du nouveau roman d’Hervé Le Tellier tient dans sa construction : onze personnages que l’on découvre au fil des chapitres, dont le seul point commun réside dans un vol Air France Paris-New York – assez traumatisant – qu’ils ont tous pris. Tueur à gages menant une double vie, avocate déterminée, architecte de renom, pop star nigériane, monteuse de cinéma, écrivain confidentiel : une galerie luxuriante de personnages s’offre au lecteur. Hervé Le Tellier, en digne membre de L’Oulipo, joue avec les codes romanesques, explore et démultiplie ses possibles, en commençant par une expérimentation sur le nombre de personnages principaux que peut suivre, sans trop de difficultés, un lecteur. « Il n’a retenu que onze personnages, et devine qu’hélas, onze, c’est déjà beaucoup trop » s’inquiète ingénument le narrateur au sujet du nouveau roman de l’écrivain Victor Miesel, dont le précédent avait pour titre… L’Anomalie. Hervé Le Tellier prend ainsi un plaisir manifeste à multiplier les clins d’œil au lecteur, au risque de sombrer parfois dans les clichés ou dans un humour potache. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il fait intervenir Donald Trump face à Emmanuel Macron : on frôle alors la mauvaise caricature. Fort heureusement, les clins d’œil au lecteur peuvent aussi être réjouissants. Hervé le Tellier manie avec brio l’art du pastiche. On s’amuse, par exemple, des réécritures d’incipits célèbres : « Tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l’est à sa façon. » ; « La première fois qu’Adrien avait vu Meredith, il l’avait trouvée franchement laide ». L’Anomalie peut d’ailleurs très bien se lire dans son ensemble comme un pastiche de film d’espionnage hollywoodien ou de série télévisée à suspense et...
Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, D.Levy...
écrit par Fleur Bournier
Dans la lignée d’Un lieu à soi, de La Vie matérielle ou encore du Deuxième sexe, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, les deux premiers volumes de la trilogie autobiographique de Deborah Levy, sont de vrais petits bijoux de littérature, couronnés par le prix Fémina 2020. Dès les premières lignes, la fulgurance de la pensée, l’écriture ciselée, la narration fragmentaire, mais d’une cohésion parfaite, subjuguent. A la fois récits autobiographiques et essais, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie racontent une quête ou plutôt une reconquête de soi, en tant que femme et écrivaine. Comment devenir le personnage principal de sa propre vie? interroge Deborah Levy. « C’est déjà assez dur d’apprendre à devenir écrivain, mais apprendre à devenir un sujet, c’est épuisant. » George Sand, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Julia Kristeva ou encore Marguerite Duras, autant de consœurs que Deborah Levy cite, comme une évidence, au détour d’une phrase, qu’elle convoque auprès d’elle, bonnes fées qui veillent après avoir ouvert la voie. Dans sa trilogie autobiographique, Deborah Levy réfléchit à son tour à la condition féminine, à la maternité, et leurs influences sur l’acte d’écriture, mais aussi à la manière dont le passé se rappelle au présent. Deborah Levy souligne, dans une belle filiation à V. Woolf et M. Duras, l’importance que peuvent avoir les lieux pour une femme, le corollaire entre l’absence de lieu à soi et le rôle d’«architecte » de l’espace domestique assigné par la société : « Arracher le papier peint de ce conte de fées qu’est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c’est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements ni amour et qu’on néglige. Il faut de l’habileté, du temps, de la dévotion et de l’empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C’est surtout un acte d’une générosité immense que d’être l’architecte du bien-être de tous les autres. » L’autrice a révélé dans une interview que le dernier volume de cette « Living autobiography » (« autobiographie vivante »), La Propriété privée, continue de travailler sur l’espace à soi. Le premier volet, Ce que je ne veux pas savoir, se présente, par son sous-titre, comme une « réponse au Pourquoi j’écris de George Orwell (1946) », en adoptant cette fois un point de vue féminin. « Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semble-t-il, sur les escalators de gares que je pleurais le plus souvent » constate la narratrice dans les premières lignes du roman. Il s’agit alors pour elle non de remonter à la source de ce chagrin, mais, dans un premier temps, de l’accueillir, d’essayer de le comprendre. Pour cela, elle décide de retourner dans une pension où elle avait déjà séjourné à Palma de Majorque (dans une proximité savoureuse avec George Sand). De cette escapade jaillissent des souvenirs de son enfance en Afrique du Sud – où elle est née -, et en Angleterre : « « Angleterre » était un mot excitant à écrire. Ma mère m’avait dit que nous étions en exil et que nous retournerions un jour dans mon pays natal. L’idée que je vivais en Exil et non en Angleterre me terrifiait ». Deborah Levy laisse l’enfant qu’elle était s’exprimer, elle adopte son regard, encore naïf, qui sait sans savoir, sans vouloir savoir : l’apartheid, l’arrestation de son père militant de l’ANC, les oiseaux que l’on enferme et qu’elle veut libérer. L’enfant apprend peu à peu, grâce à sa pétillante cousine Mélissa, mais surtout grâce à l’écriture à « parler haut », sorte de mantra commun aux deux premiers volumes : « Les filles doivent parler haut puisque personne ne les écoute de toute façon » Le coût de la vie s’ouvre quarante ans plus tard : « Arrivée à la cinquantaine, juste...
Fille, Camille Laurens
écrit par Fleur Bournier
Féministe et féminin, drôle et émouvant, le dernier Camille Laurens séduit malgré une narration un peu chargée. Fille est le récit, aux accents autobiographiques, de la vie de Laurence Barraqué, entremêlé à une réflexion aussi pertinente qu’amusante sur ce qu’est être fille dans la France des années 60 jusqu’aux années 2000. Laurence («L’eau-rance»? s’indigne la grand-mère) naît en 1959 à Rouen d’un père médecin et d’une mère femme au foyer. Le roman s’ouvre sur sa venue au monde, sur le constat qui l’accompagne (« c’est une fille ») et tous les sous-entendus dont sont empreints ces quelques mots : « « C’est une fille » signifie d’abord « Ce n’est pas un garçon » ». Une déception donc – d’autant plus qu’elle a déjà une sœur, Claude. Celle du père principalement : lorsqu’on lui demande s’il a des enfants, ce dernier répond « Non, j’ai deux filles ». La structure narrative – trois parties et un épilogue – suit le parcours de Laurence, de sa naissance à sa renaissance, c’est-à-dire la fierté enfin trouvée d’être une fille. La première partie est consacrée à l’enfance, les deux suivantes à l’âge adulte ; l’une raconte la mort de son premier enfant, la dernière son retour à la vie avec la naissance de sa fille, Alice. Le premier chapitre, malgré son amertume sous-jacente, est jubilatoire tant l’autrice sait jouer avec les mots, les clichés, les représentations. Telle cette perle : « A propos de filles, il y a une chose bizarre. Tu es une fille, c’est entendu. Mais tu es aussi la fille de ton père. Et la fille de ta mère. Ton sexe et ton lien de parenté ne sont pas distincts. […] La fille est l’éternelle affiliée, la fille ne sort jamais de la famille. Le Dr Galliot, au contraire, a eu un garçon et il a eu un...
Mélodie de Vienne, Ernst Lothar
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Paru d’abord en anglais en 1944, Mélodie de Vienne de l’autrichien Ernst Lothar est de la veine des grands romans européens. A la fois saga familiale et fresque historique, il nous plonge dans l’univers de la Mitteleuropa au cœur des bouleversements du XXème siècle. C’est l’histoire d’un immeuble viennois, comme l’indique le titre en allemand L’Ange au trombone – Roman d’une maison. Durant un demi-siècle, de 1888 à 1938, nous suivons la vie de la famille Alt, constructeurs de pianos, qui occupe cette demeure depuis trois générations. et, à travers elle, l’histoire de l’Autriche. Le destin du n°10 de la Seilerstätte à Vienne et de ses habitants se confond avec celui de l’Empire austro-hongrois finissant. Dans cette demeure cossue à trois étages, construite par leur ancêtre, la famille Alt s’enorgueillit de posséder un piano sur lequel a joué Mozart et maintient des traditions immuables. Plusieurs générations et plusieurs nationalités y cohabitent, image de l’empire dans sa diversité. Otto Eberhard, le frère ainé marié à la fille d’un baron du Tyrol, procureur rigide et hiératique, figure la continuité, figé dans le respect du passé et des conventions à l’image du vieil empereur François-Joseph. Franz, son cadet, plus faible et maladroit, a repris l’entreprise familiale. Franz crée la surprise quand, à l’âge de trente-six ans, il annonce ses fiançailles avec la belle Henriette Stein, dite Hetti, d’origine juive, et décide de construire un quatrième étage pour y habiter. Elégante et volage, la jeune femme qui a été la maitresse de l’archiduc Rodolphe avant le drame de Mayerling, incarne l’insouciance viennoise, « le luxe de la légèreté » : les promenades au Prater, les bals masqués, les toilettes venues de Paris, les courses, le tokay et le punch à l’aspérule. De leur union vont naitre trois enfants : Hans, Franziska,...
L’Archipel d’une autre vie, Andreï Makine
écrit par Fleur Bournier
Roman policier et métaphysique, L’Archipel d’une autre vie plonge le lecteur dans une traque haletante en plein cœur de la taïga. Un grand Makine. Telle une poupée russe, L’Archipel d’une autre vie enchâsse différents récits, différentes époques. Le roman s’ouvre sur un récit rétrospectif, qui, sans être autobiographique, offre un narrateur qui emprunte beaucoup à l’auteur. Orphelin né dans un camp de travail, le narrateur du récit-cadre est envoyé à quatorze ans en tant que géodésiste en Sibérie, dans la « petite localité de Tougour […] coin perdu de l’Extrême Orient ». Par goût de l’aventure plus que par réelle cupidité, il entame une traque dans la forêt sibérienne qui bientôt se retourne contre lui. Le chercheur d’or qu’il pensait détrousser n’en est pas un : que fait cet homme seul, bien équipé et alerte, dans la taïga ? Le jeune homme écoute alors, médusé, cet homme, Pavel Gartsev, lui raconter son histoire. En 1952, les Russes se préparent à la troisième guerre mondiale. Pour cela, ils envoient en Sibérie de jeunes réservistes : ce fut le destin de Pavel. Un jour, on lui donne la mission de se lancer, avec quatre autres hommes, à la poursuite d’un fugitif du goulag. La chasse à l’homme dans la taïga, écrite comme une intrigue policière, constitue le cœur du roman. L’écriture épouse le rythme sinueux de la traque : « Marcher » dans la taïga est une façon de parler. En réalité, on doit s’y mouvoir avec la souplesse d’un nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un passage s’épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces vagues de branches, de brande, de broussailles qui déferlent sur lui. » La narration est en effet à la fois haletante -puisqu’il s’agit d’une course-poursuite- et lente. Elle donne à observer la forêt primaire et le fugitif qu’elle abrite, mais aussi à connaître peu à peu les cinq hommes qui le poursuivent. Le capitaine Louskass, le commandant Boutov et le sous-lieutenant Ratinsky ont à cœur leur avancement et sont prêts à tout pour obtenir les faveurs du parti. Vassine, comme Pavel, est enrôlé dans cette affaire malgré lui ; il admire le fugitif et voudrait bien l’aider. Les deux hommes finissent par ressentir une communion avec celui qu’ils poursuivent. Ils voient en lui un semblable, un frère, et non cet ennemi du peuple qu’ils doivent traquer sans relâche et rapporter au camp vivant afin qu’il serve d’exemple. Sa frêle silhouette laisse deviner celle d’« un adolescent caché. Assez semblable, tout compte fait, à ce « pantin de chiffon » que je gardais en moi. Fiévreux symbole de notre volonté de vivre, d’aimer, d’être reconnu, d’être aimé… ». Le fugitif ne cesse de les surprendre : il leur échappe toujours. Lorsque les cinq poursuivants comprennent enfin à qui ils ont affaire, la traque prend une toute autre tournure et s’accélère. Le désir de la capture tourne à l’obsession et fait ressortir le pire chez ces hommes. La construction virtuose de L’Archipel d’une autre vie repose sur une série de rebondissements et retournements de situation, tenant le lecteur en haleine, d’une course-poursuite à l’autre. Les traqueurs d’un jour deviennent à leur tour traqués. Ainsi Pavel marche sur ses propres pas dans la taïga mais cette fois pour sauver sa peau : « dans ma course, je vivais ce qu’aurait éprouvé une bête blessée. J’étais presque nu sous mes haillons. Mon dos et mes épaules saignaient. Ma bouche, déchirée par les coups de Ratinsky, se crispait de douleur quand, me mettant à quatre pattes, je buvais l’eau des courants. La nuit, le froid me secouait, mais je n’allumais que de tout petits feux, pour ne pas me trahir » Ainsi le jeune narrateur croit traquer Pavel alors que c’est sur lui que l’étau se referme. A cette intrigue policière se lie, dès les premiers mots du roman, une réflexion métaphysique : « A cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à...
Lumière d’été, puis vient la nuit, Jón Kalman Stefánsson...
écrit par Fleur Bournier
Quel plaisir de retrouver la prose poétique et mélancolique de l’islandais Jón Kalman Stefánsson en cette rentrée littéraire où il fait bon s’évader. Lumière d’été, puis vient la nuit, paru en 2005 mais dont la traduction nous parvient seulement cette année, immerge le lecteur dans un petit village des fjords de l’ouest de l’Islande, s’attachant tour à tour à certains de ses habitants. Quotidiens ordinaires et monotones, mais aussi extraordinaires et poignants. Dès le titre, Lumière d’été, puis vient la nuit, la plume de Jón Kalman Stefánsson – et de son remarquable traducteur- fait tinter à notre oreille sa douce et mélancolique poésie, qui se poursuit dans le titre des chapitres : « L’univers et la robe de velours noir », ou encore « les larmes ont la forme d’une barque à rame ». Qui se déploie dans le roman : « Au printemps, il attire des oiseaux des tourbières joyeux et optimistes, ses rives regorgent de toutes sortes de coquillages, au loin, des milliers d’îles et d’écueils surgissent de l’eau comme une denture aléatoire – et le soir, le soleil répand son sang à la surface de l’océan, alors, nous méditons sur la mort. » Cette prose enchanteresse et mélodieuse accompagne un complet dépaysement. Nous voici dans un petit village islandais, partageant sa douce torpeur loin des fracas du monde. Le narrateur nous y accueille, à l’orée du roman, avant de commencer son récit, ou plutôt ses récits, puisque c’est de la vie de certains de ses habitants dont il va être question. Le nom du village reste tu car il importe peu, il est le miroir de tant d’autres. Le narrateur lui aussi tait son nom, il se pose en simple observateur, en conteur, et sa voix s’élève comme dans un prologue d’une tragédie antique : « nous vous parlerons du désir...
Un jour ce sera vide, Hugo Lindenberg
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman très abouti de Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide raconte, le temps d’un été au bord de la mer, les peurs, les émois et les secrets d’un enfant de dix ans. Délicat, subtil et touchant. En vacances en Normandie avec sa vieille grand-mère et sa tante obèse qu’il surnomme « la folle », le jeune narrateur rencontre Baptiste, un garçon de son âge qui le fascine. Il fait tout pour l’imiter, pour mériter son amitié et surtout pour être accueilli chez lui, dans cette famille parfaite, qui apparait si différente de la sienne sur la plage : « je distinguais le triangle impeccable que formaient ses parents et sa soeur. Plus loin, seule sur une chaise pliable, ma grand-mère ressemblait à un rocher.» L’enfant éprouve une immense tendresse pour sa grand-mère, présence rassurante : « Je m’imagine lionceau perdu dans la savane, sous la protection d’un vieux fauve. » Mais il ressent aussi de la honte, honte de ses robes à fleurs, de son accent polonais, et du bol de foie haché qu’elle offre à la mère de Baptiste : « J’aimais le foie haché comme j’adorais ma grand-mère : dans l’intimité du foyer. Offerts à la vue de tous, l’un et l’autre m’embarrassaient terriblement. » Tiraillé entre deux mondes, le jeune garçon tente d’adopter les codes d’un autre univers, de se faire accepter et de voler un peu de la présence maternelle qui lui manque. Peu à peu, on devine les secrets enfouis derrière les mensonges et les silences, les histoires passées qui hantent cet enfant solitaire et sensible. Un jour ce serait vide pourrait aussi avoir pour titre « Les Méduses ». Omniprésentes dans le livre, elles s’échouent sur la plage où les garçons les décortiquent d’un bâton avec cette innocente cruauté de l’enfance. Elles habitent, hantent le...
Nord-Est, Antoine Choplin
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Plaisir en cette rentrée littéraire de retrouver Antoine Choplin dans les jolies éditions de La fosse aux Ours. Nord-Est, son dernier roman, reprend les thèmes qui lui sont chers – la catastrophe, la place de l’Art, les rapports humains – à travers le récit d’une aventure intemporelle et universelle. Ils sont quatre : Garri, Emmet, Jamarr et Saul qui décident de quitter le camp pour essayer de gagner à pied « les longues et douces plaines du nord-est », comme une terre promise lointaine au-delà des montagnes. Rusla, qui reproduit les pétroglyphes gravés par les anciens et les sauve de l’oubli, se joint ensuite à eux; puis Tayna, rencontrée dans le premier village traversé. Ils étaient paysan, maçon, écrivain ou sage-femme. Chacun a son caractère – meneur, introverti, écervelé ou posé -, ses passions, ses secrets. Que s’est-il passé? Que fuient-ils? Que cherchent-ils? On l’ignore, comme on ignore toujours le lieu et l’époque. On sait seulement qu’il y a eu un « avant », avant les incendies qui ont tout ravagé; à présent la population est répartie dans des camps, ravitaillée par des cantiniers. Ils croisent un cheval blessé, un berger fou qui ne parle plus que par bribes de mots, traversent des villages en ruines. Ils avancent avec difficulté, sous le soleil ou dans la tempête, gravissent la montagne encordés, descendent les pierrées dans une quête sans cesse recommencée : « Tu commences par monter, longtemps. Et quand t’arrives en haut de ce qui te fermait l’horizon, tu vois une nouvelle montagne se dresser entre toi et l’horizon(…) et quand t’arrives en haut de cette deuxième montagne, t’en découvres encore une autre qui te barre encore les perspectives. Et, à la fin, l’horizon, le vrai, celui qui te tire le regard au lointain (…) c’est comme si tu...
Comédies françaises, Eric Reinhardt
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Comédies françaises, le dernier roman d’Eric Reinhardt, croise, ou plutôt superpose, plusieurs histoires. Au risque de paraître parfois didactique ou éclaté, il pose la question du poids du hasard dans nos vies. Foisonnant et richement documenté. Refusant tout suspens, Eric Reinhardt commence par la fin et dévoile à la première page le faire-part de décès de son héros, Dimitri Marguerite, mort accidentellement à l’âge de vingt-sept ans. Il enchaine ensuite sur le moment de sa rencontre à Madrid avec une belle inconnue, puis retrace le parcours de ce brillant élève, pur produit de l’élitisme républicain. Fils d’une directrice d’école maternelle communiste, il intègre le lycée Louis-le-Grand et la prépa scientifique, bifurque vers le théâtre, échoue au concours du conservatoire et fait un master à Sciences-Po Paris. A la suite de la rencontre d’un soir avec un riche industriel, il est embauché comme consultant en affaires publiques dans un cabinet réputé et le lecteur découvre avec lui « une activité aussi romanesque, aussi mystérieuse, aussi opaque et sulfureuse que le lobbying ». Il quitte ensuite ce premier emploi, devient journaliste à l’AFP tout en menant différents projets de roman. L’auteur suit aussi les aventures amoureuses, homosexuelles et hétérosexuelles, de son héros et surtout sa quête obsessionnelle de la jeune femme rencontrée à Madrid et revue par hasard à Paris. Dimitri incarne le malaise d’une certaine jeunesse : il s’ennuie, n’arrive pas à être en accord avec lui-même, cherche le grand amour tout en enchaînant les aventures, envisage d’écrire des romans, se laisse porter par le hasard des rencontres et préfère parfois le rêve à la réalité: « Je me sens de plus en plus attiré par le hors champ. Sortir du réel. Creuser. M’enfouir. ». C’est seulement au théâtre qu’il a trouvé la possibilité « d’assouvir ce besoin impérieux de sens, de vérité et de perfection dans l’agencement des données du monde sensible » Il y a plusieurs romans dans ce livre. Au sein des aventures de Dimitri Marguerite s’insèrent deux autres histoires, sujets des romans que le héros projette d’écrire et pour lesquels il accumule des notes sur ses carnets : la rencontre de Max Ernst et Jackson Pollock et le rôle d’Ambroise Roux dans le ratage de l’internet français. A cela s’ajoutent aussi de nombreuses digressions au cours desquelles le narrateur expose ses théories sur le théâtre, les rues piétonnes ou l’épilation féminine. On peut trouver le livre décousu, disparate, passant du classique roman d’apprentissage et de l’histoire d’amour au quasi documentaire. Mais l’auteur tisse des liens ténus qui relient entre elles ces histoires : l’histoire de l’art abstrait d’après-guerre comme celle d’internet montrent la prise d’influence des Etats-Unis au détriment de la France et de l’Europe, Ambroise Roux pratique un lobbying efficace comme tente de le faire Dimitri, et surtout tous deux sont de grands admirateurs des surréalistes. C’est en effet surtout la question du hasard cher aux surréalistes – « le hasard objectif, forme de manifestation de la nécessité » comme l’écrivait André Breton – qui est au centre du roman et lui donne son unité. Ce qui intéresse l’auteur ce sont les moments historiques et « les coïncidences pétrifiantes », ces jours où tout bascule dans un pays comme dans une vie : ce jour d’octobre 1973 où la France de Giscard, poussée par le puissant industriel Ambroise Roux, met fin aux recherches de Louis Pouzin sur les transmissions de données et choisit le minitel au détriment d’internet; ce jour de juin 1942 où Max Ernst enseigne la technique du dripping au jeune Jackson Pollock – ce qui va faire de New-York la nouvelle capitale de l’art-; ce jour où Dimitri retrouve par hasard la jeune femme de Madrid (comme Breton croise Nadja à Paris). « Il y a comme ça des moments inconnus – qui devraient être exhumés et marqués d’une pierre noire, pensait Dimitri. » Eric Reinhardt joue avec le lecteur, trompe ses attentes, l’étonne parfois. L’histoire de Louis Pouzin, plusieurs fois annoncée, amorcée, interrompue...
Yoga, Emmanuel Carrère
écrit par Fleur Bournier
« Un petit livre souriant et subtil sur le yoga », tel était le projet initial d’Emmanuel Carrère avant de se muer en « autobiographie psychiatrique ». Curieusement, l’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire, touchant au « sens originel du mot yoga : le fait d’atteler ensemble, sous un joug, deux chevaux ou deux buffles ». Emmanuel Carrère attèle ainsi dans son nouveau roman yoga et dépression, légèreté et drame, pulsion de vie et pulsion de mort. Ce n’est pas sans appréhension que le lecteur plonge dans Yoga. Renouant avec la veine autobiographique d’Un roman russe, E. Carrère écrit le récit poignant de sa longue dépression qui a conduit à son internement et au diagnostic d’une bipolarité de type II. Programme a priori peu réjouissant pour une rentrée déjà plombée par la pandémie. Et pourtant les deux premières parties du roman – qui en compte cinq –, consacrées largement à l’expérience du yoga et de la méditation, amusent et séduisent. L’auteur y raconte avec beaucoup d’humour sa participation à un stage Vipassana : « Les stages Vipassana, c’est l’entraînement commando de la méditation. Dix jours, dix heures par jour, en silence, coupés de tout : le truc hard. » Ce récit souriant et subtil est le point de départ de multiples réflexions sur le yoga, théoriques ou plus personnelles : « Car inspirer, dit le yoga, c’est prendre, c’est conquérir, c’est s’approprier, ce pour quoi je n’ai aucun problème : je ne sais même faire que ça, et ma cage thoracique est à la mesure de mon avidité. Expirer, c’est autre chose. C’est donner au lieu de prendre, c’est rendre au lieu de garder. C’est lâcher prise.» Un autoportrait de l’auteur en adepte du yoga et de la méditation se construit au fil de courts chapitres. Il ne s’adresse pas pour autant qu’aux initiés, bien au contraire...
2666, Roberto Bolaño
écrit par Fleur Bournier
Œuvre monumentale et dantesque, véritable expérience littéraire, 2666 est le grand roman de Roberto Bolaño, laissé inachevé par la mort de l’auteur. Le lecteur, fasciné, plonge tour à tour dans cinq récits aux tonalités fort différentes : roman de mœurs, policier, historique ou encore fantastique, l’œuvre embrasse toute la littérature, démontre sa vitalité et sa nécessité. 2666 peut effrayer par son volume (plus de 1300 pages), par l’idée d’une œuvre-somme peu accessible, et pourtant ce roman happe le lecteur. Hormis sa noirceur inhérente – jusqu’à l’insoutenable – il ne relève d’aucune gageure de lecture. L’écriture, fluide, colle aux personnages -tantôt familière, ordurière même, tantôt plus recherchée, mélancolique et poétique. Chacune des cinq parties s’attache à un ou plusieurs personnages, fait voyager dans le temps et l’espace, offrant un tableau sans concession du XXe siècle. La première partie, «La partie des critiques», est la plus loufoque : elle s’attache à un cénacle d’universitaires spécialistes d’un auteur occulte – Benno von Archimboldi – qui entreprennent de se lancer sur ses traces. L’auteur semble prendre un malin plaisir à décrire le milieu universitaire et à en déconstruire la sacro-sainte image. Les colloques sont ainsi par exemple peuplés – ou plutôt dépeuplés – par « des garçons et des filles avec un doctorat encore chaud sous le bras et qui s’efforçaient, sans s’arrêter sur les moyens, d’imposer leur lecture particulière d’Archimboldi, comme des missionnaires disposés à imposer la foi en Dieu même si pour cela il s’avérait nécessaire de pactiser avec le diable […], des gens que la littérature n’intéressait pas autant que la critique littéraire […]». La comédie de mœurs ouvre avec légèreté le roman. La seconde partie, «La partie d’Amalfitano», plus mélancolique, glisse peu à peu dans le fantastique. Père dévoué et universitaire désabusé vivant à Santa Teresa, Amalfitano semble contaminé par la ville et gagné par une forme de folie. Il entend des voix, ou encore suspend un manuel de géométrie à la corde à linge de son jardin. A sa fille, éberluée, qui l’interroge, il explique : « c’est une idée de Duchamp, laisser un manuel de géométrie suspendu en proie aux intempéries pour voir s’il apprend deux ou trois choses de la vie réelle.» La folie d’Amalfitano est liée aux «idées» ou «sensations» qui le traversent et offre une des meilleures clefs de lecture du roman de Bolaño : « Cela transformait la douleur des autres en la mémoire d’un seul. Cela transformait la douleur, qui est longue et naturelle et qui remporte toujours la victoire, en mémoire particulière, qui est humaine et brève et qui fausse toujours compagnie. Cela transformait un récit barbare d’injustices et d’abus, un hululement incohérent sans début ni fin, en une histoire bien structurée […]. Cela transformait la fuite en liberté, même si la liberté ne servait qu’à continuer à fuir. Cela transformait le chaos en ordre, même si c’était au prix de ce que l’on appelle communément le bon sens» La troisième partie, «La partie de Fate», rend hommage aux romans afro-américains et fait sienne les dénonciations qui les sous-tendent. Fate, le personnage principal de ce récit, est un journaliste afro-américain de Détroit qui vient de rencontrer un des fondateurs des Black Panthers, Barry Seaman, double fictif de Bobby Seale. Le récit de leur échange permet à Roberto Bolaño une véritable leçon d’Histoire sur le combat mené par les Afro-Américains pour l’égalité et la liberté. La tonalité de l’oeuvre s’assombrit. Dépêché à Santa Teresa pour couvrir un combat de boxe, Fate est confronté au racisme ordinaire de sa profession. Il comprend rapidement qu’un autre sujet mériterait bien davantage un article : le nombre alarmant de féminicides dans cette ville frontalière du Mexique. Au racisme succèdent le machisme et les dérives du patriarcat : qui s’intéresse à ces meurtres? Le lecteur découvre au fil de sa lecture que Santa Teresa, «cette merde entre un cimetière oublié et une décharge d’ordures» agit comme un...
L’Anniversaire, Imma Monso
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Huis clos, suspense, récits alternés, rebondissements… L’anniversaire de Imma Monso est indubitablement un thriller haletant, mais pas seulement. C’est aussi un roman qui analyse avec finesse les rapports de couple et les liens entre réalité et fiction. Ils sont ensemble depuis plus de vingt-cinq et les enfants ont quitté la maison quand la crise éclate. Elle ne le supporte plus, ils ne se comprennent pas et achoppent sur chaque mot, chaque expression. Parce qu’ils ne veulent pas se séparer mais que toute discussion tourne à l’affrontement, elle propose qu’ils ne se parlent plus et communiquent seulement par écrit. Après trois semaines de cohabitation silencieuse, il lui adresse un message énigmatique : « Nous fêterons l’anniversaire en dehors de la maison, loin. Nous partirons à neuf heures. » Quel anniversaire? Dans quel lieu? Avec quel cadeau? Etonnée, agréablement surprise par son mari qu’elle a toujours trouvé « prévisible comme une pendule », Raquel s’embarque avec curiosité dans ce voyage (et le lecteur aussi). Mais l’aventure enthousiasmante devient peu à peu angoissante lorsque Mateu révèle à sa femme l’inquiétant cadeau qu’il a préparé pour elle. Tous deux se retrouvent alors prisonniers dans le huis clos de la voiture et Raquel découvre une facette de son mari qu’elle ne connaissait pas. Cet homme pragmatique, concret et maladroit, capable d’élaborer un scénario terriblement précis et glaçant, qui est-il vraiment? Un sadique? Un psychopathe? Ou, simplement, un mari qui cherche à reconquérir sa femme et à obtenir son admiration? Un enfant blessé? « En vérité, cet étranger n’est pas vraiment « lui ». Tout au moins, il n’est pas l’homme qu’elle connait depuis plus de vingt-cinq ans. » Au cours des chapitres, l’auteure fait alterner le récit du voyage d’anniversaire et celui de l’enfance de Mateu qui éclaire peu à peu sa personnalité. Enfant solitaire, délaissé...
Souvenirs de l’avenir, Siri Hustvedt
écrit par Fleur Bournier
“Ce livre est un portrait de l’artiste en jeune femme, l’artiste venue à New York pour lire, souffrir et écrire son mystère. Comme le grand détective qui a les mêmes initiales qu’elle S.H., l’écrivain voit, entend et flaire les indices.” Roman, récit autobiographique, essai féministe, Souvenirs de l’avenir fait chanceler les frontières entre fiction et réalité. Siri Hustvedt y approfondit ses thèmes de prédilection : la création littéraire, les méandres de la mémoire, ou encore la violence du patriarcat. Souvenirs de l’avenir est un roman composite, drolatique et sérieux, qui entrecroise deux époques, mêle trois strates narratives – le “maintenant” de la narratrice-autrice, le journal de la jeune romancière en herbe et des extraits de son premier roman inachevé -, le tout rafraîchi de petits croquis. Siri Hustvedt y brouille à dessein les frontières entre fiction et réalité. Sa narratrice se nomme S.H., un certain nombre de faits coïncident avec sa vie, quand d’autres, en revanche, viennent annihiler toute identification. L’autrice poursuit dans ce roman sa réflexion sur la porosité entre mémoire et imagination, qu’elle prête à son double fictif : «J’ai toujours cru que mémoire et imagination étaient une seule et même faculté.» ; « dites-moi où finit la mémoire et où commence l’invention?» New York, 1978, une jeune femme originaire du Minnesota emménage dans un vieil immeuble aux fines cloisons afin d’écrire son premier roman. « Je ne cherchais ni le bonheur ni mes aises à New York. Je cherchais l’aventure, et je savais que l’aventurier doit souffrir avant d’arriver chez lui après d’innombrables épreuves sur terre comme sur mer, ou de finir éteint d’un souffle par les dieux. » La jeune femme se donne un an pour écrire son premier roman. Elle n’a alors qu’une vague idée de son héros, « moins un personnage...
De l’Ardeur, Justine Augier
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De l’ardeur, récit à la fois très documenté et très personnel de Justine Augier retrace le destin tragique de Razan Zaitouneh, avocate syrienne et militante des droits de l’homme enlevée en 2013. Portrait d’une femme résistante au coeur de la Syrie en guerre. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, à Douma dans la banlieue de Damas, Razan Zaitouneh, 36 ans, est enlevée ainsi que son mari et deux compagnons de lutte. On est sans nouvelles d’eux à ce jour. L’enlèvement est attribué à un groupe salafiste, agissant selon certains sur ordre de Bachar-al-Assad. Justine Augier enquête, lit tout ce qui la concerne, les nombreux articles qu’elle a publiés, interroge ceux qui l’ont connue, en particulier sa soeur ainée, et tente de reconstituer l’itinéraire de cette femme qui la fascine. Avocate diplômée en 2000, Razan se spécialise dans les droits de l’homme; elle commence par assurer (gratuitement) la défense des islamistes arrêtés et détenus par le régime syrien. (Ironie du sort ce seront des islamistes qui l’enlèveront quelques années plus tard.) Bachar-al-Assad succède alors à son père, le pays croit à des réformes possibles, des prisonniers sont libérés. C’est le Printemps de Damas, brève période d’ouverture pour le peuple syrien, qui ne dure que huit mois. Les espoirs sont vite réprimés, le régime s’en prend aux activistes. Razan est de toutes les manifestations en faveur de la démocratie; elle crée avec d’autres l’Association syrienne des droits de l’homme; elle écrit aussi de nombreux articles publiés à l’étranger. En 2011, les forces gouvernementales tirent sur la foule et c’est le début du cycle infernal et sanglant de la révolution et de la répression. Razan Zaitouneh fonde alors le Centre de documentation des violations en Syrie où elle recense inlassablement les exactions du régime,...
Une Bête au paradis, Cécile Coulon
écrit par Fleur Bournier
Prix Littéraire Le Monde 2019, Une Bête au Paradis est à la fois un beau roman et une effroyable tragédie. Une histoire de passions, d’abandons et de vengeances. Le Paradis est un vaste domaine, une ferme, avec sa cour et sa basse-cour, sa fosse à cochons, et plus loin les Bas-Champs, et le Sombre-Etang. Là, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, orphelins suite à un tragique accident de voiture. Elle s’occupe de son exploitation avec l’aide de Louis, un autre fracassé de la vie qu’elle a recueilli au Paradis. La vieille femme semble tirer sa force vitale de cette terre, loin d’elle les ans la rattrapent. Emilienne, c’est la terre, la Terre-Mère, la terre qui nourrit, qui abrite, qui protège. « Elle traversait l’existence, dévolue au domaine et aux âmes qui l’abritaient. Tout commençait par elle, tout finissait par elle. » Blanche marche sur ses pas, petite « guerrière de cinq ans » bien décidée à survivre. Gabriel, lui, est « un garçon naïf, cassé par la mort de ses parents ». Il se tient dans l’ombre de ces deux femmes qui le portent à bout de bras, et trouve parfois en Louis, avec qui il partage sa chambre, un semblant de complicité. Blanche lutte, avance, grandit. Elève brillante, alors même qu’elle passe tout son temps libre à travailler à la ferme, elle ne cherche pas d’autre avenir que celui qui s’offre à elle. Un jour, son voisin de table, Alexandre, lui propose un marché : contre son aide en mathématiques, il fera la publicité de la ferme. Elle accepte, se laisse peu à peu apprivoiser et finalement tombe amoureuse. Comment résister à Alexandre, à son sourire enjôleur, à son assurance joyeuse ? Sous les yeux jaloux de Louis, Blanche cède tout entière à sa passion pour Alexandre....
Dans une coque de noix, Ian Mac Ewan
écrit par Fleur Bournier
Confiné dans le ventre de sa mère, un fœtus mène l’enquête. Que complotent sa mère et son amant ? Comment sauver son père du mauvais coup que ces deux-là semblent tramer ? Clin d’œil malicieux à Hamlet, Dans une coque de noix revisite avec humour le roman policier. Dans une coque de noix est un petit roman qui regorge de bien des surprises. A commencer par le choix d’un narrateur peu ordinaire, un fœtus : « Me voici donc, la tête en bas dans une femme. Les bras patiemment croisés, attendant, attendant et me demandant à l’intérieur de qui je suis, dans quoi je suis embarqué ». Espiègle, fin œnologue et féru de programmes en tout genre, celui-ci ne recule devant rien pour parfaire son éducation in vivo : « Au milieu d’une longue nuit calme, il m’arrive de donner un bon coup de pied à ma mère. Elle se réveille, cède à l’insomnie, prend la radio. Un divertissement cruel, certes, mais au matin, nous sommes tous deux mieux informés ». Le narrateur-fœtus offre au lecteur sa perception du monde, lacunaire, drôle, et d’autant plus jouissive que très vite le récit prend des allures de roman policier. Alerté par des bribes de conversations entre sa mère et son amant, le narrateur-fœtus revêt la casquette de détective. Il entend bien mener son enquête et trouver le fin mot de l’histoire. Les informations qu’il glane lui font craindre que les deux comploteurs ne s’en prennent à son cher poète de père, mis à la porte de chez lui par sa mère et allant de maladresse en maladresse pour la reconquérir. Prêt à voler à son secours, sa condition l’embarrasse. Que faire ? D’autant que d’autres révélations vont ébranler ses certitudes… Dans une coque de noix, Ian McEwan, traduction France Camus-Pichon, Gallimard folio, 240...
La Montagne Magique, Thomas Mann
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lecture idéale pour temps de confinement que La Montagne magique, paru en 1924, le chef-d’œuvre de Thomas Mann, à la fois par sa taille et son sujet. On plonge dans cette somme de mille pages que son auteur mit plus de dix ans à écrire, à la fois roman de formation et réflexion sur le temps. Interminable et fascinant. Hans Castorp, jeune ingénieur allemand de vingt-quatre ans fraîchement diplômé, va passer trois semaines au Berghof, le sanatorium de Davos, en 1907, pour rendre visite à son cousin Joachim Ziemssen qui y soigne sa tuberculose. Et là, il découvre un autre monde : le « monde d’en haut » qui s’oppose au « pays plat », un monde différent, comme hors du temps. Peu à peu, il se laisse gagner, envoûter par le rythme lent et régulier de cette vie jusqu’à refuser de retourner dans la plaine. Il passe sept ans parmi « ceux d’en haut », sept ans de formation pendant lesquels il fait l’expérience de la maladie, de l’amour, de la mort et du temps suspendu. Au Berghof, Hans Castorp, « notre insignifiant héros » comme le nomme Thomas Mann, découvre des usages étonnants, un vocabulaire, des objets nouveaux (les confortables et ingénieuses chaises longues, les deux couvertures en poil de chameau et le sac de fourrure…) Comme dans un couvent retranché du monde, la vie s’y écoule avec ses rites quotidiens qui rythment la journée, (les cinq repas copieux, les cures de repos, les prises de température) ses grands messes (les conférences d’initiation à la psychanalyse, les concerts…) et ses grands prêtres (les médecins). Il s’intègre au groupe des malades, galerie de portraits, parfois presque des caricatures, venus de différents pays et milieux, sorte de société en miniature avec ses usages codés, sa hiérarchie – il y a la table des « Russes bien » et celle des « Russes ordinaires », même ici on ne se mélange pas! Parmi eux, quelques figures se distinguent et particulièrement les deux mentors antagonistes qui se disputent son éducation et s’affrontent dans de longues joutes verbales : Settembrini, l’italien beau parleur, franc-maçon humaniste et Naphta, le jésuite fanatique, obscurantiste inquiétant. Et puis, au trois quart du livre, après de longs développements philosophiques, comme si l’auteur voulait réveiller l’attention du lecteur, surgit un nouveau personnage, fascinant, grandiose, charismatique : Mynheer Peeperkorn, un riche commerçant hollandais accompagné de son valet de chambre malais, sorte de dieu païen qui lui donne une dernière leçon de vie. L’autre figure majeure est celle de Claudia Chauchat, la jeune russe dont il tombe instantanément et désespérément amoureux. Fasciné par les pommettes saillantes et les yeux bleu gris de la jeune femme, ces yeux de « loups des steppes » qui lui rappellent ceux de Pribislav Hippe, son camarade de collège. A l’intérieur du sanatorium, la mort, pourtant fréquente, se fait discrète, presque habituelle et banale ; elle emporte les jeunes filles malades que le médecin appelle ses « petits pinsons poitrinaires ». Seul signe visible « une chambre « abandonnée », une chambre devenue libre, une chambre que l’on désinfecte. » Elle devient présente et prégnante quand le narrateur décrit et accompagne les derniers moments de l’un de ses protagonistes. En vingt-quatre heures, la maladie fait du jeune homme un vieillard : « il franchissait au galop les âges qu’il ne lui était pas accordé d’atteindre dans le temps. » Curieusement, pour Hans Castorp, la prise de conscience de sa finitude passe par la radiographie : lorsqu’il voit l’image de sa main « (il) vit ce qu’il n’aurait jamais dû s’attendre à voir, mais ce qui, en somme, n’est pas fait pour être vu par l’homme, et ce qu’il n‘avait jamais pensé qu’il fût appelé à voir; il regarda dans sa propre tombe (…) et, pour la première fois de sa vie, il comprit qu’il mourrait. » Mais surtout, même si la maladie et la mort rôdent à chaque moment, il semble que le but de Thomas Mann ait été d’écrire un roman sur le temps, comme il le...
Jetez moi aux chiens, Patrick McGuinness
écrit par Fleur Bournier
Inspiré d’un réel pugilat médiatique, Jetez moi aux chiens met à nu une société avide de faits divers et de coupables tout trouvés, solidement nourrie par une presse à sensation sans scrupule. Un faux roman policier et une vraie petite pépite littéraire. Jetez moi aux chiens commence comme un polar : après un premier chapitre déroutant, le lecteur est plongé dans une sordide affaire de meurtre, qui n’est pas sans rappeler un véritable fait divers. En décembre 2010, à Bristol en Angleterre, une jeune femme est portée disparue, puis retrouvée morte, étranglée. Noël approche, il faut résoudre l’affaire au plus vite. Un premier suspect est rapidement arrêté, son propriétaire et voisin, Christopher Jefferies. Les journaux s’emparent aussitôt de ce fait divers et condamnent cet ancien professeur sans aucune forme de procès : cet homme cultivé et singulier incarne le coupable idéal. Quelques jours plus tard, l’assassin est arrêté, Christopher Jefferies disculpé. Cette histoire de violence ordinaire est le canevas du nouveau roman de Patrick McGuinness. L’auteur y rend une forme de justice à celui qui a été pour lui un professeur bienveillant et qui a apporté un peu de joie dans sa scolarité au sein d’une école privée élitiste. Dans son roman, M. Wolphram, le suspect, est un double fictif assez transparent de Christopher Jefferies. Du jour au lendemain arrêté puis inculpé, il voit son mode de vie passé au crible. La presse, le rebaptisant opportunément « Le Loup », en fait le coupable idéal. Ainsi, chaque détail devient une preuve irréfutable de sa culpabilité : ses goûts musicaux et cinématographiques, son célibat, le moment de son départ à la retraite (quand l’école devient mixte). « Quand l’innocence est aussi louche, on n’a que faire de la culpabilité » constate amèrement le narrateur-enquêteur. Néanmoins,...
Journal, Sandor Marai
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De 1943 à sa mort en 1989, le grand écrivain Sandor Marai tient son Journal, dont de larges extraits sont aujourd’hui publiés en français. Ce premier tome, intitulé Les années hongroises 1943-1948, couvre la période de la guerre, de l’occupation allemande à l’occupation soviétique. Passionnant. Durant ces cinq « années hongroises », que l’on pourrait aussi nommer années tragiques ou décisives, Sandor Marai est au cœur des grands drames du XX° siècle. Dans la capitale et à la campagne, il vit l’occupation nazie, la déportation des Juifs (dont son beau-père), les bombardements alliés, le siège de Budapest, la libération par l’armée rouge et la prise de pouvoir des communistes. Son beau-père est déporté, son appartement détruit par les bombes, sa maison de campagne réquisitionnée pour loger seize soldats de l’armée soviétique (plutôt sympathiques ces jeunes Russes admiratifs de l’écrivain). Ecoeuré par le nouveau régime, par la nationalisation des esprits et la confiscation des libertés, attaqué par la presse communiste, l’écrivain bourgeois (comme il aime à se qualifier) fuit ce pays dans lequel il n’a plus sa place. Il s’exile, la mort dans l’âme, et part vers la Suisse et l’Italie n’emportant que cinq livres dont L’Odyssée (lui qui possédait avant les bombardements une bibliothèque de plus de cinq mille livres.) Quitter la Hongrie est pour lui la seule manière de continuer à faire vivre la langue et la littérature hongroise. Ce qui surprend dès les premières pages, c’est la forme originale de ce journal sans indications de dates. Constitué de paragraphes séparés par un trait, l’ouvrage est fait de notations plus ou moins brèves, de réflexions (entre Choses vues de Victor Hugo et Maximes de La Rochefoucauld), parfois de micro-récits, presque des nouvelles avec chute. Ce qui étonne aussi c’est l’humour dont fait preuve l’auteur (humour...
Mon Nouveau Testament, Simone
écrit par Marie-Odile Sauvajon
C’est un petit livre étrange, découvert par hasard. Petit par son format et son nombre de pages. Etrange par son titre et le nom de son auteure. Après quelques recherches, on apprend vite que « Simone » est en fait le pseudonyme de Pauline Benda, actrice et femme de lettres du siècle passé. A quatre-vingt-treize ans, elle écrit ce dernier livre, Mon Nouveau Testament, confession autobiographique sur son parcours de vie et ses croyances. Issue de la bourgeoisie juive parisienne, Pauline Benda est marquée très jeune par la mort de son père. Sa foi est ensuite ébranlée sous l’influence de son frère aîné, étudiant en philosophie. Elle entreprend des études à la Sorbonne, suit les cours de psychologie expérimentale de Théodule Ribot au Collège de France et les expériences de ce dernier sur les malades à la Salpêtrière et à Sainte-Anne. Au grand dam de sa mère, qui exige que sa fille mette fin à ses visites à l’hôpital et suive des cours de diction… si bien qu’elle devient actrice et épouse son professeur de diction. Mais le grand amour de sa vie est Alain-Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes de dix ans son cadet avec lequel elle vit à partir de 1913 une brève liaison passionnée (1); le jeune officier meurt prématurément en septembre 1914. Revenant sur les événements qui ont marqué sa vie, elle raconte dans son ultime ouvrage comment la mort brutale des deux hommes qu’elle a le plus aimés et l’importance de la science et de la raison l’ont éloignée de la religion. Même si ne plus croire en un au-delà veut dire se résigner à ne jamais retrouver les êtres chers disparus, elle refuse les fausses consolations : « Je ne me rappelle pas être jamais retournée au pays où tout est possible,...
Kaputt, Malaparte
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Témoin privilégié, spectateur désabusé, Curzio Malaparte raconte dans un roman terrible et magnifique ce qu’il a vu entre 1941 et 1943 sur le front de l’Est. Paru en 1944, controversé et trop oublié, Kaputt est le premier roman sur la seconde guerre mondiale et l’un des plus grands, « un livre horriblement cruel et gai » selon son auteur. L’histoire du manuscrit est à elle seule un roman : commencé en Roumanie, caché par un paysan, confié à un diplomate espagnol. Objet de polémique dès sa réception, le livre souffre sans doute de la réputation de son auteur mégalomane, brièvement partisan de Mussolini avant de critiquer le régime. Le titre Kaputt donne le ton « Aucun mot (…) ne saurait mieux indiquer ce que nous sommes, ce qu’est l’Europe, dorénavant : un amoncellement de débris. » Les titres de chaque partie « Les chevaux, Les rats, Les chiens, Les rennes » disent la déshumanisation, la barbarie à l’oeuvre. Partout, le froid, la faim, la mort et surtout le cynisme, la bonne conscience des bourreaux, l’entreprise rationnelle d’extermination. Dans ce roman qui raconte l’horreur et la cruauté de la guerre, il y a cependant encore place pour la beauté des choses. Admirateur de Chateaubriand dont il dit s’inspirer, Malaparte tient aussi de Proust pour les descriptions somptueuses. Un chapitre s’intitule d’ailleurs « Du côté de Guermantes ». Dans une langue virtuose et souvent métaphorique, il transfigure le champ de bataille en gravure de Dürer : «Les chars et les troupes d’assaut avançant dans les sillons tracés par les chenilles semblaient gravés au burin sur la plaque de cuivre de la plaine ». En esthète, Il évoque les notes pures et légères d’un prélude de Chopin écouté par les dignitaires nazis ou le rouge sanglant d’un vin de Bourgogne qui rappelle, dans la nuit blanche...
Le Hussard sur le toit, Giono
écrit par Marie-Odile Sauvajon
En Italie, l’épidémie de coronavirus a fait grimper les ventes de La Peste de Camus. D’un mal peut -il sortir un bien, un classique comme antidote en temps de crise sanitaire? Mais à Oran et aux rats, au docteur Rieux et à Tarroux, on peut préférer Angelo et la Provence de Giono. Les deux romans paraissent aux lendemains de la seconde guerre mondiale, l’un en 1947, l’autre en 1951 et donnent du nazisme, du Mal en général la même représentation métaphorique : celle de la maladie contagieuse, de l’épidémie redoutée. Mais là où Camus illustre, à travers ces personnages prisonniers dans la ville, les différentes réactions humaines face au malheur collectif (courage, solidarité, opportunisme, égoïsme, mysticisme…), Giono nous entraine dans une folle aventure faite d’héroïsme, de joie de vivre insolente et de légèreté. Angelo Pardi, le colonel des hussards, le carbonaro piémontais en fuite qui traverse la Provence, c’est tout cela à la fois : quelqu’un qui n’hésite pas à soigner les malades, à laver les cadavres mais qui garde toujours la tête haute, l’allure, la grâce, tel « un épi d’or sur un cheval noir ». Son remède contre la contagion? Ne pas avoir peur, mépriser la maladie. Il est dans la mêlée mais il la domine puisqu’il gambade sur les toits de Manosque et il lui échappe en galopant de collines en villages. On en arrive à ce paradoxe curieux : même si Giono décrit avec précision (et invention) les symptômes de la maladie, le détail des agonies, même si l’on découvre des villages abandonnés, des régions dévastés, Le Hussard reste un livre alerte et presque joyeux, irrigué par la jeunesse et l’énergie de son héros. Et par la beauté lumineuse de Pauline de Théus. Car c’est aussi une grande histoire d’amour, même si les deux protagonistes ne se rencontrent qu’au bout de deux cents pages et que leur relation reste idéale. Jamais sordide, toujours sublime. Peut-on choisir entre la peste et le choléra? Lisez (ou relisez) Le Hussard sur le toit. Le Hussard sur le toit, Jean Giono, 1951, Folio, 512 pages. La Peste, Albert Camus, 1947, Folio, 416...
Un été sans les hommes, Siri Hustvedt
écrit par Fleur Bournier
Avec humour et finesse, Siri Hustvedt trace le parcours d’une femme blessée qui trouve en ses pairs et en elle-même une force insoupçonnée. Un roman féminin et féministe, drôle, émouvant et intelligent. A partir de la trame narrative rebattue de l’époux infidèle, Siri Hustvedt fait un pas de côté. Elle ne racontera ni les cris ni les larmes, mais la reconquête de soi et de sa liberté, dans une tendre célébration des femmes qui leur rend justice : « La banalité de l’histoire – le fait qu’elle soit répétée chaque jour ad nauseam par des hommes qui, s’apercevant tout à coup ou petit à petit que ce qui EST pourrait NE PAS ÊTRE, font dès lors en sorte de se libérer des femmes vieillissantes qui ont, pendant des années pris soin d’eux et de leurs enfants – n’amortit pas le chagrin, la jalousie et l’humiliation qui s’emparent des abandonnées. Femmes bafouées. » Mia, poétesse de 55 ans, fait le récit sans complaisance et plein d’humour de sa difficile reconstruction après la défection de son époux, une «pause» selon lui, ce qui vaut à sa maîtresse d’être affublée de ce sobriquet :« La Pause était française, elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d’étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de vingt ans plus jeune que moi ». Remise de sa «crise psychotique», Mia préfère quitter New York pour tenter de se reconstruire. Elle s’installe à Bonden pour l’été, ville de son enfance où vit encore sa mère dans une résidence pour personnes âgées. Elle y enseigne la poésie à des adolescentes «dans le cadre du Cercle artistique local». Une galerie de personnages féminins représentant tous les âges de l’existence y entoure peu à peu...
Le cœur de l’Angleterre, Jonathan Coe
écrit par Fleur Bournier
Prix du livre européen 2019, Le Cœur de l’Angleterre, le dernier roman de Jonathan Coe, dresse un portrait cinglant de l’Angleterre des dernières décennies. L’auteur interroge avec un humour caustique et décalé les évènements qui ont pu conduire au Brexit. Un roman réjouissant autant qu’effarant. Dans son dernier opus, Jonathan Coe renoue avec les personnages de Bienvenue au Club, et de sa suite Le Cercle fermé, les membres de la famille Potter, choix non prémédité qui s’est finalement imposé à lui. Nulle nécessité cependant d’avoir lu les deux précédents pour savourer le dernier en date. Le roman s’ouvre en 2010 alors que Benjamin et Loïs Potter enterrent leur mère. Benjamin a à présent la cinquantaine et vit isolé dans un moulin retapé. Sa sœur reste hantée par les évènements traumatisants de son passé. Autour d’eux, membres de la famille ou amis créent un microcosme reflétant ce qui se joue à plus grande échelle dans le pays et qui va conduire au Brexit. La narration, à sauts et à gambades, suit différents personnages, allant de l’un à l’autre, les laissant en suspens, avant de les retrouver des jours, des semaines ou des mois plus tard. Ces nombreuses ellipses insufflent un rythme au récit, tendu vers l’avant, celui de l’engrenage dans lequel est prise l’Angleterre et qui la conduit à l’inimaginable. Les titres des trois parties qui composent le roman –La joyeuse Angleterre, L’Angleterre profonde, La vieille Angleterre- révèlent ce retour en arrière aussi imprévisible qu’inquiétant. L’histoire politique de l’Angleterre du début du millénaire, retracée par l’auteur non sans une ironie acerbe, n’est pas inconnue du lecteur. Néanmoins c’est avec une profonde incrédulité qu’il se voit replonger dans la campagne nauséabonde du Brexit. Sous couvert de la promesse de redevenir une nation puissante, certains politiques, appuyés...
Par les routes, Sylvain Prudhomme
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Roman fluide et prenant, Par les routes de Sylvain Prudhomme évoque, à travers l’histoire croisée de deux amis, la multiplicité des possibles et les aspirations contraires. Sacha, écrivain parisien, la quarantaine, décide de tout quitter. « Envie de table rase. De concentration. De calme. » Il vide ses placards et ses étagères, part avec deux sacs de livres et de vêtements dans un meublé à V., petite ville du Sud-Est de la France. « En route pour la vie que je voulais. Ramassée. Sobre. Dense. » Mais il y retrouve par hasard un ancien ami perdu de vue depuis depuis dix-sept ans. Apparemment installé – une femme, un enfant, une maison (en location) – celui qu’il nomme « l’autostoppeur » est régulièrement pris de l’envie de partir à travers la France en auto-stop. Au cours de ses voyages, de ses échappées, il envoie des cartes postales et des polaroïds, portraits des automobilistes qu’il a rencontrés. Peu à peu, les liens se tissent entre Sacha et la famille de son ami, sa femme Marie, son fils Agustin; Sacha devient de plus en plus présent, l’autostoppeur, de plus en plus absent; il s’éloigne jusqu’à disparaître. Le propos du livre est cependant moins de raconter une histoire d’amour qu’une histoire d’amitié, on pourrait presque dire de gémellité. Sacha et l’autostoppeur, celui qui reste et celui qui part, sont à la fois proches et opposés. Leurs désirs semblent contraires mais dans les deux cas il s’agit de liberté, d’indépendance, de solitude et de rencontres nouvelles. On peut même parfois se demander, puisque l’auto-stoppeur n’est jamais nommé, s’ils ne sont pas au fond qu’un seul et même personnage, incarnant les facettes contradictoires d’un même individu. Comme dans le Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, cet ami ne serait-il qu’un double « une figure de sa jeunesse, de...
Retour à Reims, Didier Eribon/Thomas Ostermeier
écrit par Fleur Bournier
Dans un spectacle fort et émouvant, Thomas Ostermeier s’empare du récit sociologique et autobiographique de Didier Éribon pour affirmer la force d’engagement du théâtre. Le directeur de la Schaubühne de Berlin relève avec brio la gageure de mettre en scène ce texte que rien a priori ne destinait au théâtre. A la mort de son père, qu’il avoue n’avoir jamais aimé, Didier Éribon retourne dans sa ville natale, Reims. Il y retrouve sa mère, les quartiers ouvriers, les usines à présent désaffectées, des racines reniées. La honte qui fut sienne aussi, celle de son homosexualité dans un milieu profondément homophobe, celle de ses origines prolétaires. Le sociologue est enfin prêt à une forme de réconciliation, une acceptation tout du moins, il fait face au chemin parcouru : existe-t-il un lien entre l’affirmation de son homosexualité et son ascension sociale ? Celle-ci n’est-elle pas finalement la seule réponse qu’il sut trouver pour assumer sa sexualité ? Des questions sur sa double trajectoire émergent et font naître une réflexion politique et sociologique sur les catégories sociales et leurs représentations, plus particulièrement sur la classe ouvrière et son virage spectaculaire d’un vote communiste à un vote extrême droite. Didier Éribon sonde la responsabilité de la gauche, l’accuse d’avoir oublié ceux qu’elle défendait, de s’être pervertie une fois au pouvoir. Dans un studio d’enregistrement de banlieue, une actrice – formidable Irène Jacob – enregistre la voix off d’un film documentaire sur Didier Éribon : une lecture de son essai Retour à Reims. Le réalisateur et le régisseur ne semblent – au départ – que des figurants, isolés dans une régie sur scène. Le film, tourné par Ostermeier avec la participation de Didier Eribon, est projeté sur grand écran en fond de scène et donne corps aux mots : images de la province honnie, de ses habitants, de ses quartiers défavorisés, mais aussi très émouvante visite à sa mère. « Il m’a paru important de rendre compte, concrètement, de la dimension autobiographique de ce livre. Pour cela, nous avons réalisé un film documentaire, sommes allés à Reims avec Didier Éribon, chez sa mère, dans sa cuisine, mais aussi dans certaines rues de Paris… » explique le metteur en scène. Pour autant, le film n’illustre pas mais prolonge le récit autobiographique. Le dispositif déconcerte tout d’abord un peu : le spectacle consiste-t-il en une lecture ? La distanciation qu’offre cette mise en scène, ainsi que la lecture d’Irène Jacob au rythme des images, font affleurer la sensibilité de ce très beau texte. L’émotion s’installe. L’actrice s’interrompt soudain et remet en question les choix du réalisateur. Le spectacle se dévoile : l’œuvre d’Éribon constitue le point de départ d’une réflexion qui se livre en partie sur scène et qui vient aussi interroger la dimension politique du théâtre. Les luttes d’hier se mêlent alors aux luttes d’aujourd’hui. La parole d’Éribon s’efface, laisse place à celle des acteurs, à leurs propres questionnements et à leur propre histoire. A la question « comment faire du théâtre engagé aujourd’hui ? » Thomas Ostermeier répond par ce spectacle multiple, à la fois lecture et film documentaire, qui mêle réflexion politique et histoires personnelles. Retour à Reims, d’après Didier Eribon, mise en scène Thomas Ostermeier, 1h55, à Lyon, aux Célestins jusqu’au 25 janvier...
Tout le monde n’habite pas, Jean-Paul Dubois...
écrit par Fleur Bournier
Récompensé par le Goncourt 2019, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, le dernier Jean-Paul Dubois, sans constituer une lecture indispensable, offre au lecteur un moment agréable et distrayant. « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» nous prévient le titre. Pour Paul Hansen, le narrateur, il s’agit de s’adapter à la vie au pénitencier de Montréal dans une cellule de six mètres carrés, qu’il partage avec Patrick Horton, un Hells Angel en attente de jugement pour meurtre, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos – Life is a bitch and then you die – et celle de son amour pour les Harley Davidson sur l’arrondi des épaules et le haut de la poitrine. » Cet impressionnant compagnon de cellule se révèle au fil du roman bien plus sympathique qu’il n’y pouvait paraître. Sous sa carcasse de géant, Horton cache une âme d’enfant, effrayé par les rongeurs, intimidé par une visite de sa mère et tétanisé par des ciseaux de coiffeur. Les deux hommes apprennent au fil des jours à s’apprivoiser, à préserver ce qu’il faut d’humanité dans la promiscuité. L’omniprésence d’Horton est ce qui pèse le plus à Paul, il s’évade donc constamment dans souvenirs et rêveries, et accueille les fantômes qui lui sont chers : son père, le pasteur Jansen, sa femme Winona, sa chienne Nouk. Paradoxalement, Jean-Paul Dubois fait de la prison un espace où son personnage acquiert « une forme de liberté incroyable ». Ainsi qu’il l’explique lors d’une interview pour France Culture : « ces deux années vont lui permettre de reconsidérer le monde, de reconsidérer sa vie et de reconsidérer ses souvenirs, de vivre avec ses morts, de vivre ce passé, de comprendre tout un tas...
LaRose, Louise Erdrich
écrit par Fleur Bournier
Dans un roman puissant et envoûtant, Louise Erdrich interroge la notion de justice à travers l’histoire de deux familles Ojibwé, les Iron et les Ravich. Comment réparer l’irréparable ? Peut-on dépasser son désir de vengeance ? Comment aider à se reconstruire ceux que le chagrin dévaste ? Autant de questions que l’autrice explore avec force, subtilité et talent. Les premières pages coupent le souffle, plongeant le lecteur dans un récit dramatique poignant : Landreaux Iron, « un catholique pieux et respectueux des coutumes indiennes », tue accidentellement à la chasse le fils de son voisin et ami Peter Ravich : « Quand la bête s’enfuit d’un bond, il se rendit compte qu’il avait touché autre chose – il y avait eu comme un mouvement désordonné lorsqu’il avait appuyé sur la détente. S’étant approché pour voir, il baissa les yeux et ne comprit qu’à ce moment-là qu’il avait tué le fils de son voisin ». La narration mêle ensuite adroitement présent et passé, dévoilant le poids des traditions et le rôle des fantômes du passé dans l’engrenage de la machine tragique qui vient de se mettre en place. Face à l’inconcevable et l’irréparable, c’est dans les anciennes coutumes Ojibwé que Landreaux et Emmeline Iron vont chercher à rendre justice aux Ravich. Dusty avait cinq ans, tout comme leur propre enfant LaRose, ils décident donc – comme leurs ancêtres le faisaient autrefois – de donner leur fils en réparation. Mais la justice peut-elle encore se concevoir ainsi aujourd’hui ? Un fils peut-il en remplacer un autre, même s’il porte le nom mystique de LaRose ? Le titre éponyme du roman en est ainsi le fil, tendu entre plusieurs époques : un nom qui se transmet de génération en génération et qui semble donner une aura toute particulière à celui ou celle qui le porte : « C’était un prénom à...
La Mer à l’envers, Marie Darrieussecq
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Marie Darrieussecq a le don d’être en résonance avec les sujets d’actualité et de nourrir ses romans de son expérience. Son dernier roman, La Mer à l’envers, croise ainsi l’itinéraire d’un migrant nigérien et l’histoire d’une femme au tournant de sa vie. Partie en croisière sur la Méditerranée avec ses deux jeunes enfants, Rose, quadragénaire en pleine crise conjugale, fait une rencontre qui la bouleverse. Le 24 décembre, quand l’énorme paquebot recueille des migrants naufragés d’un petit chalutier, son regard croise celui de Younès, un adolescent nigérien. Et c’est une reconnaissance immédiate : « Si j’adoptais un enfant, ce serait lui. » Elle lui donne des vêtements, le portable de son fils. Les migrants débarquent en Italie, la croisière continue. Alors qu’elle est revenue à Paris, Rose reçoit un appel de Younès sur son portable. D’abord, elle ne répond pas, elle fuit, elle élude, elle hésite. Quelques mois plus tard, alors qu’elle a déménagé avec sa famille dans le Pays Basque, nouveau coup de fil : Il est blessé, épuisé. Elle part à Calais, le ramène, l’installe dans la chambre d’ami, le nourrit, le soigne. Le jeune migrant noir serait-il en train de devenir un nouveau personnage de roman? On pense aussi à Arcadie d’Emmanuelle Bayamack-Tam, à L’Archipel du chien de Philippe Claudel et à bien d’autres… Comme Vendredi, il est celui qui trouble, éblouit et remet en question. Mais Marie Darrieussecq n’écrit pas un livre sur les migrants et encore moins un livre à thèse. Dans La Mer à l’envers (que l’on peut entendre aussi comme la mère à l’envers) le personnage principal c’est Rose Goyenetche la « psychologue bizarre » qui soigne par imposition des mains, don qu’elle tient de sa grand-mère, la mère aimante et désarmée face à l’évolution de ses enfants, la quadragénaire qui...
Les Livres de Jakob, Olga Tokarczuk
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lire Les Livres de Jakob, le dernier roman d’Olga Tokarczuk, Prix Nobel de Littérature 2018, c’est plonger dans la Pologne du XVIII° siècle, découvrir l’histoire véridique et méconnue du «messie» Jakob Frank et partager le quotidien d’une multitude de personnages. Un livre-somme foisonnant et captivant. Il y a tout d’abord l’objet-livre. Sa taille, son poids. Et son titre complet, parodiant les romans du XVIII°, qui est tout à la fois un résumé, un programme et une promesse : Les Livres de Jakob ou Le Grand Voyage A travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d’autres moindres. Rapporté par les défunts, leur récit se voit complété par l’auteure selon la méthode des conjectures puisées en divers livres, mais aussi secourues par l’imagination qui est le plus grand don naturel reçu par l’homme. Mémorial pour les Sages, Réflexion pour mes Compatriotes, Instruction pour les Laïcs, Distraction pour les Mélancoliques. Et enfin, lorsqu’on démarre la lecture, sa numérotation inversée déroute – on commence à la page 1029 et on finit à la page 4 – référence à la Kabbale et image de la vie qui, contrairement à l’idée reçue, serait une perte permanente : « Nos conquêtes, nos enrichissements sont la plus grande des illusions. En réalité, nous sommes au summum de notre richesse à notre naissance, ensuite nous ne faisons que nous délester de tout. » Tout commence par un mariage dans la demeure d’un marchand juif, Elisha Shorr : un couple se forme, une aïeule s’éteint, la joie côtoie la tristesse, et Nahman, un invité venu de Turquie, « un étranger en bas blancs et sandales », parle d’un certain Jakob. Elisha Shorr décide alors de faire venir cet homme providentiel en ce temps de pogroms et de persécutions : « Nous avons besoin de quelqu’un qui nous...
Joseph Anton, Salman Rushdie
écrit par Fleur Bournier
Il aura fallu des années à Salman Rushdie pour oser se replonger dans les années les plus sombres de sa vie, celles de la fatwa, afin d’en livrer le récit, et de se réapproprier une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre mais qui reste avant tout la sienne. Ecrit à la troisième personne, Joseph Anton se lit comme un roman policier, qui donnerait la parole à la victime prise dans une toile d’araignée. L’histoire de la fatwa prononcée par l’Ayatollah Khomeiny suite à la parution des Versets sataniques en 1989 est bien connue, néanmoins les rouages politiques et éditoriaux de cette affaires, et ses conséquences sur la vie de l’auteur, décrits dans Joseph Anton surprennent jusqu’à la dernière page le lecteur. Aujourd’hui la manière dont cette affaire a été traitée semble incroyable. La fermeté face à l’obscurantisme, au terrorisme, va de soi. Cela ne fut à l’époque pas aussi tranché. L’auteur a essuyé de nombreuses critiques et attaques, venant de journalistes peu scrupuleux et avides de gros titres, mais aussi d’intellectuels et de personnalités politiques. Il s’est vu fermer de nombreuses portes, sa liberté se réduisant peu à peu : interdiction de vols sur les plus grandes compagnies aériennes, refus d’autorisation de séjour, invitations à des évènements littéraires ajournées, refus des éditeurs de publier en poche Les Versets sataniques mais aussi ses nouveaux romans, … Innocent mais prisonnier de la protection de la Special Branch, se battant pour la liberté mais en étant privé, c’est à un véritable combat pour reconquérir ses droits que se livra Rushdie, un combat pour lui mais avant tout pour tous, pour que la parole des écrivains ne soit plus menacée. Pour autant, Rushdie ne se peint pas en héros de la liberté ; il ne s’épargne guère et...
Girls, Edna O’Brien
écrit par Fleur Bournier
Edna O’Brien s’empare dans son dernier roman d’un évènement tragique qui suscita l’émoi l’international en 2014 : l’enlèvement d’une centaine de lycéennes par Boko Haram au Nigéria. Quelques années plus tard, certaines se sont enfuies, d’autres ont été libérées, d’autres encore sont toujours portées disparues. L’autrice retrace le parcours de l’une d’entre elles dans un récit bouleversant. « J’étais une fille autrefois, c’est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier. Emmenée en trombe à travers cette forêt que j’ai vue, cette première nuit d’effroi, quand mes amies et moi avons été arrachées à l’école. » Ainsi s’ouvre le dernier roman d’Edna O’Brien. Des phrases incisives qui placent d’emblée le lecteur sur la crête du soutenable. De courts chapitres, écrits à la première personne, se succèdent, comme autant d’incursions dans l’esprit chancelant de Maryam, jeune fille enlevée par Boko Haram et réduite en esclavage. Des fragments terrifiants d’une vie en lambeaux. Des instantanés qui retracent le calvaire de la jeune fille, violée, mariée de force, mais qui trouve la force de fuir, de survivre et d’être mère : « Je ne suis pas assez grande pour être ta mère. » confie-t-elle, exténuée et désespérée, à son bébé. L’horreur du camp djihadiste, la fuite éperdue dans la forêt avec son bébé, Babby, et une de ses compagnes, Buki, ne sont pas les dernières épreuves que doit endurer Maryam. Suspecte plus que victime, elle doit encore prouver qu’elle ne s’est pas convertie et ne représente aucun danger. Pire, elle reste, même aux yeux des siens, « une femme du bush » marquée du sceau de l’infamie. Les retrouvailles tant espérées avec sa mère, son père et son frère n’ont pas lieu. C’est de retour dans son village que les derniers remparts de la jeune fille cèdent : « Au milieu de toute cette prière, de ces mea culpa et de cette hypocrisie, quelque chose en moi s’est noirci. Je m’en suis approchée. Je l’ai étreinte. J’y suis entrée, dans la noirceur. » Edna O’Brien ne nous épargne aucune des violences subies par les jeunes filles enlevées, mais son écriture toute en pudeur et en retenue leur rend leur dignité. Et la belle traduction d’Aude de Saint-Loup et de Pierre-Emmanuel Dauzat ne la trahit en rien. Le lecteur s’accroche à la beauté des mots, des phrases, refuges contre la noirceur environnante : « Parfois je suis dans la forêt, une forêt peu familière, vidée de toute humanité. Les arbres sont gigantesques, leurs troncs gris noueux. Ils parlent un parler noueux. » La parole de Maryam semble se déployer dans un seul souffle, laissant le lecteur suspendu à ce flot qui le plonge dans un récit atroce et sublime. La parole se révèle au fil des chapitres l’un des enjeux du récit puisqu’elle est la clef de la liberté : censurée au camp djihadiste, impossible face à son thérapeute tant la jeune fille reste prisonnière du cauchemar vécu : « Je lui dis des choses, pour ne pas lui dire des choses […]. Il sait qu’il y a plus à dire, mais que je ne peux pas. Entre nous il y a ce fossé béant. » ; puis, elle surgit, libère, et permet de reprendre en main son destin volé : « Je n’arrive pas à croire que je lui raconte, que je confesse réellement mon massacre nocturne. A chaque rêve, la nuit, ça devient plus sanglant. Je fais bouillir mes ravisseurs dans de grandes marmites noires. » Girl vient s’inscrit dans la continuité d’une œuvre qui s’attache à des parcours de femmes courageuses qui ont lutté pour leur liberté, à l’image de l’autrice elle-même. Le titre d’ailleurs en fait entendre un autre, The Country Girls, roman autobiographique dans lequel Edna O’Brien retrace son enfance dans une famille irlandaise conservatrice où la littérature et les femmes n’ont pas voix au chapitre. Un singulier en écho à un pluriel, une destinée qui vient en dire tant d’autres. Roman magistral et éprouvant, « Girl est un livre...
Souvenirs dormants, Modiano
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Un petit Modiano, mais un Modiano tout court. Quelques pages, quelques phrases, quelques mots simples et, dès la première ligne : « Un jour, sur les quais, le titre d’un livre a retenu mon attention », c’est tout un univers. Un univers fait de déambulations intimes dans Paris et dans le passé ( la collaboration, la guerre d’Algérie) avec un soupçon de roman noir (des personnages louches, un cadavre dans un appartement). Un univers peuplé de rencontres et de fantômes. Les souvenirs, en s’éloignant, se confondent avec l’imaginaire. Le narrateur tente de retrouver, cinquante ans après, les personnages et les lieux de sa jeunesse; l’écriture s’efforce de fixer, malgré la fuite du temps, les noms des disparus et leurs adresses. Cet univers est aussi le nôtre puisqu’il s’agit de souvenirs d’enfance et de l’histoire de France. N’avons-nous pas tous en nous des « souvenirs dormants » qu’un rien peut éveiller? « Après des dizaines d’années, ils remontent à la surface, comme des noyés, au détour d’une rue, à certaines heures de la journée. » Souvenirs dormants, Patrick Modiano, Folio, juillet 2019, 109...
Sous le volcan, Malcom Lowry
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Chef-d’oeuvre d’une modernité stupéfiante dans lequel on s’engouffre avec délice, et que l’on savoure chapitre après chapitre (l’idéal serait de le lire en douze jours, un chapitre par jour), Sous le volcan de Malcolm Lowry raconte la dernière journée de Geoffrey Firmin, consul de Grande-Bretagne à Quauhnahuac. Naufrage grandiose et pathétique d’un homme en proie à ses démons. Tout tient en une journée (ou plutôt en deux puisque le premier chapitre rappelle cette journée exactement un an plus tard), une journée qui contient aussi tout le passé des protagonistes. Le 1er novembre 1939, jour des morts, dans la chaleur étouffante d’une petite ville du Mexique, trois personnages déambulent : Geoffrey Firmin, l’ancien consul, Hugh, son demi-frère, et Yvonne l’ex-femme de Geoffrey. Leurs points de vue alternent au cours des chapitres, se croisent, se superposent. Ce matin-là, Yvonne tant espérée est revenue alors que le Consul émerge d’une nuit d’ivresse. Mais dès le premier chapitre, on sait qu’il est trop tard et que l’on s’achemine inéluctablement vers la tragédie : « Et l’amour pouvait bien vous priver de parole, vous aveugler, vous rendre fou, vous tuer (…) cela n’étanchait pas votre soif de pouvoir dire l’amour trop tard venu. » Le Consul, marqué par la guerre de 14, appartient à cette génération perdue qui sombre dans l’alcool comme Fitzgerald ou Hemingway, qui s’embarque comme Céline ou Conrad pour un voyage au bout de la nuit, au bout de l’enfer. Comme lui, Yvonne et Hugh ont leurs fêlures, leurs blessures secrètes et leurs désillusions. A l’image de sa vie, le jardin du Consul, laissé à l’abandon, est en ruines: Eden devenu Enfer, métaphore de l’amour passé devenu impossible. Sous l’emprise de l’alcool, Geoffrey entend des voix, est en proie à des hallucinations. La réalité et l’imaginaire se mêlent...
Les Invisibles, Roy Jacobsen
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Comme le roman victorien, russe ou picaresque le roman scandinave constitue presque un genre à part entière. Il est fait de récit initiatique, d’évocation de la vie rustique au rythme de la nature, des tempêtes et des saisons, de lutte incessante et toujours recommencée contre les éléments. Les Invisibles du norvégien Roy Jacobsen raconte ainsi la vie âpre et rude de la famille Barroy, paysans-pêcheurs au début du XX ème siècle, sur une petite île au sud des Lofoten. Ingrid a trois ans quand le roman commence, « une longue chevelure de la couleur du goudron, des yeux pétillants et des pieds qui ne connaitront pas de chaussures avant octobre. Mais d’où tient-elle ces yeux, où la bêtise morne de la pauvreté est tellement absente? » A sept ans, elle sait vider les poissons, mailler les filets de pêche, nettoyer le duvet d’eider, retourner les briques de tourbe; à douze ans, « elle sait à peu près tout faire. » Elle rêve de découvrir le vaste monde mais « lorsque l’on vit sur une île on n’en part jamais, on ne sait pas qu’une île s’accroche à ce qu’elle a, de toutes ses forces. » Quand le roman finit, elle est devenue mère, elle a connu l’irruption de la tragédie, l’adversité et les fantaisies du destin et avec cette force de vie qui est sienne, elle a fait face. C’est simple et beau, limpide et fort. Les Invisibles, Roy Jacobsen, traduit par Alain Gnaedig, Folio, 2019, 298...
La Cache, Christophe Boltanski
écrit par Fleur Bournier
Construit comme le plateau d’un jeu de Cluedo, La Cache retrace l’histoire de la famille Boltanski en progressant pièce après pièce dans l’appartement de la Rue-de-Grenelle, en commençant par « son prolongement, son sas, sa partie mobile, sa chambre hors les murs, ses yeux, son globe oculaire », sa voiture, une fiat 500. Ce début, pour le moins surprenant, permet de brosser le portrait d’une famille soudée, qui ne s’extirpe de l’habitacle que « main dans la main, collés les uns aux autres », formant ainsi « un seul être, une espèce de gros mille-pattes » dont la colonne vertébrale serait « Mère-Grand ». Chapitre après chapitre, les pièces se succèdent et s’assemblent, et le lecteur s’invite dans cette famille peu ordinaire qui vit ainsi repliée sur elle-même : « Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-mêmes. De la petite comme de la grande histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est toujours sür. Cette appréhension, ma famille me l’a transmise très tôt, presque à la naissance». Christophe Boltanski remonte dans un récit émouvant et drôle à la source de cette névrose familiale. Le roman autobiographique se fait témoignage et hommage, ode à cette grand-mère prête à tout pour protéger les siens. La Cache, Christophe Boltanski, 2017, éd. Gallimard, coll. Folio, 336 pages....
Un pied au paradis, Ron Rash
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Le Fleuve de la liberté raconte l’histoire de May, jeune couturière qui s‘émancipe peu à peu, trouve un travail, découvre un nouveau milieu, celui des acteurs du Théâtre flottant. Mais surtout, il crée une atmosphère, celle du fleuve, l’Ohio- au fond n’est-ce pas lui le personnage principal comme le suggère le titre?- et du bateau-théâtre. Au fil de l’eau, il nous entraine entre les deux rives que tout sépare, le Nord abolitionniste et le Sud esclavagiste, dans l’Amérique des années 1830. La découverte de l’asservissement des Noirs se fait peu à peu, pour le lecteur comme pour l’héroïne; la jeune femme est embarquée progressivement, par un enchaînement de circonstances, à faire traverser clandestinement des enfants noirs. Et l’on tremble pour May, personnage attachant dont on craint à tout moment qu’elle soit découverte. Certes, ce n’est pas le premier roman qui traite de la question de l’esclavage et de l’aide aux fugitifs mais Martha Conway le fait avec nuance et délicatesse, comme indirectement et d’autant plus efficacement. Les attitudes des différents personnages incarnent toute la palette des réactions humaines face à l’injustice : indifférence, laisser-faire, appât du gain, cruauté, engagement militant ou soutien indirect. C’est habile, et non sans charme. Prenant. Le Fleuve de la liberté, Martha Conway, traduit de l’anglais par Manon Malais, Le Livre de poche, mai 2019, 473 pages. Le Serpent de l’Essex a tout le charme d’un roman anglais, entre Jane Austen et Conan Doyle, avec un soupçon de Dickens. Amour, suspense, plongée dans la vie du XIX° siècle, des demeures aristocrates aux quartiers ouvriers de Londres en passant par un presbytère de campagne. Sarah Perry sait décrire avec précision les états d’âme de ses personnages comme les paysages au cours des saisons. Sa langue fluide et poétique nous entraîne dans...
My Absolute Darling, Gabriel Tallent
écrit par Fleur Bournier
Encensé par la critique, le premier roman de Gabriel Tallent a en effet tout pour plaire car il aborde, dans un style qui oscille entre poésie descriptive et oralité, bon nombre de thèmes d’actualité brûlants : le survivalisme, les dérives du deuxième amendement, la force de la Nature et surtout l’inceste. Dérangeant et haletant, My Absolute Darling met à rude épreuve le lecteur qui retient son souffle jusqu’au dernier chapitre. Le nom ou plutôt les noms de l’héroïne raconte son histoire. Julia Alveston a abandonné son prénom pour celui de Turtle, bien plus conforme à sa vie, repliée avec son père survivaliste dans une bicoque isolée sur la côte nord de la Californie, mais aussi en elle-même, sous une carapace solide, pour survivre, affronter le monde extérieur et supporter la vie quotidienne avec un père idolâtré et exécré. Ce dernier l’affuble du sobriquet affectueux de « Croquette », aussi infantilisant que réifiant. Elle est sa chose, son bon petit soldat : « Espèce de petite connasse, tu es à moi » lui assène-t-il. C’est le titre qui finalement permet de mieux percer toute l’horreur de la vie de Turtle : « my absolute darling », ces mots d’amour que Martin lui chuchote alors qu’il la viole enferment la jeune fille dans une relation incestueuse. Son père s’est érigé en seul repère fiable dans un monde qui court à sa perte. Comment lui échapper ? Chapitre après chapitre, le lecteur est plongé dans les pensées et la vie de Turtle, et quand il croit avoir atteint avec elle les limites du supportable, d’autres pages viennent lui tordre davantage les tripes : «Elle s’allonge dans le sable mouillé, elle souffre toujours dans le froid, mais elle est désormais à l’abri du vent. Elle sent les battements de son cœur dans son dos enflé et dans ses doigts...
Grand Frère, Mahir Guven
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans une narration alternée, deux frères racontent leur histoire : « Grand frère » (le narrateur principal, conducteur VTC) et « Petit frère » (infirmier parti en Syrie). Deux frères, deux parcours mais la même blessure depuis la mort de leur mère et le silence du père. La même fracture : des rêves avortés (l’armée, la chirurgie) et une échappatoire (le shit pour l’un, le Cham -la Syrie- pour l’autre.) Sans manichéisme ni misérabilisme, les deux personnages incarnent les failles et les dérives contemporaines : destins empêchés, travail uberisé, dérive identitaire. Le récit de leurs trajectoires, à la fois proches et opposées, entretient un suspense qui monte en puissance. Il y a indéniablement de l’énergie, un souffle, une voix dans ce premier roman de Mahir Guven. Quelque chose de l’ordre de la sincérité, de la nécessité, loin des romans à succès fabriqués. Et surtout une langue inventive et plastique qui fait flèche de tout bois, qui emprunte autant au verlan qu’à l’anglais, à l’arabe, à l’espagnol, au gitan, au wolof. Une langue à l’image du protagoniste moitié syrien, moitié breton qui a grandi à Paris entre un père communiste exilé politique, une grand-mère catholique parlant français, l’autre musulmane parlant arabe. Un roman actuel et percutant. Grand Frère, Mahir Guven, Le Livre de poche, février 2019, 308 pages. Goncourt du Premier Roman...
Manuel à l’Usage des Femmes de ménage, Lucia Berlin...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Des nouvelles? Genre peu prisé des lecteurs français… Et pourtant, quoi de plus adapté à notre époque frénétique que cette forme brève, efficace et percutante, dans laquelle excellent les auteurs américains? Lucia Berlin est de ceux-là. Les textes de Manuel à l’usage des femmes de ménage inspirés par sa vie mouvementée et par les nombreux métiers qu’elle a exercés entre USA, Chili et Mexique, sont autant de flashs de vie. Elle sait évoquer un univers, donner vie à des personnages et nous toucher en quelques pages. Au fil des histoires, on retrouve une jeune femme qui lui ressemble avec ses quatre fils, sa mère alcoolique, ses liaisons passionnées, ses galères et son énergie combative. On rencontre aussi des paumés, des cabossés de la vie : vieillard sénile, jockey blessé, toxicos, alcooliques, patients des urgences, vieux couple fragile … De ceux que l’on croise sans les voir dans les bus, les hôpitaux, les laveries automatiques et qu’elle sait regarder. Cela pourrait être sordide, désespéré ou larmoyant. Tout est une question de distance et de style : dosage entre humour et empathie, sens des dialogues et du petit détail vrai. C’est à la fois drôle et terrible, émouvant et généreux. Humain, tout simplement. Manuel à l’usage des femmes de ménage, Lucia Berlin, traduit de l’américain par Valérie Malfoy, Le Livre de poche, octobre...
Instable, Nicolas Fraiseau
écrit par Marie Fernandez
Nicolas Fraiseau est un jeune artiste circassien sorti du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) en 2016. Lors du spectacle de fin d’école, il est remarqué par Christophe Huysman, metteur en scène de la compagnie Les Hommes Penchés ; celui-ci décide alors d’accompagner le jeune machiniste dans son premier projet professionnel. Ainsi naît et se développe Instable, une forme solo époustouflante, à la fois drôle et grave, où Nicolas Fraiseau rêve d’un point de stabilité dans un monde mouvant et incertain, toujours au bord de l’effondrement. Lorsque Nicolas Fraiseau entre dans le cercle formé par les spectateurs sous la grande verrière des Subsistances, il semble débarquer dans le merdier du monde. Au centre du cercle, un vaste plateau fait de planches disjointes et bancales, tenues tant bien que mal par quelques clous qui ne cessent de sauter. Peu effarouché par la nature accidentée du terrain, le jeune homme se retrousse les manches et rafistole son radeau à la va comme je te pousse : un pneu par ci, un clou par là. En vain, ça pète de tous les côtés. Le clown n’est pas loin, à chercher des solutions de misère face aux accidents de la vie. On ne pourra pas faire mieux, le monde est tel qu’il est, tout de guingois. C’est sur ces fondations instables que Nicolas Fraiseau entreprend de planter son mât chinois, sorti d’on ne sait où en pièces démontées. Commence alors une incroyable épopée au cours de laquelle, sans jamais renoncer, le jeune homme assemble, chute, remonte, tend des fils, chute, remonte, resserre, chute encore et encore. De toute son énergie, au prix de risques ahurissants, il bâtit. Une tour de Babel pour croire en l’homme? Une vergue qui donne un horizon? Les images jaillissent de ce merdier, tandis que nous rions, sursautons, rêvons, pleins de tendresse pour ce bricoleur alchimiste. Tout le spectacle réside dans ce mouvement acharné vers le point le plus haut du mât, ce point où l’artiste pourra se tenir debout, au-dessus de tout ça, stable (enfin comme on peut l’être sur une plate-forme de cinquante centimètres). « La possibilité d’une île », comme dirait Houellebecq. Ainsi, cette forme d’une heure et quart consacrée au mât chinois n’offre que peu de temps à la pratique en elle-même du mât. L’agrès, son ancrage, est la quête du spectacle, il est ce qui permet de s’élever et d’accéder à une stabilité que n’assure plus le sol. De temps à autre pourtant, pour tester la fermeté de sa tour d’ivoire, Nicolas Fraiseau s’octroie des temps de respiration sur le mât ; son énergie, si frénétique à terre, s’apaise, et ses mouvements se font de plus en plus gracieux, aériens. Ces lumineux interstices nous donnent alors la mesure de son talent et font entrevoir le corps libéré, enfin détendu lorsqu’il est amarré à un point fixe. Idée originale et jeu : Nicolas Fraiseau Mise en scène : Christophe Huysman Regards extérieurs : Mads Rosebeck, Maël Tebibi Création lumière : Eric Fassa Création son : Robert Benz Scénographie : Nicolas Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard Costumes : Mélinda Mouslim Construction : Sylvain Fertard, Michel Tardif Régie générale : Robert Benz Administration, production : Christine...
Summer, Monica Sabolo
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Un jour d’été, sur les bords du lac Léman, Summer, jeune fille de dix-neuf ans, disparaît. Vingt-cinq ans plus tard, son frère Benjamin, rattrapé par le souvenir du passé enfoui, revient sur cet événement tragique. A la fois enquête policière et psychanalyse familiale – mais, depuis Oedipe, les deux ne sont-elles pas intimement mêlées? – Summer nous entraîne sous la surface lisse et glacée d’une famille apparemment idéale à qui tout semble réussir. Quoi de mieux que la Suisse, tranquille, aseptisée, comme décor à ce drame? Dès la première phrase, l’atmosphère inquiétante est mise en place : « Dans mes rêves, il y a toujours le lac. » Monica Sabolo nous plonge dans les profondeurs glauques des secrets de famille et distille progressivement les indices et les révélations comme autant de petits cailloux blancs qui mènent à la maison de l’Ogre. Tout à la fois efficace et poétique, Summer est un thriller réussi. Summer, Monica Sabolo, Le Livre de poche, janvier 2019, 289 pages. Quelle vie passionnante que celle de Gabriële Buffet, (en partie) retracée par ses deux arrière-petites-filles, Anne et Claire Berest! Musicienne qui se destinait à la composition, elle fut tour à tour épouse de Picabia, amie d’Apollinaire, maîtresse de Duchamp et de Stravinsky, résistante avec Beckett et mourut, oubliée de tous, à l’âge de cent quatre ans. A travers son destin hors norme, c’est une époque foisonnante qui est évoquée, ce début du XX° siècle où il semble qu’un nouveau mouvement artistique naisse tous les six mois : dadaïsme, orphisme, futurisme, cubisme… Elle fut de presque tous, à la fois muse et théoricienne. On regrette seulement que cette biographie qui mêle documents et fiction n’évite pas les maladresses et les clichés et que les auteures arrêtent brusquement ce récit de vie en...
La Douce Indifférence du monde, Peter Stamm
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Avec La Douce Indifférence du monde le romancier suisse Peter Stamm compose un récit subtil, plein de charme et de mystère, une réflexion sur le temps, le réel et l’imaginaire. Envoûtant. Toute l’histoire de ce roman inracontable est celle d’un dédoublement. A l’issue d’une représentation de Mademoiselle Julie, Christoph, le narrateur, romancier d’une cinquantaine d’années, donne rendez-vous à Lena, jeune actrice qui lui rappelle Magadalena, la femme aimée une quinzaine d’années auparavant. Dans un cimetière de Stockholm puis dans un café, il lui raconte son histoire, son amour passé pour Magadalena et ses rencontres obsédantes avec un jeune homme qui ressemble étrangement à celui qu’il a été. Au fil du récit et de leur déambulation, des similitudes troublantes apparaissent entre les vies des deux protagonistes, à la fois semblables et différentes. Il y a tout d’abord le titre -inspiré de Camus (1)- qui attire, puis l’atmosphère étrange qui séduit et l’écriture qui entraîne. Même si l’on se sent quelque peu désarçonné(e) dans ce roman qui tient de Vertigo et de Mulholand Drive, même si l’on se perd parfois, dans l’alternance des récits, entre les couples, les époques et les lieux, on se laisse emporter jusqu’au dernier chapitre. Au cours du livre, le narrateur, l’héroïne, et le lecteur, s’interrogent sur la réalité et la fiction. Qu’est-ce qui est vrai ou inventé, souvenir ou imagination? Christoph a-t-il vraiment vécu l’histoire qu’il raconte à Lena? Au fond, chacun a le désir de faire de sa propre vie une histoire, qu’il soit écrivain, acteur, lecteur ou simple noctambule un peu ivre et bavard. Mais « il n’y a que dans les livres que les histoires ont une fin. (…) Dans la réalité, il n’y a pas de fin, sauf la mort. Et elle est rarement heureuse. » L’homme mûr est...
ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman unanimement salué par la critique et cité pour les prix, Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard évoque une passion dévorante entre deux jeunes femmes dans un rythme et un style fiévreux. C’est une histoire d’amour fou qui surprend, bouleverse et emporte les deux protagonistes : la narratrice, jeune professeure de lycée, mère d’une petite fille et récemment séparée de son compagnon, et Sarah, violoniste concertiste dans un quatuor. Sarah, la tornade trentenaire aux allures d’adolescente, passionnée et imprévisible, fascinante et tyrannique. Sarah, vivante et mortifère. Cette passion se vit pendant deux ans sous le signe de l’urgence et de l’excès : des courses éperdues, des nuits volées entre deux avions ou deux trains, des retrouvailles et des départs, des larmes et des étreintes. Peu à peu, l’euphorie amoureuse fait place à la douleur d’aimer. Après les débuts idylliques, viennent les désaccords, les orages, les scènes de plus en plus fréquentes et la rupture. C’est une histoire d’amour torride, tumultueuse et tragique, forcément tragique car, comme dans le théâtre antique, l’issue fatale en est annoncée dès la première page. A l’image de la passion qu’il raconte, le roman de Pauline Delabroy-Allard se déroule et se lit à toute allure, en courts chapitres superposés et numérotés comme autant de flashs de vie – quatre vingt-deux dans la première partie, trente dans la deuxième où le temps semble suspendu à Milan et à Trieste. A l’image des quatuors de Beethoven et de Schubert que la narratrice écoute en boucle, des leitmotivs obsessionnels (mots, phrases ou paragraphes) scandent la narration comme autant de refrains entêtants. Sarah, envahissante, prend toute la place dans l’histoire. Son prénom résonne dans le titre, comme dans tout le livre, avec le S sifflant et la première syllabe :« ça raconte ça, je me souviens de ça». Son portrait est repris avec des variantes « Ça raconte Sarah, sa beauté inconnue, cruelle, son nez d’oiseau de proie, ses yeux comme des silex, ses yeux meurtriers, assassins, ses yeux de serpent aux paupières tombantes.» Sa volonté impérieuse et contradictoire rythme la phrase : « Elle veut qu’on aille au cinéma, elle veut qu’on fasse l’amour, elle veut qu’on s’endorme ensuite dans les bras l’une de l‘autre, elle veut qu’on arrête de s’écrire et de se parler pendant quelques jours, elle veut qu’on mange japonais, elle veut qu’on parte en week-end à la campagne pour se reposer, elle veut que j’arrête de pleurer, elle veut aller à une fête sans moi, elle veut ne pas avoir de responsabilité, elle veut être légère, elle veut être libre. » Omniprésente, éblouissante, Sarah prend toute la lumière et éclipse tous les autres personnages; la narratrice elle-même n’a pas de nom ni sa petite fille, tous les personnages secondaires sont effacés, réduits à leur rôle d’acteur dans cette passion aveuglante et dévoratrice. Enfermé(e) dans le point de vue de la narratrice qui raconte à la première personne, le lecteur/la lectrice partage sa subjectivité, son obsession (on pourrait presque dire sa possession) et n’a pas accès à la réalité des faits. L’une des forces du roman est ainsi de maintenir jusqu’à la dernière page la tension et l’incertitude, aux confins de la folie. Peu importe qu’il s’agisse d’une relation entre deux femmes, « Sarah » devient le symbole de toute passion, du désir impérieux, de l’impossible fusion et de la souffrance de l’absence. Même s’il n’est pas dépourvu de quelques maladresses et de tics d’écriture contemporains (comme l’usage du copier coller Wikipedia pour définir un film, une ville), ce court roman aux accents durassiens emporte et séduit le lecteur. Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard, Les Editions de Minuit, 2018, 188...
Arcadie, Emmanuelle Bayamack-Tam
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Notre coup de coeur en cette rentrée littéraire, Arcadie, le onzième roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam, nous entraîne dans une communauté libertaire à travers le regard d’une adolescente. Eden ou secte, en tout cas miroir révélateur et voyage en utopie mené avec brio. A Liberty House, zone blanche située quelque part dans le sud-est de la France, se retrouvent tous les exclus, les marginaux, les laissés pour compte de la modernité – malades, toxicos, obèses, nonagénaires… Autour d’Arcady, leur guide charismatique qui arbore en tatouage la devise latine « Omnia vincit Amor », ils cultivent leur jardin (bio, évidemment) et pratiquent l’amour libre. Farah, la narratrice adolescente, y est arrivée à l’âge de six ans avec sa mère souffrant d’électro- sensibilité, son père dyslexique passionné d’horticulture et sa grand-mère naturiste. Elle y a grandi sans contrainte, vivant une enfance heureuse entre les arbres et les livres, loin des Mac Do et des réseaux sociaux. Mais, à l’adolescence, son physique disgracieux se précise : loin d’embellir, la jeune fille se virilise et se pose alors, à l’heure des premiers désirs, la question de son identité sexuelle. A quatorze ans, elle rêve de défloration, tour à tour attirée par Arcady, figure paternelle qu’elle vénère depuis des années, puis par la jeune Maureen rencontrée hors de la communauté et enfin par Angossom, l’étranger à peine entrevu. Le récit a ainsi des airs d’adieu à l’enfance qui s’éloigne et que l’on enterre – comme les objets que les pensionnaires enfouissent dans la capsule temporelle pour les générations futures – « en cette fin d’été qui voit quatre d’entre nous battre pavillon vers les rives, sans charme ni mystère, de l’âge adulte. »Le temps, le lieu de l’innocence s’éloignent, remplacés par celui du désir ; le « nous » fait place au « je » ; l’ailleurs attire irrésistiblement au-delà de...
Histoires naturelles…, Yoann Bourgeois
écrit par Marie Fernandez
Yoann Bourgeois est un nom qu’on entend bien souvent ces dernières années dans l’univers du cirque et de la danse. Et pour cause. Danseur et circassien de formation, Yoann Bourgeois tisse sa toile à la croisée des arts et déjoue toujours davantage nos vaines et désuètes tentatives de classification. De son indémêlable écheveau, il fait sortir de grandes machines à jouer et à rêver qui mettent les corps aux prises avec des forces physiques décuplées. Toujours en recherche d’un équilibre introuvable, d’une apesanteur rêvée, ces corps en mouvement dessinent alors les métaphores de nos existences, les peurs et les aspirations de notre humanité. Le point de suspension est un peu le fil rouge des recherches de Yoann Bourgeois. Désigné comme « l’instant où les corps et objets lancés en l’air atteignent le plus haut point avant la chute »1, le point de suspension est ce temps utopique convoité par tous les artistes de cirque, sinon par tous les hommes. Histoires naturelles, 24 tentatives d’approches d’un point de suspension est une oeuvre à la fois patrimoniale et en devenir, tout comme le musée Guimet de Lyon qui ouvre ses portes à la compagnie Yoann Bourgeois dans le cadre de la Biennale de la danse. L’ancien musée d’histoire naturelle, vidé de ses collections, est en passe d’être réaménagé en atelier de création pour la danse contemporaine, annexe de la Maison de la Danse. Dans les murs vieillis et chargés d’histoire de l’ancienne salle centrale s’invite une exposition tout autre, faite de citations de spectacles passés de la compagnie, formes courtes à la fois reprises et réinventées. A l’entrée du public, plusieurs dispositifs de l’artiste sont cachés par de grands draps blancs, comme si ceux-ci pouvaient encore recouvrir les squelettes de mammouths et de dinosaures que le musée abritait....
Le Lambeau, Philippe Lançon
écrit par Marie-Odile Sauvajon
7 janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo. Gravement blessé à la mâchoire, le journaliste Philippe Lançon passe neuf mois en hôpital et subit de nombreuses interventions chirurgicales. Le Lambeau est le récit – précis, factuel, terrible et magnifique – de cette lente et douloureuse reconstruction. Il faut tout d’abord dire que Le Lambeau n’est pas, ce que l’on aurait pu craindre, pathétique, idéologique ou résilient. Ici, ni complaisance larmoyante, ni analyse socio-politique , ni optimisme volontariste. Philippe Lançon recueille les faits, les sensations, le vécu au jour le jour depuis ce moment où la violence a fait irruption dans la salle de rédaction d’un hebdomadaire satirique, la transformant en scène de guerre. Fracassé corps et esprit, le survivant entame un long combat fait de persévérance, d’échecs et de recommencements. Entouré par ses proches – parents, frère, amis –, pris en charge par les soignants, il vit au rythme de l’hôpital. En relatant ce combat, il rend hommage au personnel hospitalier qui l’accompagne pendant ces longs mois de greffes, rejets, cicatrisation, rééducation… Dieux omnipotents qui fabriquent une mâchoire nouvelle à partir d’un os du péroné, doigts de fée qui réussissent un pansement impossible et trouvent une veine invisible, anges gardiens qui dispensent le sommeil bienfaisant de la morphine mais aussi personnages bien vivants dont il brosse les portraits. Tout l’univers de l’hôpital est là, un monde fait de professionnalisme, de compétence extrême et de bricolage. Un monde qui accueille les blessés de la vie, victimes d’accidents, de cancers, d’AVC ou de suicides ratés, qu’il croise dans les couloirs et dont les descriptions évoquent les gueules cassées de la Grande Guerre. D’ailleurs « sa » chirurgienne, personnage central avec qui se noue une belle relation, le lui rappelle : « Vous êtes un mutilé ». Roi dérisoire, défiguré, diminué, comme...
Mémoires, Tome I, Simone de Beauvoir
écrit par Fleur Bournier
« Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand j’ai commencé à parler de moi : on commence, on n’en finit pas. » écrit Simone de Beauvoir dans La force des choses, troisième volume de ses mémoires, après Mémoires d’une jeune fille rangée et La force de l’âge1, qui paraissent enfin à la bibliothèque de la Pléiade cette année. Consécration, s’il en est besoin, d’une femme d’exception. Le premier livre, Mémoires d’une jeune fille rangée, raconte les vingt premières années de la vie de l’auteure. Son enfance heureuse, à peine troublée par la première guerre mondiale, devient à l’adolescence un Eden perdu : incompréhension maternelle, distance du père qui lui préfère Poupette sa sœur, plus jolie, conformisme bourgeois oppressant, études décevantes dans le cadre sclérosé du cours Désir et perte de la foi. Si ses désillusions lui pèsent parfois, elle sait en faire une force et trouve en la littérature une voie salvatrice. Enfant, Beauvoir se réfugiait déjà dans le travail, ce qui faisait dire à son père : « Simone a un cerveau d’homme. Simone est un homme. ». Très tôt – et certainement pour palier l’indifférence de ce père qu’elle voudrait conquérir-, elle se promet un destin singulier : elle sera un écrivain célèbre. Sa décision prise, rien ne viendra l’ébranler. Son amitié avec Zaza Mabile est un autre fil conducteur : camarade complice, Zaza l’aide à supporter les demoiselles du cours Désir. Les deux jeunes filles, arrachent à leurs parents l’autorisation de poursuivre des études : « Dans mon milieu, on trouvait alors incongru qu’une jeune fille fît des études poussées ; prendre un métier, c’était déchoir. » Zaza ne suit pas son amie bien longtemps ; ses parents appartenant à la haute bourgeoisie s’effraient rapidement et cherchent à la soustraire à l’influence néfaste de Simone. L’histoire de Zaza est une version tragique de...
Le Complot contre l’Amérique, Philip Roth...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Déjà classique, Philip Roth? Non parce qu’il est récemment décédé ni parce que ses romans connaissent un immense succès mais parce que, quatorze ans après sa parution, son roman Le Complot contre l’Amérique n’a rien perdu de sa force et de son actualité. S’inspirant de sa propre enfance à Newark dans le New Jersey, Philip Roth imagine ce qui serait advenu à sa famille entre 1940 et 1942 si l’aviateur Charles Lindbergh, isolationniste et antisémite, avait été élu président des Etats-Unis à la place de Roosevelt. A partir de faits historiques – le comité America First, les sympathies de Lindbergh pour le régime nazi, son discours de septembre 1941 désignant les juifs comme groupe fauteur de guerre – le romancier construit une uchronie glaçante. D’abord insidieuse, la menace antisémite se précise, la parole se libère, les premières mesures contre les juifs sont prises et la violence explose. Quand Hermann Roth, le père du jeune héros, prend conscience du danger, il est déjà trop tard. En fin de livre, un post-scriptum bienvenu et documenté propose la véritable chronologie des personnages historiques ainsi que l’intégralité du discours de Lindbergh;le lecteur peut ainsi faire la part de la réalité et de la fiction et découvrir cette face sombre et peu connue de l’Amérique. De l’aveu même de l’auteur, Le Complot contre l’Amérique est, comme Némésis1, un roman de la peur. « La peur perpétuelle » enserre le roman de la première phrase jusqu’au dernier chapitre et maintient le lecteur dans un suspense haletant, angoissant. Elle s’étend de l’ancien au nouveau continent, n’épargnant aucun territoire. La peur ancestrale de la persécution s’abat sur le jeune Philip Roth âgé de sept ans lorsqu’il se découvre juif, lui qui croyait être « l’enfant américain de parents américains, qui fréquentai[t] l’école américaine d’une ville...