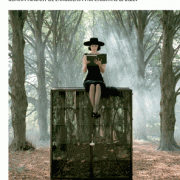Avec humour et finesse, Siri Hustvedt trace le parcours d’une femme blessée qui trouve en ses pairs et en elle-même une force insoupçonnée. Un roman féminin et féministe, drôle, émouvant et intelligent. A partir de la trame narrative rebattue de l’époux infidèle, Siri Hustvedt fait un pas de côté. Elle ne racontera ni les cris ni les larmes, mais la reconquête de soi et de sa liberté, dans une tendre célébration des femmes qui leur rend justice : « La banalité de l’histoire – le fait qu’elle soit répétée chaque jour ad nauseam par des hommes qui, s’apercevant tout à coup ou petit à petit que ce qui EST pourrait NE PAS ÊTRE, font dès lors en sorte de se libérer des femmes vieillissantes qui ont, pendant des années pris soin d’eux et de leurs enfants – n’amortit pas le chagrin, la jalousie et l’humiliation qui s’emparent des abandonnées. Femmes bafouées. » Mia, poétesse de 55 ans, fait le récit sans complaisance et plein d’humour de sa difficile reconstruction après la défection de son époux, une «pause» selon lui, ce qui vaut à sa maîtresse d’être affublée de ce sobriquet :« La Pause était française, elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d’étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de vingt ans plus jeune que moi ». Remise de sa «crise psychotique», Mia préfère quitter New York pour tenter de se reconstruire. Elle s’installe à Bonden pour l’été, ville de son enfance où vit encore sa mère dans une résidence pour personnes âgées. Elle y enseigne la poésie à des adolescentes «dans le cadre du Cercle artistique local». Une galerie de personnages féminins représentant tous les âges de l’existence y entoure peu à peu...
La petite Femelle, Philippe Jaenada
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Dans La petite Femelle, Philippe Jaenada reconstitue avec minutie l’histoire tragique et authentique d’une femme qui a tué son amant. Un portrait en forme de plaidoyer où la rigueur n’exclut pas la fantaisie. Pour avoir tué son ancien amant, Pauline Dubuisson est condamnée en 1953 à la prison à perpétuité après un procès qui connaît un grand retentissement dans la presse et l’opinion publique. Libérée pour bonne conduite après huit ans de prison, elle change de prénom et reprend ses études de médecine à Paris. Mais, rattrapée par son passé, elle part au Maroc où elle exerce comme infirmière. Reconnue à nouveau et repoussée par celui qu’elle s’apprêtait à épouser, elle se suicide en 1963. Au cours des années suivantes, cette histoire inspira à la fois la littérature et le cinéma : dès 1958, En cas de malheur de Simenon est adapté à l’écran par Autant-Lara avec Brigitte Bardot, et surtout en 1960 La Vérité de Clouzot, toujours avec Bardot, remporte un grand succès. Plus récemment, en 1991, Jean-Marie Fitère publie La Ravageuse et Jean-Luc Seigle Je vous écris dans le noir en 2015. Alors, pourquoi un nouveau livre consacré à cette affaire ? Que l’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas ici d’un « roman vrai », d’une fiction à partir d’un fait divers mais de la recherche de la vérité, comme l’annonce l’auteur dans son prologue : «Je m’efforce d’être le plus précis, le plus juste, le plus fidèle qu’on puisse être. » Philippe Jaenada se fait l’avocat pointilleux de l’accusée (celui qui lui a fait défaut lors de son procès puisque son défenseur, le très catholique Paul Baudet, soucieux de sauver l’âme plus que la vie de sa cliente, n’a pas cherché à réfuter l’accusation de préméditation). L’auteur a fouillé les archives, épluché les rapports...
La Belle saison, Catherine Corsini
écrit par Célian Faure
Dans les années 70, Delphine, jeune paysanne débrouillarde à la sexualité assumée rencontre Carole, militante du Mouvement de libération des femmes, parisienne sophistiquée et charismatique. Mais la romance est brutalement interrompue : le père de Delphine a une attaque, ce qui oblige la jeune fille à retourner chez elle pour épauler sa mère. Carole la rejoint bientôt. Cependant, transposé en milieu rural, leur amour se heurte à de lourds clivages socioculturels. Un film d’été subtil, agréable et plutôt convaincant. Dans la vision nostalgique et fantasmée d’une époque libertaire et décomplexée, on retrouve ces couleurs légèrement voilées, ces chemises et ces barbes, ces cigarettes qu’on allume partout, ces bravades perpétuelles contre une société corsetée qui s’ouvre doucement, celle du général de Gaulle et de Pompidou. Catherine Corsini se jette volontiers dans ces images d’Epinal et se paie même le culot de filmer une bande de jeunes fuyant dans la rue au rythme du Move over de Janis Joplin. Après tout pourquoi pas : certains clichés se boivent comme du petit lait. Le Paris de Corsini, celui des luttes féministes, des amphis et des pattes d’eph’ a donc un petit goût d’exotisme mémoriel et se complaît dans le mythe de l’âge d’or. Dans un souci apparent de réalisme, la réalisatrice met en scène des réunions, meetings et débats dans lesquels on s’écharpe, on décide, on chante aussi, à tue-tête et le poing levé. Mais, pareilles à des souvenirs magnifiés, ces scènes sonnent souvent faux. L’excès manifeste d’enthousiasme – d’hystérie dites-vous ? – donne davantage l’impression que les gamines s’amusent, s’encanaillent et que jeunesse se passe. Le regard de Corsini se teinte d’une pointe de condescendance qui dégagerait presque des relents phallocrates. Un comble. Mais le portrait des luttes féministes n’est pas l’argument essentiel du film, et l’intrigue...
Mustang, Deniz Gamze Ergüven
écrit par Jessica Martin
Un village turc, aujourd’hui. Cinq jeunes sœurs sont confrontées au poids des traditions et contraintes d’abandonner liberté et légèreté pour devenir de bonnes épouses. Dans leur maison devenue prison, éprises d’une impérieuse envie de liberté, elles tentent d’échapper à leur sort. Deniz Gamze Ergüven signe ici un premier long métrage lumineux et terrible : elle filme avec grâce cinq jeunes filles sublimes, victimes d’une société « qui a tellement peur du sexe que tout devient sexuel »[1]. Un film poignant et engagé. Le film s’ouvre sur des larmes ; celles d’une fille de 12 ans qui fait ses adieux à son professeur. Mais ce chagrin d’école ne dure pas et laisse bientôt place à des jeux enfantins : les cinq sœurs s’amusent dans la mer avec des garçons. Scène légère, joyeuse, offrant aux spectateurs la beauté sauvage de ces filles dont la vie semble n’être inondée que de soleil et de promesses radieuses. Mais deux d’entre elles ont l’audace de grimper sur des épaules masculines, et l’allégresse tourne court. Dénoncées par une villageoise, les voilà donc accusées de se « masturber sur la nuque des garçons ». Face à l’absurdité de la situation, le spectateur jubile quand l’une des sœurs se met à brûler des chaises : « c’est dégueulasse, elles ont touché nos trous du cul ». On pressent d’emblée que le poids de principes ancestraux va happer ces filles aux airs d’héroïnes tragiques, et l’on songe volontiers au très beau Virgin Suicide de Sofia Coppola. Cependant, Coppola met en scène un tragique désincarné, quand celui de Deniz Gamze Ergüven est davantage sociétal puisqu’il nait du poids des conventions. Ces jolies filles ne sont pas bien nées, le film se déroule « à mille kilomètres d’Istanbul » au bord de la mer Noire. Leur sensualité apparaît comme un crime aux yeux de l’oncle et de la grand-mère...
Bande de filles, Céline Sciamma
écrit par Sylvain Loscos
Après Naissance des pieuvres et Tomboy, Céline Sciamma place sa caméra au coeur de la banlieue et retrace le parcours de Marieme, jeune fille éprise de liberté. Comme dans ses autres films, la jeune réalisatrice brise les représentations et construit une morale de la liberté indispensable. Un très beau film. Bande de filles est le parcours d’une adolescente noire dans une cité de région parisienne. Dès le début du film, le spectateur est plongé au cœur d’une vie déjà marquée par l’échec. Marieme vit au milieu de tours grises qui ne laissent pas de place à l’espoir d’une vie meilleure. Quand Céline Sciamma filme la banlieue, elle utilise un objectif grand angle qui noie la jeune fille dans un espace trop grand pour elle. La composition de l’image met en avant le contraste entre l’immensité des tours et la fragilité de l’adolescente. Marieme, un peu boudeuse, semble éteinte et effacée, mais va évoluer au contact d’une bande de jeunes filles rebelles. Celle qui va être nommée Vic « comme Victoire » par la chef de bande va s’opposer à tout ce qui la comprime. La scène d’ouverture donne le ton : on assiste à un match de football américain, match féminin bien sûr. Musique pêchue, gros plans sur les visages qui s’entrechoquent : symboles d’un être qui se bat. Mais contre qui ? Contre sa mère qui voudrait faire d’elle une femme de ménage, contre son frère qui la flique… Bref, contre tous ceux qui voudraient réduire sa liberté. Dans le propos de la réalisatrice, cette soif de liberté s’articule à des questions de société: comment survivre au cœur des violences des cités ? Comment décrocher son autonomie, son indépendance? Comment s’affirmer en tant que personne sans se faire rejeter par le groupe ? Comment écraser les stéréotypes et les préjugés qui...
Jupe, Compagnie Brouha Art
écrit par Sullivan Caristan
Jupe, sous-titré « pièce documentaire antisexiste » est un spectacle hybride. A partir d’un corpus de textes littéraires, philosophiques et sociologiques, Laureline Collavizza a construit une scénographie autour de trois femmes : l’une dit et joue les textes, une autre danse, la troisième chante. On obtient ainsi un dispositif scénique original dans lequel les mots, la danse et le chant s’entremêlent. Un dialogue s’instaure, tout en souplesse, sans que l’une ou l’autre des protagonistes vienne simplement illustrer un discours qui serait central. Dans un premier temps, le spectateur se concentre sur les textes : Beauvoir, Bourdieu, Sand et d’autres moins connus. La jupe, le vêtement féminin, la fonction sociale du vêtement et les contraintes que celui-ci impose au corps vêtu semblent être le fil directeur du montage de textes, ce qui n’empêche pas quelques digressions ou variations. La comédienne, face public, incarne les textes et interpelle le spectateur, mais c’est surtout le chant et la danse qui vont les actualiser en les ancrant dans des postures corporelles et vocales, c’est-à-dire dans des situations sociales chargées de signification morale : c’est « le dos qu’il faut tenir droit, les jambes qu’il ne faut pas écarter, le ventre qu’il faut rentrer, etc. » Laureline Collavizza, la metteure en scène est également chanteuse. Par la voix, elle crée une ambiance sonore et musicale faite de sons chantés, de bruitages, de rythmes produits sur scène et assemblés en direct. La voix humaine a ici une fonction émotionnelle. Par la danse, la troisième protagoniste donne à voir le corps dans ses postures, ses contorsions, ses habitus, que le mouvement soit harmonieux ou non. Le dialogue entre les mots et les corps, entre le rythme des voix et celui des pas est très libre et chaque forme artistique « contamine » les autres. Les trois corps se meuvent de...