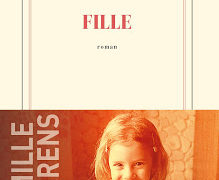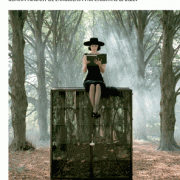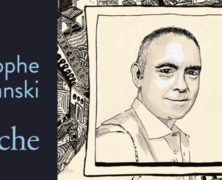Dans la lignée d’Un lieu à soi, de La Vie matérielle ou encore du Deuxième sexe, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, les deux premiers volumes de la trilogie autobiographique de Deborah Levy, sont de vrais petits bijoux de littérature, couronnés par le prix Fémina 2020. Dès les premières lignes, la fulgurance de la pensée, l’écriture ciselée, la narration fragmentaire, mais d’une cohésion parfaite, subjuguent. A la fois récits autobiographiques et essais, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie racontent une quête ou plutôt une reconquête de soi, en tant que femme et écrivaine. Comment devenir le personnage principal de sa propre vie? interroge Deborah Levy. « C’est déjà assez dur d’apprendre à devenir écrivain, mais apprendre à devenir un sujet, c’est épuisant. » George Sand, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Julia Kristeva ou encore Marguerite Duras, autant de consœurs que Deborah Levy cite, comme une évidence, au détour d’une phrase, qu’elle convoque auprès d’elle, bonnes fées qui veillent après avoir ouvert la voie. Dans sa trilogie autobiographique, Deborah Levy réfléchit à son tour à la condition féminine, à la maternité, et leurs influences sur l’acte d’écriture, mais aussi à la manière dont le passé se rappelle au présent. Deborah Levy souligne, dans une belle filiation à V. Woolf et M. Duras, l’importance que peuvent avoir les lieux pour une femme, le corollaire entre l’absence de lieu à soi et le rôle d’«architecte » de l’espace domestique assigné par la société : « Arracher le papier peint de ce conte de fées qu’est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c’est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements ni amour et qu’on néglige. Il faut de l’habileté, du temps, de la dévotion et de l’empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C’est surtout un acte d’une générosité immense que d’être l’architecte du bien-être de tous les autres. » L’autrice a révélé dans une interview que le dernier volume de cette « Living autobiography » (« autobiographie vivante »), La Propriété privée, continue de travailler sur l’espace à soi. Le premier volet, Ce que je ne veux pas savoir, se présente, par son sous-titre, comme une « réponse au Pourquoi j’écris de George Orwell (1946) », en adoptant cette fois un point de vue féminin. « Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semble-t-il, sur les escalators de gares que je pleurais le plus souvent » constate la narratrice dans les premières lignes du roman. Il s’agit alors pour elle non de remonter à la source de ce chagrin, mais, dans un premier temps, de l’accueillir, d’essayer de le comprendre. Pour cela, elle décide de retourner dans une pension où elle avait déjà séjourné à Palma de Majorque (dans une proximité savoureuse avec George Sand). De cette escapade jaillissent des souvenirs de son enfance en Afrique du Sud – où elle est née -, et en Angleterre : « « Angleterre » était un mot excitant à écrire. Ma mère m’avait dit que nous étions en exil et que nous retournerions un jour dans mon pays natal. L’idée que je vivais en Exil et non en Angleterre me terrifiait ». Deborah Levy laisse l’enfant qu’elle était s’exprimer, elle adopte son regard, encore naïf, qui sait sans savoir, sans vouloir savoir : l’apartheid, l’arrestation de son père militant de l’ANC, les oiseaux que l’on enferme et qu’elle veut libérer. L’enfant apprend peu à peu, grâce à sa pétillante cousine Mélissa, mais surtout grâce à l’écriture à « parler haut », sorte de mantra commun aux deux premiers volumes : « Les filles doivent parler haut puisque personne ne les écoute de toute façon » Le coût de la vie s’ouvre quarante ans plus tard : « Arrivée à la cinquantaine, juste...
Fille, Camille Laurens
écrit par Fleur Bournier
Féministe et féminin, drôle et émouvant, le dernier Camille Laurens séduit malgré une narration un peu chargée. Fille est le récit, aux accents autobiographiques, de la vie de Laurence Barraqué, entremêlé à une réflexion aussi pertinente qu’amusante sur ce qu’est être fille dans la France des années 60 jusqu’aux années 2000. Laurence («L’eau-rance»? s’indigne la grand-mère) naît en 1959 à Rouen d’un père médecin et d’une mère femme au foyer. Le roman s’ouvre sur sa venue au monde, sur le constat qui l’accompagne (« c’est une fille ») et tous les sous-entendus dont sont empreints ces quelques mots : « « C’est une fille » signifie d’abord « Ce n’est pas un garçon » ». Une déception donc – d’autant plus qu’elle a déjà une sœur, Claude. Celle du père principalement : lorsqu’on lui demande s’il a des enfants, ce dernier répond « Non, j’ai deux filles ». La structure narrative – trois parties et un épilogue – suit le parcours de Laurence, de sa naissance à sa renaissance, c’est-à-dire la fierté enfin trouvée d’être une fille. La première partie est consacrée à l’enfance, les deux suivantes à l’âge adulte ; l’une raconte la mort de son premier enfant, la dernière son retour à la vie avec la naissance de sa fille, Alice. Le premier chapitre, malgré son amertume sous-jacente, est jubilatoire tant l’autrice sait jouer avec les mots, les clichés, les représentations. Telle cette perle : « A propos de filles, il y a une chose bizarre. Tu es une fille, c’est entendu. Mais tu es aussi la fille de ton père. Et la fille de ta mère. Ton sexe et ton lien de parenté ne sont pas distincts. […] La fille est l’éternelle affiliée, la fille ne sort jamais de la famille. Le Dr Galliot, au contraire, a eu un garçon et il a eu un...
Lumière d’été, puis vient la nuit, Jón Kalman Stefánsson...
écrit par Fleur Bournier
Quel plaisir de retrouver la prose poétique et mélancolique de l’islandais Jón Kalman Stefánsson en cette rentrée littéraire où il fait bon s’évader. Lumière d’été, puis vient la nuit, paru en 2005 mais dont la traduction nous parvient seulement cette année, immerge le lecteur dans un petit village des fjords de l’ouest de l’Islande, s’attachant tour à tour à certains de ses habitants. Quotidiens ordinaires et monotones, mais aussi extraordinaires et poignants. Dès le titre, Lumière d’été, puis vient la nuit, la plume de Jón Kalman Stefánsson – et de son remarquable traducteur- fait tinter à notre oreille sa douce et mélancolique poésie, qui se poursuit dans le titre des chapitres : « L’univers et la robe de velours noir », ou encore « les larmes ont la forme d’une barque à rame ». Qui se déploie dans le roman : « Au printemps, il attire des oiseaux des tourbières joyeux et optimistes, ses rives regorgent de toutes sortes de coquillages, au loin, des milliers d’îles et d’écueils surgissent de l’eau comme une denture aléatoire – et le soir, le soleil répand son sang à la surface de l’océan, alors, nous méditons sur la mort. » Cette prose enchanteresse et mélodieuse accompagne un complet dépaysement. Nous voici dans un petit village islandais, partageant sa douce torpeur loin des fracas du monde. Le narrateur nous y accueille, à l’orée du roman, avant de commencer son récit, ou plutôt ses récits, puisque c’est de la vie de certains de ses habitants dont il va être question. Le nom du village reste tu car il importe peu, il est le miroir de tant d’autres. Le narrateur lui aussi tait son nom, il se pose en simple observateur, en conteur, et sa voix s’élève comme dans un prologue d’une tragédie antique : « nous vous parlerons du désir...
Une Bête au paradis, Cécile Coulon
écrit par Fleur Bournier
Prix Littéraire Le Monde 2019, Une Bête au Paradis est à la fois un beau roman et une effroyable tragédie. Une histoire de passions, d’abandons et de vengeances. Le Paradis est un vaste domaine, une ferme, avec sa cour et sa basse-cour, sa fosse à cochons, et plus loin les Bas-Champs, et le Sombre-Etang. Là, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, orphelins suite à un tragique accident de voiture. Elle s’occupe de son exploitation avec l’aide de Louis, un autre fracassé de la vie qu’elle a recueilli au Paradis. La vieille femme semble tirer sa force vitale de cette terre, loin d’elle les ans la rattrapent. Emilienne, c’est la terre, la Terre-Mère, la terre qui nourrit, qui abrite, qui protège. « Elle traversait l’existence, dévolue au domaine et aux âmes qui l’abritaient. Tout commençait par elle, tout finissait par elle. » Blanche marche sur ses pas, petite « guerrière de cinq ans » bien décidée à survivre. Gabriel, lui, est « un garçon naïf, cassé par la mort de ses parents ». Il se tient dans l’ombre de ces deux femmes qui le portent à bout de bras, et trouve parfois en Louis, avec qui il partage sa chambre, un semblant de complicité. Blanche lutte, avance, grandit. Elève brillante, alors même qu’elle passe tout son temps libre à travailler à la ferme, elle ne cherche pas d’autre avenir que celui qui s’offre à elle. Un jour, son voisin de table, Alexandre, lui propose un marché : contre son aide en mathématiques, il fera la publicité de la ferme. Elle accepte, se laisse peu à peu apprivoiser et finalement tombe amoureuse. Comment résister à Alexandre, à son sourire enjôleur, à son assurance joyeuse ? Sous les yeux jaloux de Louis, Blanche cède tout entière à sa passion pour Alexandre....
Dans une coque de noix, Ian Mac Ewan
écrit par Fleur Bournier
Confiné dans le ventre de sa mère, un fœtus mène l’enquête. Que complotent sa mère et son amant ? Comment sauver son père du mauvais coup que ces deux-là semblent tramer ? Clin d’œil malicieux à Hamlet, Dans une coque de noix revisite avec humour le roman policier. Dans une coque de noix est un petit roman qui regorge de bien des surprises. A commencer par le choix d’un narrateur peu ordinaire, un fœtus : « Me voici donc, la tête en bas dans une femme. Les bras patiemment croisés, attendant, attendant et me demandant à l’intérieur de qui je suis, dans quoi je suis embarqué ». Espiègle, fin œnologue et féru de programmes en tout genre, celui-ci ne recule devant rien pour parfaire son éducation in vivo : « Au milieu d’une longue nuit calme, il m’arrive de donner un bon coup de pied à ma mère. Elle se réveille, cède à l’insomnie, prend la radio. Un divertissement cruel, certes, mais au matin, nous sommes tous deux mieux informés ». Le narrateur-fœtus offre au lecteur sa perception du monde, lacunaire, drôle, et d’autant plus jouissive que très vite le récit prend des allures de roman policier. Alerté par des bribes de conversations entre sa mère et son amant, le narrateur-fœtus revêt la casquette de détective. Il entend bien mener son enquête et trouver le fin mot de l’histoire. Les informations qu’il glane lui font craindre que les deux comploteurs ne s’en prennent à son cher poète de père, mis à la porte de chez lui par sa mère et allant de maladresse en maladresse pour la reconquérir. Prêt à voler à son secours, sa condition l’embarrasse. Que faire ? D’autant que d’autres révélations vont ébranler ses certitudes… Dans une coque de noix, Ian McEwan, traduction France Camus-Pichon, Gallimard folio, 240...
Jetez moi aux chiens, Patrick McGuinness
écrit par Fleur Bournier
Inspiré d’un réel pugilat médiatique, Jetez moi aux chiens met à nu une société avide de faits divers et de coupables tout trouvés, solidement nourrie par une presse à sensation sans scrupule. Un faux roman policier et une vraie petite pépite littéraire. Jetez moi aux chiens commence comme un polar : après un premier chapitre déroutant, le lecteur est plongé dans une sordide affaire de meurtre, qui n’est pas sans rappeler un véritable fait divers. En décembre 2010, à Bristol en Angleterre, une jeune femme est portée disparue, puis retrouvée morte, étranglée. Noël approche, il faut résoudre l’affaire au plus vite. Un premier suspect est rapidement arrêté, son propriétaire et voisin, Christopher Jefferies. Les journaux s’emparent aussitôt de ce fait divers et condamnent cet ancien professeur sans aucune forme de procès : cet homme cultivé et singulier incarne le coupable idéal. Quelques jours plus tard, l’assassin est arrêté, Christopher Jefferies disculpé. Cette histoire de violence ordinaire est le canevas du nouveau roman de Patrick McGuinness. L’auteur y rend une forme de justice à celui qui a été pour lui un professeur bienveillant et qui a apporté un peu de joie dans sa scolarité au sein d’une école privée élitiste. Dans son roman, M. Wolphram, le suspect, est un double fictif assez transparent de Christopher Jefferies. Du jour au lendemain arrêté puis inculpé, il voit son mode de vie passé au crible. La presse, le rebaptisant opportunément « Le Loup », en fait le coupable idéal. Ainsi, chaque détail devient une preuve irréfutable de sa culpabilité : ses goûts musicaux et cinématographiques, son célibat, le moment de son départ à la retraite (quand l’école devient mixte). « Quand l’innocence est aussi louche, on n’a que faire de la culpabilité » constate amèrement le narrateur-enquêteur. Néanmoins,...
Un été sans les hommes, Siri Hustvedt
écrit par Fleur Bournier
Avec humour et finesse, Siri Hustvedt trace le parcours d’une femme blessée qui trouve en ses pairs et en elle-même une force insoupçonnée. Un roman féminin et féministe, drôle, émouvant et intelligent. A partir de la trame narrative rebattue de l’époux infidèle, Siri Hustvedt fait un pas de côté. Elle ne racontera ni les cris ni les larmes, mais la reconquête de soi et de sa liberté, dans une tendre célébration des femmes qui leur rend justice : « La banalité de l’histoire – le fait qu’elle soit répétée chaque jour ad nauseam par des hommes qui, s’apercevant tout à coup ou petit à petit que ce qui EST pourrait NE PAS ÊTRE, font dès lors en sorte de se libérer des femmes vieillissantes qui ont, pendant des années pris soin d’eux et de leurs enfants – n’amortit pas le chagrin, la jalousie et l’humiliation qui s’emparent des abandonnées. Femmes bafouées. » Mia, poétesse de 55 ans, fait le récit sans complaisance et plein d’humour de sa difficile reconstruction après la défection de son époux, une «pause» selon lui, ce qui vaut à sa maîtresse d’être affublée de ce sobriquet :« La Pause était française, elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d’étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de vingt ans plus jeune que moi ». Remise de sa «crise psychotique», Mia préfère quitter New York pour tenter de se reconstruire. Elle s’installe à Bonden pour l’été, ville de son enfance où vit encore sa mère dans une résidence pour personnes âgées. Elle y enseigne la poésie à des adolescentes «dans le cadre du Cercle artistique local». Une galerie de personnages féminins représentant tous les âges de l’existence y entoure peu à peu...
Le cœur de l’Angleterre, Jonathan Coe
écrit par Fleur Bournier
Prix du livre européen 2019, Le Cœur de l’Angleterre, le dernier roman de Jonathan Coe, dresse un portrait cinglant de l’Angleterre des dernières décennies. L’auteur interroge avec un humour caustique et décalé les évènements qui ont pu conduire au Brexit. Un roman réjouissant autant qu’effarant. Dans son dernier opus, Jonathan Coe renoue avec les personnages de Bienvenue au Club, et de sa suite Le Cercle fermé, les membres de la famille Potter, choix non prémédité qui s’est finalement imposé à lui. Nulle nécessité cependant d’avoir lu les deux précédents pour savourer le dernier en date. Le roman s’ouvre en 2010 alors que Benjamin et Loïs Potter enterrent leur mère. Benjamin a à présent la cinquantaine et vit isolé dans un moulin retapé. Sa sœur reste hantée par les évènements traumatisants de son passé. Autour d’eux, membres de la famille ou amis créent un microcosme reflétant ce qui se joue à plus grande échelle dans le pays et qui va conduire au Brexit. La narration, à sauts et à gambades, suit différents personnages, allant de l’un à l’autre, les laissant en suspens, avant de les retrouver des jours, des semaines ou des mois plus tard. Ces nombreuses ellipses insufflent un rythme au récit, tendu vers l’avant, celui de l’engrenage dans lequel est prise l’Angleterre et qui la conduit à l’inimaginable. Les titres des trois parties qui composent le roman –La joyeuse Angleterre, L’Angleterre profonde, La vieille Angleterre- révèlent ce retour en arrière aussi imprévisible qu’inquiétant. L’histoire politique de l’Angleterre du début du millénaire, retracée par l’auteur non sans une ironie acerbe, n’est pas inconnue du lecteur. Néanmoins c’est avec une profonde incrédulité qu’il se voit replonger dans la campagne nauséabonde du Brexit. Sous couvert de la promesse de redevenir une nation puissante, certains politiques, appuyés...
Tout le monde n’habite pas, Jean-Paul Dubois...
écrit par Fleur Bournier
Récompensé par le Goncourt 2019, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, le dernier Jean-Paul Dubois, sans constituer une lecture indispensable, offre au lecteur un moment agréable et distrayant. « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» nous prévient le titre. Pour Paul Hansen, le narrateur, il s’agit de s’adapter à la vie au pénitencier de Montréal dans une cellule de six mètres carrés, qu’il partage avec Patrick Horton, un Hells Angel en attente de jugement pour meurtre, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos – Life is a bitch and then you die – et celle de son amour pour les Harley Davidson sur l’arrondi des épaules et le haut de la poitrine. » Cet impressionnant compagnon de cellule se révèle au fil du roman bien plus sympathique qu’il n’y pouvait paraître. Sous sa carcasse de géant, Horton cache une âme d’enfant, effrayé par les rongeurs, intimidé par une visite de sa mère et tétanisé par des ciseaux de coiffeur. Les deux hommes apprennent au fil des jours à s’apprivoiser, à préserver ce qu’il faut d’humanité dans la promiscuité. L’omniprésence d’Horton est ce qui pèse le plus à Paul, il s’évade donc constamment dans souvenirs et rêveries, et accueille les fantômes qui lui sont chers : son père, le pasteur Jansen, sa femme Winona, sa chienne Nouk. Paradoxalement, Jean-Paul Dubois fait de la prison un espace où son personnage acquiert « une forme de liberté incroyable ». Ainsi qu’il l’explique lors d’une interview pour France Culture : « ces deux années vont lui permettre de reconsidérer le monde, de reconsidérer sa vie et de reconsidérer ses souvenirs, de vivre avec ses morts, de vivre ce passé, de comprendre tout un tas...
LaRose, Louise Erdrich
écrit par Fleur Bournier
Dans un roman puissant et envoûtant, Louise Erdrich interroge la notion de justice à travers l’histoire de deux familles Ojibwé, les Iron et les Ravich. Comment réparer l’irréparable ? Peut-on dépasser son désir de vengeance ? Comment aider à se reconstruire ceux que le chagrin dévaste ? Autant de questions que l’autrice explore avec force, subtilité et talent. Les premières pages coupent le souffle, plongeant le lecteur dans un récit dramatique poignant : Landreaux Iron, « un catholique pieux et respectueux des coutumes indiennes », tue accidentellement à la chasse le fils de son voisin et ami Peter Ravich : « Quand la bête s’enfuit d’un bond, il se rendit compte qu’il avait touché autre chose – il y avait eu comme un mouvement désordonné lorsqu’il avait appuyé sur la détente. S’étant approché pour voir, il baissa les yeux et ne comprit qu’à ce moment-là qu’il avait tué le fils de son voisin ». La narration mêle ensuite adroitement présent et passé, dévoilant le poids des traditions et le rôle des fantômes du passé dans l’engrenage de la machine tragique qui vient de se mettre en place. Face à l’inconcevable et l’irréparable, c’est dans les anciennes coutumes Ojibwé que Landreaux et Emmeline Iron vont chercher à rendre justice aux Ravich. Dusty avait cinq ans, tout comme leur propre enfant LaRose, ils décident donc – comme leurs ancêtres le faisaient autrefois – de donner leur fils en réparation. Mais la justice peut-elle encore se concevoir ainsi aujourd’hui ? Un fils peut-il en remplacer un autre, même s’il porte le nom mystique de LaRose ? Le titre éponyme du roman en est ainsi le fil, tendu entre plusieurs époques : un nom qui se transmet de génération en génération et qui semble donner une aura toute particulière à celui ou celle qui le porte : « C’était un prénom à...
Joseph Anton, Salman Rushdie
écrit par Fleur Bournier
Il aura fallu des années à Salman Rushdie pour oser se replonger dans les années les plus sombres de sa vie, celles de la fatwa, afin d’en livrer le récit, et de se réapproprier une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre mais qui reste avant tout la sienne. Ecrit à la troisième personne, Joseph Anton se lit comme un roman policier, qui donnerait la parole à la victime prise dans une toile d’araignée. L’histoire de la fatwa prononcée par l’Ayatollah Khomeiny suite à la parution des Versets sataniques en 1989 est bien connue, néanmoins les rouages politiques et éditoriaux de cette affaires, et ses conséquences sur la vie de l’auteur, décrits dans Joseph Anton surprennent jusqu’à la dernière page le lecteur. Aujourd’hui la manière dont cette affaire a été traitée semble incroyable. La fermeté face à l’obscurantisme, au terrorisme, va de soi. Cela ne fut à l’époque pas aussi tranché. L’auteur a essuyé de nombreuses critiques et attaques, venant de journalistes peu scrupuleux et avides de gros titres, mais aussi d’intellectuels et de personnalités politiques. Il s’est vu fermer de nombreuses portes, sa liberté se réduisant peu à peu : interdiction de vols sur les plus grandes compagnies aériennes, refus d’autorisation de séjour, invitations à des évènements littéraires ajournées, refus des éditeurs de publier en poche Les Versets sataniques mais aussi ses nouveaux romans, … Innocent mais prisonnier de la protection de la Special Branch, se battant pour la liberté mais en étant privé, c’est à un véritable combat pour reconquérir ses droits que se livra Rushdie, un combat pour lui mais avant tout pour tous, pour que la parole des écrivains ne soit plus menacée. Pour autant, Rushdie ne se peint pas en héros de la liberté ; il ne s’épargne guère et...
Girls, Edna O’Brien
écrit par Fleur Bournier
Edna O’Brien s’empare dans son dernier roman d’un évènement tragique qui suscita l’émoi l’international en 2014 : l’enlèvement d’une centaine de lycéennes par Boko Haram au Nigéria. Quelques années plus tard, certaines se sont enfuies, d’autres ont été libérées, d’autres encore sont toujours portées disparues. L’autrice retrace le parcours de l’une d’entre elles dans un récit bouleversant. « J’étais une fille autrefois, c’est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier. Emmenée en trombe à travers cette forêt que j’ai vue, cette première nuit d’effroi, quand mes amies et moi avons été arrachées à l’école. » Ainsi s’ouvre le dernier roman d’Edna O’Brien. Des phrases incisives qui placent d’emblée le lecteur sur la crête du soutenable. De courts chapitres, écrits à la première personne, se succèdent, comme autant d’incursions dans l’esprit chancelant de Maryam, jeune fille enlevée par Boko Haram et réduite en esclavage. Des fragments terrifiants d’une vie en lambeaux. Des instantanés qui retracent le calvaire de la jeune fille, violée, mariée de force, mais qui trouve la force de fuir, de survivre et d’être mère : « Je ne suis pas assez grande pour être ta mère. » confie-t-elle, exténuée et désespérée, à son bébé. L’horreur du camp djihadiste, la fuite éperdue dans la forêt avec son bébé, Babby, et une de ses compagnes, Buki, ne sont pas les dernières épreuves que doit endurer Maryam. Suspecte plus que victime, elle doit encore prouver qu’elle ne s’est pas convertie et ne représente aucun danger. Pire, elle reste, même aux yeux des siens, « une femme du bush » marquée du sceau de l’infamie. Les retrouvailles tant espérées avec sa mère, son père et son frère n’ont pas lieu. C’est de retour dans son village que les derniers remparts de la jeune fille cèdent : « Au milieu de toute cette prière, de ces mea culpa et de cette hypocrisie, quelque chose en moi s’est noirci. Je m’en suis approchée. Je l’ai étreinte. J’y suis entrée, dans la noirceur. » Edna O’Brien ne nous épargne aucune des violences subies par les jeunes filles enlevées, mais son écriture toute en pudeur et en retenue leur rend leur dignité. Et la belle traduction d’Aude de Saint-Loup et de Pierre-Emmanuel Dauzat ne la trahit en rien. Le lecteur s’accroche à la beauté des mots, des phrases, refuges contre la noirceur environnante : « Parfois je suis dans la forêt, une forêt peu familière, vidée de toute humanité. Les arbres sont gigantesques, leurs troncs gris noueux. Ils parlent un parler noueux. » La parole de Maryam semble se déployer dans un seul souffle, laissant le lecteur suspendu à ce flot qui le plonge dans un récit atroce et sublime. La parole se révèle au fil des chapitres l’un des enjeux du récit puisqu’elle est la clef de la liberté : censurée au camp djihadiste, impossible face à son thérapeute tant la jeune fille reste prisonnière du cauchemar vécu : « Je lui dis des choses, pour ne pas lui dire des choses […]. Il sait qu’il y a plus à dire, mais que je ne peux pas. Entre nous il y a ce fossé béant. » ; puis, elle surgit, libère, et permet de reprendre en main son destin volé : « Je n’arrive pas à croire que je lui raconte, que je confesse réellement mon massacre nocturne. A chaque rêve, la nuit, ça devient plus sanglant. Je fais bouillir mes ravisseurs dans de grandes marmites noires. » Girl vient s’inscrit dans la continuité d’une œuvre qui s’attache à des parcours de femmes courageuses qui ont lutté pour leur liberté, à l’image de l’autrice elle-même. Le titre d’ailleurs en fait entendre un autre, The Country Girls, roman autobiographique dans lequel Edna O’Brien retrace son enfance dans une famille irlandaise conservatrice où la littérature et les femmes n’ont pas voix au chapitre. Un singulier en écho à un pluriel, une destinée qui vient en dire tant d’autres. Roman magistral et éprouvant, « Girl est un livre...
La Cache, Christophe Boltanski
écrit par Fleur Bournier
Construit comme le plateau d’un jeu de Cluedo, La Cache retrace l’histoire de la famille Boltanski en progressant pièce après pièce dans l’appartement de la Rue-de-Grenelle, en commençant par « son prolongement, son sas, sa partie mobile, sa chambre hors les murs, ses yeux, son globe oculaire », sa voiture, une fiat 500. Ce début, pour le moins surprenant, permet de brosser le portrait d’une famille soudée, qui ne s’extirpe de l’habitacle que « main dans la main, collés les uns aux autres », formant ainsi « un seul être, une espèce de gros mille-pattes » dont la colonne vertébrale serait « Mère-Grand ». Chapitre après chapitre, les pièces se succèdent et s’assemblent, et le lecteur s’invite dans cette famille peu ordinaire qui vit ainsi repliée sur elle-même : « Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-mêmes. De la petite comme de la grande histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est toujours sür. Cette appréhension, ma famille me l’a transmise très tôt, presque à la naissance». Christophe Boltanski remonte dans un récit émouvant et drôle à la source de cette névrose familiale. Le roman autobiographique se fait témoignage et hommage, ode à cette grand-mère prête à tout pour protéger les siens. La Cache, Christophe Boltanski, 2017, éd. Gallimard, coll. Folio, 336 pages....
My Absolute Darling, Gabriel Tallent
écrit par Fleur Bournier
Encensé par la critique, le premier roman de Gabriel Tallent a en effet tout pour plaire car il aborde, dans un style qui oscille entre poésie descriptive et oralité, bon nombre de thèmes d’actualité brûlants : le survivalisme, les dérives du deuxième amendement, la force de la Nature et surtout l’inceste. Dérangeant et haletant, My Absolute Darling met à rude épreuve le lecteur qui retient son souffle jusqu’au dernier chapitre. Le nom ou plutôt les noms de l’héroïne raconte son histoire. Julia Alveston a abandonné son prénom pour celui de Turtle, bien plus conforme à sa vie, repliée avec son père survivaliste dans une bicoque isolée sur la côte nord de la Californie, mais aussi en elle-même, sous une carapace solide, pour survivre, affronter le monde extérieur et supporter la vie quotidienne avec un père idolâtré et exécré. Ce dernier l’affuble du sobriquet affectueux de « Croquette », aussi infantilisant que réifiant. Elle est sa chose, son bon petit soldat : « Espèce de petite connasse, tu es à moi » lui assène-t-il. C’est le titre qui finalement permet de mieux percer toute l’horreur de la vie de Turtle : « my absolute darling », ces mots d’amour que Martin lui chuchote alors qu’il la viole enferment la jeune fille dans une relation incestueuse. Son père s’est érigé en seul repère fiable dans un monde qui court à sa perte. Comment lui échapper ? Chapitre après chapitre, le lecteur est plongé dans les pensées et la vie de Turtle, et quand il croit avoir atteint avec elle les limites du supportable, d’autres pages viennent lui tordre davantage les tripes : «Elle s’allonge dans le sable mouillé, elle souffre toujours dans le froid, mais elle est désormais à l’abri du vent. Elle sent les battements de son cœur dans son dos enflé et dans ses doigts...
Judas, Amos Oz.
écrit par Fleur Bournier
Amos Oz entraîne son lecteur dans un récit intelligent et surprenant qui mêle roman d’apprentissage, réflexions sur la figure du traître, et histoire de la fondation de l’état d’Israël : « L’histoire se déroule en hiver, entre fin 1959 et début 1960. On y parle d’une erreur, de désir, d’un amour malheureux et d’une question théologique inexpliquée. Certains édifices portent encore les stigmates de la guerre qui divisa la ville en deux, il y a dix ans ». Lorsque s’ouvre le roman, rien ne va plus pour Shmuel Asch, un jeune homme « corpulent, barbu, timide, émotif, socialiste, asthmatique, cyclothymique, les épaules massives, un cou de taureau, des doigts courts et boudinés : on aurait dit qu’il leur manquait une phalange ». Sa fiancée Yardena le quitte pour épouser son ancien petit ami, expert en récupération des eaux de pluie, son mémoire sur « Jésus dans la tradition juive » n’avance plus et enfin son père, ruiné par un procès, ne peut plus subventionner ses études. Peu combattif, Shmuel larmoie et déambule dans Jérusalem, « sa tête barbue précédent son corps, ses jambes tricotant pour le rattraper », ne sachant trop que faire de lui, il pense rejoindre une nouvelle colonie sur les monts du Ramon afin de commencer une nouvelle vie. Finalement, une petite annonce lui offre une autre porte de sortie : « CHERCHE HOMME DE COMPAGNIE. Offre à étudiant en sciences humaines et sociales, célibataire, doué pour la conversation et passionné d’histoire, un logement ainsi qu’un petit salaire en échange de cinq heures dans la soirée pour tenir compagnie à un invalide de 70 ans très cultivé. […] » Shmuel est employé par Atalia Abravanel, femme d’une quarantaine d’années, froide et envoûtante, pour tenir compagnie à son beau-père Gershom Wald. Curieusement, elle lui fait signer un contrat de confidentialité...
Désorientale, Négar Djavadi
écrit par Fleur Bournier
Dans la salle d’attente d’un hôpital parisien, une jeune femme trompe l’attente en se lançant dans le récit de ses origines. Telle Shéhérazade dans les Mille et Une Nuits, Kimiâ, la narratrice, multiplie les récits enchâssés, une digression en entraînant une autre, tissant une véritable fresque familiale dans l’Iran du siècle dernier. Sortie en poche très attendue ce mois-ci. Kimiâ attend et raconte, apostrophant le lecteur pour lui expliquer ce qu’elle fait dans cette salle d’attente, elle qui est venue seule, elle qui détonne face aux autres couples avec lesquels elle n’a rien à voir. Mais très vite le lecteur comprend que cette histoire cadre n’est que prétexte à dérouler une saga familiale marquée par l’histoire iranienne, la narratrice s’inscrivant dans cette tendance orientale à « à bavarder sans fin, à lancer des phrases comme des lassos dans l’air à la rencontre de l’autre, à raconter des histoires qui telles des matriochkas ouvrent sur d’autres histoires…« . Le conte oriental suit trois générations de Sadr, en commençant par l’arrière-grand-père paternel Montazemolmok, seigneur féodal originaire de Mazandaran et maître d’un harem ; suivent Nour la grand-mère, les oncles et surtout Darius, le père de Kimiâ, dissident politique insaisissable. Au fil des générations, les régimes se succèdent en Iran, chaque fois porteurs d’espoir, mais jouant finalement une partition de plus en plus sombre. Les parents de Kimiâ, Darius et Sara, fervents défenseurs de la liberté, n’hésitent pas à s’opposer à chacun des gouvernements, en dépit du danger et jusqu’à l’exil, car comme aime à le rappeler Emma, la grand-mère maternelle : « On a la vie de ses risques. Si on ne prend pas de risque, on subit, et si on subit on meurt, ne serait-ce que d’ennui. » Les oncles, numérotés selon leur place dans la fratrie, offrent une galerie de...
L’obscure clarté de l’air, David Vann
écrit par Fleur Bournier
Fasciné par les tragédies grecques, en particulier par Médée, David Vann en propose une réécriture déroutante, interrogeant la figure du monstre mythique en la rapportant à une question de point de vue. Médée tapageuse, outrancière, et bien sûr criminelle, mais avant tout femme, aspirant de toutes ses forces à se libérer des différents jougs qui pèsent sur elle. David Vann a voulu conclure un ensemble de romans tragiques, centrés sur les liens familiaux ou sociaux, par L’obscure clarté de l’air qui en constitue l’acmé. Ce récit est bien le plus sombre et le plus troublant de son œuvre. En adoptant le point de vue de Médée, l’auteur nous fait sentir toute la complexité de ce personnage dont l’Histoire n’a retenu que le caractère monstrueux : une mère tuant ses propres enfants par dépit amoureux. L’écriture, heurtée et inspirée, épouse la violence du mythe et le chant de l’aède : « Le sillage de l’eau derrière la poupe, luminescent. S’enroulant de chaque côté, incurvé puis tourbillonnant en remous miniatures remplis d’étoiles. Pas de lune, pas de torches mais la mer qui génère sa propre lumière, les cieux submergés et projetés et brûlant sans cesse ». La phrase, à l’image de la mer sur laquelle vogue l’Argos, se fragmente et se relance dans un même mouvement, un même roulement. David Vann excelle à raconter le périple maritime, le dur labeur des Minyens à la rame, la poésie qui imprègne un vieux navire fait de bois, de cordes et de voiles. Il puise pour cela dans son expérience de capitaine d’un navire égyptien datant d’il y a plus de 3500 ans, ayant pris part à une reconstitution historique pour le tournage d’un documentaire : « Le bois épais avec son extrémité de bronze et ses douzaines d’yeux percés par les cordages,...
L’Avancée de la nuit, Jakuta Alikavazovic...
écrit par Fleur Bournier
Histoire d’amour, quête de soi, réflexion sociologique, L’avancée de la nuit est un récit saisissant où les êtres se cherchent et se perdent dans un incessant va et vient rythmé par une écriture toute en nuances. Dès la première page, le lecteur comprend que l’histoire d’amour qu’il s’apprête à lire ne connaîtra pas de fin heureuse : « Paul était avec Sylvia quand il apprit ce qu’il en était d’Amélia Dehr. […] Ce fut un coup de téléphone, elle était entre la vie et la mort et l’issue du point de vue de Paul était certaine, Amélia Dehr n’étant pas du genre à échouer dans ses entreprises ». Le récit, déroulé en trois temps, reconstruit ensuite l’histoire de Paul et Amélia, les amants maudits. A l’image de la structure narrative, l’écriture de Jakuta Alikavazovic n’a de cesse de revenir sur elle-même, de reprendre un mot pour l’infléchir légèrement. Une écriture qui se construit et se déconstruit, reflet de l’histoire d’amour narrée – ou peut-être est-ce le contraire ? Paul et Amélia donc. Deux jeunes gens qu’a priori tout oppose. Elle, riche héritière, solaire et intrépide, est au centre de tous les regards et au cœur de toutes les rumeurs : « Quand elle entre dans une pièce, quelqu’un sort en pleurant ». Lui, solitaire, discret, travaille dans l’hôtel où elle réside. Le premier regard, loin d’être amoureux, n’est pas sans rappeler la rencontre d’Aurélien et Bérénice1: « C’est ça, Amelia Dehr ? » s’étonne Paul face à des camarades médusés. La suite de leur histoire se joue sur la même partition, à contre-temps, « une valse d’évitement ». Leurs yeux ne se rencontrent pas, et c’est d’abord à travers un écran de surveillance que Paul regarde Amelia, cherchant à percer son mystère. Simple histoire d’amour respectant ou détricotant les topoï du genre ? Non, elle est...
Quand sort la recluse, Fred Vargas
écrit par Fleur Bournier
Où l’on retrouve le flegmatique commissaire Adamsberg, perdu et errant dans ses brumes, qui s’engage dans une enquête incertaine alors que souffle un vent de rébellion au commissariat du 13ème arrondissement de Paris. Saveur des mots, chemins détournés, héros meurtris, intrigue en poupées russes, le nouveau Fred Vargas comble les attentes de ses lecteurs. Ouvrir le nouveau Fred Vargas, c’est retrouver un univers familier qui happe le lecteur et ne le lâche plus jusqu’à la dernière page, quand « toutes les piqûres, morsures, blessures [auront] été grattées, jusqu’au sang. » C’est retrouver des personnages atypiques, qui restent avant tout pleinement humains. C’est retrouver une conception singulière de l’intrigue de roman policier. L’auteure préfère d’ailleurs le néologisme « rompol » pour parler de ses romans qui se démarquent du genre. Sa formation d’archéologue infléchit sa construction du récit : les enquêtes procèdent de la fouille, chaque indice mis à jour fait partie d’un puzzle à reconstruire avec patience. Chez Vargas, pas de scène de crime sanguinolente, pas de courses poursuites effrénées arme au poing, mais des enquêtes incertaines, qui se résolvent grâce aux aptitudes quelque peu extraordinaires de chacun des personnages : mémoire photographique, savoir encyclopédique, intuitions fines, génie de l’informatique, pour n’en citer que quelques-unes. Lorsque s’ouvre le roman, le flegmatique commissaire Adamsberg a trouvé refuge dans les brumes islandaises. Il est rapidement contraint d’abandonner cet exil plus tôt qu’il ne le souhaiterait et de rentrer à Paris. Comme souvent dans les romans de Vargas, l’affaire qui le rappelle ainsi à la réalité, résolue dès les premiers chapitres, n’est que prétexte à introduire l’enquête principale qui oppose notre commissaire à son second le plus fidèle, Danglard. En effet, l’orage gronde au commissariat du 13ème arrondissement, la dissension autour d’Adamsberg, déjà amorcée dans le volume précédent, Temps glaciaires, reprend de plus...