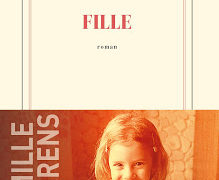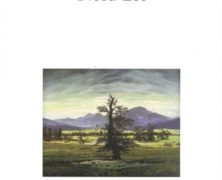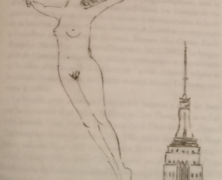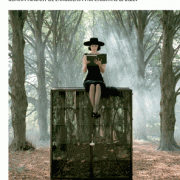Réjouissant et virtuose pour les uns, convenu et gentillet pour les autres, L’Anomalie d’Hervé Le Tellier est un Goncourt controversé, couronnant la littérature ludique et de connivence. La virtuosité du nouveau roman d’Hervé Le Tellier tient dans sa construction : onze personnages que l’on découvre au fil des chapitres, dont le seul point commun réside dans un vol Air France Paris-New York – assez traumatisant – qu’ils ont tous pris. Tueur à gages menant une double vie, avocate déterminée, architecte de renom, pop star nigériane, monteuse de cinéma, écrivain confidentiel : une galerie luxuriante de personnages s’offre au lecteur. Hervé Le Tellier, en digne membre de L’Oulipo, joue avec les codes romanesques, explore et démultiplie ses possibles, en commençant par une expérimentation sur le nombre de personnages principaux que peut suivre, sans trop de difficultés, un lecteur. « Il n’a retenu que onze personnages, et devine qu’hélas, onze, c’est déjà beaucoup trop » s’inquiète ingénument le narrateur au sujet du nouveau roman de l’écrivain Victor Miesel, dont le précédent avait pour titre… L’Anomalie. Hervé Le Tellier prend ainsi un plaisir manifeste à multiplier les clins d’œil au lecteur, au risque de sombrer parfois dans les clichés ou dans un humour potache. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il fait intervenir Donald Trump face à Emmanuel Macron : on frôle alors la mauvaise caricature. Fort heureusement, les clins d’œil au lecteur peuvent aussi être réjouissants. Hervé le Tellier manie avec brio l’art du pastiche. On s’amuse, par exemple, des réécritures d’incipits célèbres : « Tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l’est à sa façon. » ; « La première fois qu’Adrien avait vu Meredith, il l’avait trouvée franchement laide ». L’Anomalie peut d’ailleurs très bien se lire dans son ensemble comme un pastiche de film d’espionnage hollywoodien ou de série télévisée à suspense et...
Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, D.Levy...
écrit par Fleur Bournier
Dans la lignée d’Un lieu à soi, de La Vie matérielle ou encore du Deuxième sexe, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, les deux premiers volumes de la trilogie autobiographique de Deborah Levy, sont de vrais petits bijoux de littérature, couronnés par le prix Fémina 2020. Dès les premières lignes, la fulgurance de la pensée, l’écriture ciselée, la narration fragmentaire, mais d’une cohésion parfaite, subjuguent. A la fois récits autobiographiques et essais, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie racontent une quête ou plutôt une reconquête de soi, en tant que femme et écrivaine. Comment devenir le personnage principal de sa propre vie? interroge Deborah Levy. « C’est déjà assez dur d’apprendre à devenir écrivain, mais apprendre à devenir un sujet, c’est épuisant. » George Sand, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Julia Kristeva ou encore Marguerite Duras, autant de consœurs que Deborah Levy cite, comme une évidence, au détour d’une phrase, qu’elle convoque auprès d’elle, bonnes fées qui veillent après avoir ouvert la voie. Dans sa trilogie autobiographique, Deborah Levy réfléchit à son tour à la condition féminine, à la maternité, et leurs influences sur l’acte d’écriture, mais aussi à la manière dont le passé se rappelle au présent. Deborah Levy souligne, dans une belle filiation à V. Woolf et M. Duras, l’importance que peuvent avoir les lieux pour une femme, le corollaire entre l’absence de lieu à soi et le rôle d’«architecte » de l’espace domestique assigné par la société : « Arracher le papier peint de ce conte de fées qu’est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c’est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements ni amour et qu’on néglige. Il faut de l’habileté, du temps, de la dévotion et de l’empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C’est surtout un acte d’une générosité immense que d’être l’architecte du bien-être de tous les autres. » L’autrice a révélé dans une interview que le dernier volume de cette « Living autobiography » (« autobiographie vivante »), La Propriété privée, continue de travailler sur l’espace à soi. Le premier volet, Ce que je ne veux pas savoir, se présente, par son sous-titre, comme une « réponse au Pourquoi j’écris de George Orwell (1946) », en adoptant cette fois un point de vue féminin. « Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semble-t-il, sur les escalators de gares que je pleurais le plus souvent » constate la narratrice dans les premières lignes du roman. Il s’agit alors pour elle non de remonter à la source de ce chagrin, mais, dans un premier temps, de l’accueillir, d’essayer de le comprendre. Pour cela, elle décide de retourner dans une pension où elle avait déjà séjourné à Palma de Majorque (dans une proximité savoureuse avec George Sand). De cette escapade jaillissent des souvenirs de son enfance en Afrique du Sud – où elle est née -, et en Angleterre : « « Angleterre » était un mot excitant à écrire. Ma mère m’avait dit que nous étions en exil et que nous retournerions un jour dans mon pays natal. L’idée que je vivais en Exil et non en Angleterre me terrifiait ». Deborah Levy laisse l’enfant qu’elle était s’exprimer, elle adopte son regard, encore naïf, qui sait sans savoir, sans vouloir savoir : l’apartheid, l’arrestation de son père militant de l’ANC, les oiseaux que l’on enferme et qu’elle veut libérer. L’enfant apprend peu à peu, grâce à sa pétillante cousine Mélissa, mais surtout grâce à l’écriture à « parler haut », sorte de mantra commun aux deux premiers volumes : « Les filles doivent parler haut puisque personne ne les écoute de toute façon » Le coût de la vie s’ouvre quarante ans plus tard : « Arrivée à la cinquantaine, juste...
Fille, Camille Laurens
écrit par Fleur Bournier
Féministe et féminin, drôle et émouvant, le dernier Camille Laurens séduit malgré une narration un peu chargée. Fille est le récit, aux accents autobiographiques, de la vie de Laurence Barraqué, entremêlé à une réflexion aussi pertinente qu’amusante sur ce qu’est être fille dans la France des années 60 jusqu’aux années 2000. Laurence («L’eau-rance»? s’indigne la grand-mère) naît en 1959 à Rouen d’un père médecin et d’une mère femme au foyer. Le roman s’ouvre sur sa venue au monde, sur le constat qui l’accompagne (« c’est une fille ») et tous les sous-entendus dont sont empreints ces quelques mots : « « C’est une fille » signifie d’abord « Ce n’est pas un garçon » ». Une déception donc – d’autant plus qu’elle a déjà une sœur, Claude. Celle du père principalement : lorsqu’on lui demande s’il a des enfants, ce dernier répond « Non, j’ai deux filles ». La structure narrative – trois parties et un épilogue – suit le parcours de Laurence, de sa naissance à sa renaissance, c’est-à-dire la fierté enfin trouvée d’être une fille. La première partie est consacrée à l’enfance, les deux suivantes à l’âge adulte ; l’une raconte la mort de son premier enfant, la dernière son retour à la vie avec la naissance de sa fille, Alice. Le premier chapitre, malgré son amertume sous-jacente, est jubilatoire tant l’autrice sait jouer avec les mots, les clichés, les représentations. Telle cette perle : « A propos de filles, il y a une chose bizarre. Tu es une fille, c’est entendu. Mais tu es aussi la fille de ton père. Et la fille de ta mère. Ton sexe et ton lien de parenté ne sont pas distincts. […] La fille est l’éternelle affiliée, la fille ne sort jamais de la famille. Le Dr Galliot, au contraire, a eu un garçon et il a eu un...
L’Archipel d’une autre vie, Andreï Makine
écrit par Fleur Bournier
Roman policier et métaphysique, L’Archipel d’une autre vie plonge le lecteur dans une traque haletante en plein cœur de la taïga. Un grand Makine. Telle une poupée russe, L’Archipel d’une autre vie enchâsse différents récits, différentes époques. Le roman s’ouvre sur un récit rétrospectif, qui, sans être autobiographique, offre un narrateur qui emprunte beaucoup à l’auteur. Orphelin né dans un camp de travail, le narrateur du récit-cadre est envoyé à quatorze ans en tant que géodésiste en Sibérie, dans la « petite localité de Tougour […] coin perdu de l’Extrême Orient ». Par goût de l’aventure plus que par réelle cupidité, il entame une traque dans la forêt sibérienne qui bientôt se retourne contre lui. Le chercheur d’or qu’il pensait détrousser n’en est pas un : que fait cet homme seul, bien équipé et alerte, dans la taïga ? Le jeune homme écoute alors, médusé, cet homme, Pavel Gartsev, lui raconter son histoire. En 1952, les Russes se préparent à la troisième guerre mondiale. Pour cela, ils envoient en Sibérie de jeunes réservistes : ce fut le destin de Pavel. Un jour, on lui donne la mission de se lancer, avec quatre autres hommes, à la poursuite d’un fugitif du goulag. La chasse à l’homme dans la taïga, écrite comme une intrigue policière, constitue le cœur du roman. L’écriture épouse le rythme sinueux de la traque : « Marcher » dans la taïga est une façon de parler. En réalité, on doit s’y mouvoir avec la souplesse d’un nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un passage s’épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces vagues de branches, de brande, de broussailles qui déferlent sur lui. » La narration est en effet à la fois haletante -puisqu’il s’agit d’une course-poursuite- et lente. Elle donne à observer la forêt primaire et le fugitif qu’elle abrite, mais aussi à connaître peu à peu les cinq hommes qui le poursuivent. Le capitaine Louskass, le commandant Boutov et le sous-lieutenant Ratinsky ont à cœur leur avancement et sont prêts à tout pour obtenir les faveurs du parti. Vassine, comme Pavel, est enrôlé dans cette affaire malgré lui ; il admire le fugitif et voudrait bien l’aider. Les deux hommes finissent par ressentir une communion avec celui qu’ils poursuivent. Ils voient en lui un semblable, un frère, et non cet ennemi du peuple qu’ils doivent traquer sans relâche et rapporter au camp vivant afin qu’il serve d’exemple. Sa frêle silhouette laisse deviner celle d’« un adolescent caché. Assez semblable, tout compte fait, à ce « pantin de chiffon » que je gardais en moi. Fiévreux symbole de notre volonté de vivre, d’aimer, d’être reconnu, d’être aimé… ». Le fugitif ne cesse de les surprendre : il leur échappe toujours. Lorsque les cinq poursuivants comprennent enfin à qui ils ont affaire, la traque prend une toute autre tournure et s’accélère. Le désir de la capture tourne à l’obsession et fait ressortir le pire chez ces hommes. La construction virtuose de L’Archipel d’une autre vie repose sur une série de rebondissements et retournements de situation, tenant le lecteur en haleine, d’une course-poursuite à l’autre. Les traqueurs d’un jour deviennent à leur tour traqués. Ainsi Pavel marche sur ses propres pas dans la taïga mais cette fois pour sauver sa peau : « dans ma course, je vivais ce qu’aurait éprouvé une bête blessée. J’étais presque nu sous mes haillons. Mon dos et mes épaules saignaient. Ma bouche, déchirée par les coups de Ratinsky, se crispait de douleur quand, me mettant à quatre pattes, je buvais l’eau des courants. La nuit, le froid me secouait, mais je n’allumais que de tout petits feux, pour ne pas me trahir » Ainsi le jeune narrateur croit traquer Pavel alors que c’est sur lui que l’étau se referme. A cette intrigue policière se lie, dès les premiers mots du roman, une réflexion métaphysique : « A cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à...
Lumière d’été, puis vient la nuit, Jón Kalman Stefánsson...
écrit par Fleur Bournier
Quel plaisir de retrouver la prose poétique et mélancolique de l’islandais Jón Kalman Stefánsson en cette rentrée littéraire où il fait bon s’évader. Lumière d’été, puis vient la nuit, paru en 2005 mais dont la traduction nous parvient seulement cette année, immerge le lecteur dans un petit village des fjords de l’ouest de l’Islande, s’attachant tour à tour à certains de ses habitants. Quotidiens ordinaires et monotones, mais aussi extraordinaires et poignants. Dès le titre, Lumière d’été, puis vient la nuit, la plume de Jón Kalman Stefánsson – et de son remarquable traducteur- fait tinter à notre oreille sa douce et mélancolique poésie, qui se poursuit dans le titre des chapitres : « L’univers et la robe de velours noir », ou encore « les larmes ont la forme d’une barque à rame ». Qui se déploie dans le roman : « Au printemps, il attire des oiseaux des tourbières joyeux et optimistes, ses rives regorgent de toutes sortes de coquillages, au loin, des milliers d’îles et d’écueils surgissent de l’eau comme une denture aléatoire – et le soir, le soleil répand son sang à la surface de l’océan, alors, nous méditons sur la mort. » Cette prose enchanteresse et mélodieuse accompagne un complet dépaysement. Nous voici dans un petit village islandais, partageant sa douce torpeur loin des fracas du monde. Le narrateur nous y accueille, à l’orée du roman, avant de commencer son récit, ou plutôt ses récits, puisque c’est de la vie de certains de ses habitants dont il va être question. Le nom du village reste tu car il importe peu, il est le miroir de tant d’autres. Le narrateur lui aussi tait son nom, il se pose en simple observateur, en conteur, et sa voix s’élève comme dans un prologue d’une tragédie antique : « nous vous parlerons du désir...
Un jour ce sera vide, Hugo Lindenberg
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman très abouti de Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide raconte, le temps d’un été au bord de la mer, les peurs, les émois et les secrets d’un enfant de dix ans. Délicat, subtil et touchant. En vacances en Normandie avec sa vieille grand-mère et sa tante obèse qu’il surnomme « la folle », le jeune narrateur rencontre Baptiste, un garçon de son âge qui le fascine. Il fait tout pour l’imiter, pour mériter son amitié et surtout pour être accueilli chez lui, dans cette famille parfaite, qui apparait si différente de la sienne sur la plage : « je distinguais le triangle impeccable que formaient ses parents et sa soeur. Plus loin, seule sur une chaise pliable, ma grand-mère ressemblait à un rocher.» L’enfant éprouve une immense tendresse pour sa grand-mère, présence rassurante : « Je m’imagine lionceau perdu dans la savane, sous la protection d’un vieux fauve. » Mais il ressent aussi de la honte, honte de ses robes à fleurs, de son accent polonais, et du bol de foie haché qu’elle offre à la mère de Baptiste : « J’aimais le foie haché comme j’adorais ma grand-mère : dans l’intimité du foyer. Offerts à la vue de tous, l’un et l’autre m’embarrassaient terriblement. » Tiraillé entre deux mondes, le jeune garçon tente d’adopter les codes d’un autre univers, de se faire accepter et de voler un peu de la présence maternelle qui lui manque. Peu à peu, on devine les secrets enfouis derrière les mensonges et les silences, les histoires passées qui hantent cet enfant solitaire et sensible. Un jour ce serait vide pourrait aussi avoir pour titre « Les Méduses ». Omniprésentes dans le livre, elles s’échouent sur la plage où les garçons les décortiquent d’un bâton avec cette innocente cruauté de l’enfance. Elles habitent, hantent le...
Nord-Est, Antoine Choplin
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Plaisir en cette rentrée littéraire de retrouver Antoine Choplin dans les jolies éditions de La fosse aux Ours. Nord-Est, son dernier roman, reprend les thèmes qui lui sont chers – la catastrophe, la place de l’Art, les rapports humains – à travers le récit d’une aventure intemporelle et universelle. Ils sont quatre : Garri, Emmet, Jamarr et Saul qui décident de quitter le camp pour essayer de gagner à pied « les longues et douces plaines du nord-est », comme une terre promise lointaine au-delà des montagnes. Rusla, qui reproduit les pétroglyphes gravés par les anciens et les sauve de l’oubli, se joint ensuite à eux; puis Tayna, rencontrée dans le premier village traversé. Ils étaient paysan, maçon, écrivain ou sage-femme. Chacun a son caractère – meneur, introverti, écervelé ou posé -, ses passions, ses secrets. Que s’est-il passé? Que fuient-ils? Que cherchent-ils? On l’ignore, comme on ignore toujours le lieu et l’époque. On sait seulement qu’il y a eu un « avant », avant les incendies qui ont tout ravagé; à présent la population est répartie dans des camps, ravitaillée par des cantiniers. Ils croisent un cheval blessé, un berger fou qui ne parle plus que par bribes de mots, traversent des villages en ruines. Ils avancent avec difficulté, sous le soleil ou dans la tempête, gravissent la montagne encordés, descendent les pierrées dans une quête sans cesse recommencée : « Tu commences par monter, longtemps. Et quand t’arrives en haut de ce qui te fermait l’horizon, tu vois une nouvelle montagne se dresser entre toi et l’horizon(…) et quand t’arrives en haut de cette deuxième montagne, t’en découvres encore une autre qui te barre encore les perspectives. Et, à la fin, l’horizon, le vrai, celui qui te tire le regard au lointain (…) c’est comme si tu...
Comédies françaises, Eric Reinhardt
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Comédies françaises, le dernier roman d’Eric Reinhardt, croise, ou plutôt superpose, plusieurs histoires. Au risque de paraître parfois didactique ou éclaté, il pose la question du poids du hasard dans nos vies. Foisonnant et richement documenté. Refusant tout suspens, Eric Reinhardt commence par la fin et dévoile à la première page le faire-part de décès de son héros, Dimitri Marguerite, mort accidentellement à l’âge de vingt-sept ans. Il enchaine ensuite sur le moment de sa rencontre à Madrid avec une belle inconnue, puis retrace le parcours de ce brillant élève, pur produit de l’élitisme républicain. Fils d’une directrice d’école maternelle communiste, il intègre le lycée Louis-le-Grand et la prépa scientifique, bifurque vers le théâtre, échoue au concours du conservatoire et fait un master à Sciences-Po Paris. A la suite de la rencontre d’un soir avec un riche industriel, il est embauché comme consultant en affaires publiques dans un cabinet réputé et le lecteur découvre avec lui « une activité aussi romanesque, aussi mystérieuse, aussi opaque et sulfureuse que le lobbying ». Il quitte ensuite ce premier emploi, devient journaliste à l’AFP tout en menant différents projets de roman. L’auteur suit aussi les aventures amoureuses, homosexuelles et hétérosexuelles, de son héros et surtout sa quête obsessionnelle de la jeune femme rencontrée à Madrid et revue par hasard à Paris. Dimitri incarne le malaise d’une certaine jeunesse : il s’ennuie, n’arrive pas à être en accord avec lui-même, cherche le grand amour tout en enchaînant les aventures, envisage d’écrire des romans, se laisse porter par le hasard des rencontres et préfère parfois le rêve à la réalité: « Je me sens de plus en plus attiré par le hors champ. Sortir du réel. Creuser. M’enfouir. ». C’est seulement au théâtre qu’il a trouvé la possibilité « d’assouvir ce besoin impérieux de sens, de vérité et de perfection dans l’agencement des données du monde sensible » Il y a plusieurs romans dans ce livre. Au sein des aventures de Dimitri Marguerite s’insèrent deux autres histoires, sujets des romans que le héros projette d’écrire et pour lesquels il accumule des notes sur ses carnets : la rencontre de Max Ernst et Jackson Pollock et le rôle d’Ambroise Roux dans le ratage de l’internet français. A cela s’ajoutent aussi de nombreuses digressions au cours desquelles le narrateur expose ses théories sur le théâtre, les rues piétonnes ou l’épilation féminine. On peut trouver le livre décousu, disparate, passant du classique roman d’apprentissage et de l’histoire d’amour au quasi documentaire. Mais l’auteur tisse des liens ténus qui relient entre elles ces histoires : l’histoire de l’art abstrait d’après-guerre comme celle d’internet montrent la prise d’influence des Etats-Unis au détriment de la France et de l’Europe, Ambroise Roux pratique un lobbying efficace comme tente de le faire Dimitri, et surtout tous deux sont de grands admirateurs des surréalistes. C’est en effet surtout la question du hasard cher aux surréalistes – « le hasard objectif, forme de manifestation de la nécessité » comme l’écrivait André Breton – qui est au centre du roman et lui donne son unité. Ce qui intéresse l’auteur ce sont les moments historiques et « les coïncidences pétrifiantes », ces jours où tout bascule dans un pays comme dans une vie : ce jour d’octobre 1973 où la France de Giscard, poussée par le puissant industriel Ambroise Roux, met fin aux recherches de Louis Pouzin sur les transmissions de données et choisit le minitel au détriment d’internet; ce jour de juin 1942 où Max Ernst enseigne la technique du dripping au jeune Jackson Pollock – ce qui va faire de New-York la nouvelle capitale de l’art-; ce jour où Dimitri retrouve par hasard la jeune femme de Madrid (comme Breton croise Nadja à Paris). « Il y a comme ça des moments inconnus – qui devraient être exhumés et marqués d’une pierre noire, pensait Dimitri. » Eric Reinhardt joue avec le lecteur, trompe ses attentes, l’étonne parfois. L’histoire de Louis Pouzin, plusieurs fois annoncée, amorcée, interrompue...
Yoga, Emmanuel Carrère
écrit par Fleur Bournier
« Un petit livre souriant et subtil sur le yoga », tel était le projet initial d’Emmanuel Carrère avant de se muer en « autobiographie psychiatrique ». Curieusement, l’un n’empêche pas l’autre, bien au contraire, touchant au « sens originel du mot yoga : le fait d’atteler ensemble, sous un joug, deux chevaux ou deux buffles ». Emmanuel Carrère attèle ainsi dans son nouveau roman yoga et dépression, légèreté et drame, pulsion de vie et pulsion de mort. Ce n’est pas sans appréhension que le lecteur plonge dans Yoga. Renouant avec la veine autobiographique d’Un roman russe, E. Carrère écrit le récit poignant de sa longue dépression qui a conduit à son internement et au diagnostic d’une bipolarité de type II. Programme a priori peu réjouissant pour une rentrée déjà plombée par la pandémie. Et pourtant les deux premières parties du roman – qui en compte cinq –, consacrées largement à l’expérience du yoga et de la méditation, amusent et séduisent. L’auteur y raconte avec beaucoup d’humour sa participation à un stage Vipassana : « Les stages Vipassana, c’est l’entraînement commando de la méditation. Dix jours, dix heures par jour, en silence, coupés de tout : le truc hard. » Ce récit souriant et subtil est le point de départ de multiples réflexions sur le yoga, théoriques ou plus personnelles : « Car inspirer, dit le yoga, c’est prendre, c’est conquérir, c’est s’approprier, ce pour quoi je n’ai aucun problème : je ne sais même faire que ça, et ma cage thoracique est à la mesure de mon avidité. Expirer, c’est autre chose. C’est donner au lieu de prendre, c’est rendre au lieu de garder. C’est lâcher prise.» Un autoportrait de l’auteur en adepte du yoga et de la méditation se construit au fil de courts chapitres. Il ne s’adresse pas pour autant qu’aux initiés, bien au contraire...
L’Anniversaire, Imma Monso
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Huis clos, suspense, récits alternés, rebondissements… L’anniversaire de Imma Monso est indubitablement un thriller haletant, mais pas seulement. C’est aussi un roman qui analyse avec finesse les rapports de couple et les liens entre réalité et fiction. Ils sont ensemble depuis plus de vingt-cinq et les enfants ont quitté la maison quand la crise éclate. Elle ne le supporte plus, ils ne se comprennent pas et achoppent sur chaque mot, chaque expression. Parce qu’ils ne veulent pas se séparer mais que toute discussion tourne à l’affrontement, elle propose qu’ils ne se parlent plus et communiquent seulement par écrit. Après trois semaines de cohabitation silencieuse, il lui adresse un message énigmatique : « Nous fêterons l’anniversaire en dehors de la maison, loin. Nous partirons à neuf heures. » Quel anniversaire? Dans quel lieu? Avec quel cadeau? Etonnée, agréablement surprise par son mari qu’elle a toujours trouvé « prévisible comme une pendule », Raquel s’embarque avec curiosité dans ce voyage (et le lecteur aussi). Mais l’aventure enthousiasmante devient peu à peu angoissante lorsque Mateu révèle à sa femme l’inquiétant cadeau qu’il a préparé pour elle. Tous deux se retrouvent alors prisonniers dans le huis clos de la voiture et Raquel découvre une facette de son mari qu’elle ne connaissait pas. Cet homme pragmatique, concret et maladroit, capable d’élaborer un scénario terriblement précis et glaçant, qui est-il vraiment? Un sadique? Un psychopathe? Ou, simplement, un mari qui cherche à reconquérir sa femme et à obtenir son admiration? Un enfant blessé? « En vérité, cet étranger n’est pas vraiment « lui ». Tout au moins, il n’est pas l’homme qu’elle connait depuis plus de vingt-cinq ans. » Au cours des chapitres, l’auteure fait alterner le récit du voyage d’anniversaire et celui de l’enfance de Mateu qui éclaire peu à peu sa personnalité. Enfant solitaire, délaissé...
Souvenirs de l’avenir, Siri Hustvedt
écrit par Fleur Bournier
“Ce livre est un portrait de l’artiste en jeune femme, l’artiste venue à New York pour lire, souffrir et écrire son mystère. Comme le grand détective qui a les mêmes initiales qu’elle S.H., l’écrivain voit, entend et flaire les indices.” Roman, récit autobiographique, essai féministe, Souvenirs de l’avenir fait chanceler les frontières entre fiction et réalité. Siri Hustvedt y approfondit ses thèmes de prédilection : la création littéraire, les méandres de la mémoire, ou encore la violence du patriarcat. Souvenirs de l’avenir est un roman composite, drolatique et sérieux, qui entrecroise deux époques, mêle trois strates narratives – le “maintenant” de la narratrice-autrice, le journal de la jeune romancière en herbe et des extraits de son premier roman inachevé -, le tout rafraîchi de petits croquis. Siri Hustvedt y brouille à dessein les frontières entre fiction et réalité. Sa narratrice se nomme S.H., un certain nombre de faits coïncident avec sa vie, quand d’autres, en revanche, viennent annihiler toute identification. L’autrice poursuit dans ce roman sa réflexion sur la porosité entre mémoire et imagination, qu’elle prête à son double fictif : «J’ai toujours cru que mémoire et imagination étaient une seule et même faculté.» ; « dites-moi où finit la mémoire et où commence l’invention?» New York, 1978, une jeune femme originaire du Minnesota emménage dans un vieil immeuble aux fines cloisons afin d’écrire son premier roman. « Je ne cherchais ni le bonheur ni mes aises à New York. Je cherchais l’aventure, et je savais que l’aventurier doit souffrir avant d’arriver chez lui après d’innombrables épreuves sur terre comme sur mer, ou de finir éteint d’un souffle par les dieux. » La jeune femme se donne un an pour écrire son premier roman. Elle n’a alors qu’une vague idée de son héros, « moins un personnage...
De l’Ardeur, Justine Augier
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De l’ardeur, récit à la fois très documenté et très personnel de Justine Augier retrace le destin tragique de Razan Zaitouneh, avocate syrienne et militante des droits de l’homme enlevée en 2013. Portrait d’une femme résistante au coeur de la Syrie en guerre. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, à Douma dans la banlieue de Damas, Razan Zaitouneh, 36 ans, est enlevée ainsi que son mari et deux compagnons de lutte. On est sans nouvelles d’eux à ce jour. L’enlèvement est attribué à un groupe salafiste, agissant selon certains sur ordre de Bachar-al-Assad. Justine Augier enquête, lit tout ce qui la concerne, les nombreux articles qu’elle a publiés, interroge ceux qui l’ont connue, en particulier sa soeur ainée, et tente de reconstituer l’itinéraire de cette femme qui la fascine. Avocate diplômée en 2000, Razan se spécialise dans les droits de l’homme; elle commence par assurer (gratuitement) la défense des islamistes arrêtés et détenus par le régime syrien. (Ironie du sort ce seront des islamistes qui l’enlèveront quelques années plus tard.) Bachar-al-Assad succède alors à son père, le pays croit à des réformes possibles, des prisonniers sont libérés. C’est le Printemps de Damas, brève période d’ouverture pour le peuple syrien, qui ne dure que huit mois. Les espoirs sont vite réprimés, le régime s’en prend aux activistes. Razan est de toutes les manifestations en faveur de la démocratie; elle crée avec d’autres l’Association syrienne des droits de l’homme; elle écrit aussi de nombreux articles publiés à l’étranger. En 2011, les forces gouvernementales tirent sur la foule et c’est le début du cycle infernal et sanglant de la révolution et de la répression. Razan Zaitouneh fonde alors le Centre de documentation des violations en Syrie où elle recense inlassablement les exactions du régime,...
Une Bête au paradis, Cécile Coulon
écrit par Fleur Bournier
Prix Littéraire Le Monde 2019, Une Bête au Paradis est à la fois un beau roman et une effroyable tragédie. Une histoire de passions, d’abandons et de vengeances. Le Paradis est un vaste domaine, une ferme, avec sa cour et sa basse-cour, sa fosse à cochons, et plus loin les Bas-Champs, et le Sombre-Etang. Là, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, orphelins suite à un tragique accident de voiture. Elle s’occupe de son exploitation avec l’aide de Louis, un autre fracassé de la vie qu’elle a recueilli au Paradis. La vieille femme semble tirer sa force vitale de cette terre, loin d’elle les ans la rattrapent. Emilienne, c’est la terre, la Terre-Mère, la terre qui nourrit, qui abrite, qui protège. « Elle traversait l’existence, dévolue au domaine et aux âmes qui l’abritaient. Tout commençait par elle, tout finissait par elle. » Blanche marche sur ses pas, petite « guerrière de cinq ans » bien décidée à survivre. Gabriel, lui, est « un garçon naïf, cassé par la mort de ses parents ». Il se tient dans l’ombre de ces deux femmes qui le portent à bout de bras, et trouve parfois en Louis, avec qui il partage sa chambre, un semblant de complicité. Blanche lutte, avance, grandit. Elève brillante, alors même qu’elle passe tout son temps libre à travailler à la ferme, elle ne cherche pas d’autre avenir que celui qui s’offre à elle. Un jour, son voisin de table, Alexandre, lui propose un marché : contre son aide en mathématiques, il fera la publicité de la ferme. Elle accepte, se laisse peu à peu apprivoiser et finalement tombe amoureuse. Comment résister à Alexandre, à son sourire enjôleur, à son assurance joyeuse ? Sous les yeux jaloux de Louis, Blanche cède tout entière à sa passion pour Alexandre....
Dans une coque de noix, Ian Mac Ewan
écrit par Fleur Bournier
Confiné dans le ventre de sa mère, un fœtus mène l’enquête. Que complotent sa mère et son amant ? Comment sauver son père du mauvais coup que ces deux-là semblent tramer ? Clin d’œil malicieux à Hamlet, Dans une coque de noix revisite avec humour le roman policier. Dans une coque de noix est un petit roman qui regorge de bien des surprises. A commencer par le choix d’un narrateur peu ordinaire, un fœtus : « Me voici donc, la tête en bas dans une femme. Les bras patiemment croisés, attendant, attendant et me demandant à l’intérieur de qui je suis, dans quoi je suis embarqué ». Espiègle, fin œnologue et féru de programmes en tout genre, celui-ci ne recule devant rien pour parfaire son éducation in vivo : « Au milieu d’une longue nuit calme, il m’arrive de donner un bon coup de pied à ma mère. Elle se réveille, cède à l’insomnie, prend la radio. Un divertissement cruel, certes, mais au matin, nous sommes tous deux mieux informés ». Le narrateur-fœtus offre au lecteur sa perception du monde, lacunaire, drôle, et d’autant plus jouissive que très vite le récit prend des allures de roman policier. Alerté par des bribes de conversations entre sa mère et son amant, le narrateur-fœtus revêt la casquette de détective. Il entend bien mener son enquête et trouver le fin mot de l’histoire. Les informations qu’il glane lui font craindre que les deux comploteurs ne s’en prennent à son cher poète de père, mis à la porte de chez lui par sa mère et allant de maladresse en maladresse pour la reconquérir. Prêt à voler à son secours, sa condition l’embarrasse. Que faire ? D’autant que d’autres révélations vont ébranler ses certitudes… Dans une coque de noix, Ian McEwan, traduction France Camus-Pichon, Gallimard folio, 240...
Jetez moi aux chiens, Patrick McGuinness
écrit par Fleur Bournier
Inspiré d’un réel pugilat médiatique, Jetez moi aux chiens met à nu une société avide de faits divers et de coupables tout trouvés, solidement nourrie par une presse à sensation sans scrupule. Un faux roman policier et une vraie petite pépite littéraire. Jetez moi aux chiens commence comme un polar : après un premier chapitre déroutant, le lecteur est plongé dans une sordide affaire de meurtre, qui n’est pas sans rappeler un véritable fait divers. En décembre 2010, à Bristol en Angleterre, une jeune femme est portée disparue, puis retrouvée morte, étranglée. Noël approche, il faut résoudre l’affaire au plus vite. Un premier suspect est rapidement arrêté, son propriétaire et voisin, Christopher Jefferies. Les journaux s’emparent aussitôt de ce fait divers et condamnent cet ancien professeur sans aucune forme de procès : cet homme cultivé et singulier incarne le coupable idéal. Quelques jours plus tard, l’assassin est arrêté, Christopher Jefferies disculpé. Cette histoire de violence ordinaire est le canevas du nouveau roman de Patrick McGuinness. L’auteur y rend une forme de justice à celui qui a été pour lui un professeur bienveillant et qui a apporté un peu de joie dans sa scolarité au sein d’une école privée élitiste. Dans son roman, M. Wolphram, le suspect, est un double fictif assez transparent de Christopher Jefferies. Du jour au lendemain arrêté puis inculpé, il voit son mode de vie passé au crible. La presse, le rebaptisant opportunément « Le Loup », en fait le coupable idéal. Ainsi, chaque détail devient une preuve irréfutable de sa culpabilité : ses goûts musicaux et cinématographiques, son célibat, le moment de son départ à la retraite (quand l’école devient mixte). « Quand l’innocence est aussi louche, on n’a que faire de la culpabilité » constate amèrement le narrateur-enquêteur. Néanmoins,...
Journal, Sandor Marai
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De 1943 à sa mort en 1989, le grand écrivain Sandor Marai tient son Journal, dont de larges extraits sont aujourd’hui publiés en français. Ce premier tome, intitulé Les années hongroises 1943-1948, couvre la période de la guerre, de l’occupation allemande à l’occupation soviétique. Passionnant. Durant ces cinq « années hongroises », que l’on pourrait aussi nommer années tragiques ou décisives, Sandor Marai est au cœur des grands drames du XX° siècle. Dans la capitale et à la campagne, il vit l’occupation nazie, la déportation des Juifs (dont son beau-père), les bombardements alliés, le siège de Budapest, la libération par l’armée rouge et la prise de pouvoir des communistes. Son beau-père est déporté, son appartement détruit par les bombes, sa maison de campagne réquisitionnée pour loger seize soldats de l’armée soviétique (plutôt sympathiques ces jeunes Russes admiratifs de l’écrivain). Ecoeuré par le nouveau régime, par la nationalisation des esprits et la confiscation des libertés, attaqué par la presse communiste, l’écrivain bourgeois (comme il aime à se qualifier) fuit ce pays dans lequel il n’a plus sa place. Il s’exile, la mort dans l’âme, et part vers la Suisse et l’Italie n’emportant que cinq livres dont L’Odyssée (lui qui possédait avant les bombardements une bibliothèque de plus de cinq mille livres.) Quitter la Hongrie est pour lui la seule manière de continuer à faire vivre la langue et la littérature hongroise. Ce qui surprend dès les premières pages, c’est la forme originale de ce journal sans indications de dates. Constitué de paragraphes séparés par un trait, l’ouvrage est fait de notations plus ou moins brèves, de réflexions (entre Choses vues de Victor Hugo et Maximes de La Rochefoucauld), parfois de micro-récits, presque des nouvelles avec chute. Ce qui étonne aussi c’est l’humour dont fait preuve l’auteur (humour...
Un été sans les hommes, Siri Hustvedt
écrit par Fleur Bournier
Avec humour et finesse, Siri Hustvedt trace le parcours d’une femme blessée qui trouve en ses pairs et en elle-même une force insoupçonnée. Un roman féminin et féministe, drôle, émouvant et intelligent. A partir de la trame narrative rebattue de l’époux infidèle, Siri Hustvedt fait un pas de côté. Elle ne racontera ni les cris ni les larmes, mais la reconquête de soi et de sa liberté, dans une tendre célébration des femmes qui leur rend justice : « La banalité de l’histoire – le fait qu’elle soit répétée chaque jour ad nauseam par des hommes qui, s’apercevant tout à coup ou petit à petit que ce qui EST pourrait NE PAS ÊTRE, font dès lors en sorte de se libérer des femmes vieillissantes qui ont, pendant des années pris soin d’eux et de leurs enfants – n’amortit pas le chagrin, la jalousie et l’humiliation qui s’emparent des abandonnées. Femmes bafouées. » Mia, poétesse de 55 ans, fait le récit sans complaisance et plein d’humour de sa difficile reconstruction après la défection de son époux, une «pause» selon lui, ce qui vaut à sa maîtresse d’être affublée de ce sobriquet :« La Pause était française, elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d’étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de vingt ans plus jeune que moi ». Remise de sa «crise psychotique», Mia préfère quitter New York pour tenter de se reconstruire. Elle s’installe à Bonden pour l’été, ville de son enfance où vit encore sa mère dans une résidence pour personnes âgées. Elle y enseigne la poésie à des adolescentes «dans le cadre du Cercle artistique local». Une galerie de personnages féminins représentant tous les âges de l’existence y entoure peu à peu...
Le cœur de l’Angleterre, Jonathan Coe
écrit par Fleur Bournier
Prix du livre européen 2019, Le Cœur de l’Angleterre, le dernier roman de Jonathan Coe, dresse un portrait cinglant de l’Angleterre des dernières décennies. L’auteur interroge avec un humour caustique et décalé les évènements qui ont pu conduire au Brexit. Un roman réjouissant autant qu’effarant. Dans son dernier opus, Jonathan Coe renoue avec les personnages de Bienvenue au Club, et de sa suite Le Cercle fermé, les membres de la famille Potter, choix non prémédité qui s’est finalement imposé à lui. Nulle nécessité cependant d’avoir lu les deux précédents pour savourer le dernier en date. Le roman s’ouvre en 2010 alors que Benjamin et Loïs Potter enterrent leur mère. Benjamin a à présent la cinquantaine et vit isolé dans un moulin retapé. Sa sœur reste hantée par les évènements traumatisants de son passé. Autour d’eux, membres de la famille ou amis créent un microcosme reflétant ce qui se joue à plus grande échelle dans le pays et qui va conduire au Brexit. La narration, à sauts et à gambades, suit différents personnages, allant de l’un à l’autre, les laissant en suspens, avant de les retrouver des jours, des semaines ou des mois plus tard. Ces nombreuses ellipses insufflent un rythme au récit, tendu vers l’avant, celui de l’engrenage dans lequel est prise l’Angleterre et qui la conduit à l’inimaginable. Les titres des trois parties qui composent le roman –La joyeuse Angleterre, L’Angleterre profonde, La vieille Angleterre- révèlent ce retour en arrière aussi imprévisible qu’inquiétant. L’histoire politique de l’Angleterre du début du millénaire, retracée par l’auteur non sans une ironie acerbe, n’est pas inconnue du lecteur. Néanmoins c’est avec une profonde incrédulité qu’il se voit replonger dans la campagne nauséabonde du Brexit. Sous couvert de la promesse de redevenir une nation puissante, certains politiques, appuyés...
Par les routes, Sylvain Prudhomme
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Roman fluide et prenant, Par les routes de Sylvain Prudhomme évoque, à travers l’histoire croisée de deux amis, la multiplicité des possibles et les aspirations contraires. Sacha, écrivain parisien, la quarantaine, décide de tout quitter. « Envie de table rase. De concentration. De calme. » Il vide ses placards et ses étagères, part avec deux sacs de livres et de vêtements dans un meublé à V., petite ville du Sud-Est de la France. « En route pour la vie que je voulais. Ramassée. Sobre. Dense. » Mais il y retrouve par hasard un ancien ami perdu de vue depuis depuis dix-sept ans. Apparemment installé – une femme, un enfant, une maison (en location) – celui qu’il nomme « l’autostoppeur » est régulièrement pris de l’envie de partir à travers la France en auto-stop. Au cours de ses voyages, de ses échappées, il envoie des cartes postales et des polaroïds, portraits des automobilistes qu’il a rencontrés. Peu à peu, les liens se tissent entre Sacha et la famille de son ami, sa femme Marie, son fils Agustin; Sacha devient de plus en plus présent, l’autostoppeur, de plus en plus absent; il s’éloigne jusqu’à disparaître. Le propos du livre est cependant moins de raconter une histoire d’amour qu’une histoire d’amitié, on pourrait presque dire de gémellité. Sacha et l’autostoppeur, celui qui reste et celui qui part, sont à la fois proches et opposés. Leurs désirs semblent contraires mais dans les deux cas il s’agit de liberté, d’indépendance, de solitude et de rencontres nouvelles. On peut même parfois se demander, puisque l’auto-stoppeur n’est jamais nommé, s’ils ne sont pas au fond qu’un seul et même personnage, incarnant les facettes contradictoires d’un même individu. Comme dans le Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, cet ami ne serait-il qu’un double « une figure de sa jeunesse, de...
Tout le monde n’habite pas, Jean-Paul Dubois...
écrit par Fleur Bournier
Récompensé par le Goncourt 2019, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, le dernier Jean-Paul Dubois, sans constituer une lecture indispensable, offre au lecteur un moment agréable et distrayant. « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» nous prévient le titre. Pour Paul Hansen, le narrateur, il s’agit de s’adapter à la vie au pénitencier de Montréal dans une cellule de six mètres carrés, qu’il partage avec Patrick Horton, un Hells Angel en attente de jugement pour meurtre, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos – Life is a bitch and then you die – et celle de son amour pour les Harley Davidson sur l’arrondi des épaules et le haut de la poitrine. » Cet impressionnant compagnon de cellule se révèle au fil du roman bien plus sympathique qu’il n’y pouvait paraître. Sous sa carcasse de géant, Horton cache une âme d’enfant, effrayé par les rongeurs, intimidé par une visite de sa mère et tétanisé par des ciseaux de coiffeur. Les deux hommes apprennent au fil des jours à s’apprivoiser, à préserver ce qu’il faut d’humanité dans la promiscuité. L’omniprésence d’Horton est ce qui pèse le plus à Paul, il s’évade donc constamment dans souvenirs et rêveries, et accueille les fantômes qui lui sont chers : son père, le pasteur Jansen, sa femme Winona, sa chienne Nouk. Paradoxalement, Jean-Paul Dubois fait de la prison un espace où son personnage acquiert « une forme de liberté incroyable ». Ainsi qu’il l’explique lors d’une interview pour France Culture : « ces deux années vont lui permettre de reconsidérer le monde, de reconsidérer sa vie et de reconsidérer ses souvenirs, de vivre avec ses morts, de vivre ce passé, de comprendre tout un tas...
La Mer à l’envers, Marie Darrieussecq
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Marie Darrieussecq a le don d’être en résonance avec les sujets d’actualité et de nourrir ses romans de son expérience. Son dernier roman, La Mer à l’envers, croise ainsi l’itinéraire d’un migrant nigérien et l’histoire d’une femme au tournant de sa vie. Partie en croisière sur la Méditerranée avec ses deux jeunes enfants, Rose, quadragénaire en pleine crise conjugale, fait une rencontre qui la bouleverse. Le 24 décembre, quand l’énorme paquebot recueille des migrants naufragés d’un petit chalutier, son regard croise celui de Younès, un adolescent nigérien. Et c’est une reconnaissance immédiate : « Si j’adoptais un enfant, ce serait lui. » Elle lui donne des vêtements, le portable de son fils. Les migrants débarquent en Italie, la croisière continue. Alors qu’elle est revenue à Paris, Rose reçoit un appel de Younès sur son portable. D’abord, elle ne répond pas, elle fuit, elle élude, elle hésite. Quelques mois plus tard, alors qu’elle a déménagé avec sa famille dans le Pays Basque, nouveau coup de fil : Il est blessé, épuisé. Elle part à Calais, le ramène, l’installe dans la chambre d’ami, le nourrit, le soigne. Le jeune migrant noir serait-il en train de devenir un nouveau personnage de roman? On pense aussi à Arcadie d’Emmanuelle Bayamack-Tam, à L’Archipel du chien de Philippe Claudel et à bien d’autres… Comme Vendredi, il est celui qui trouble, éblouit et remet en question. Mais Marie Darrieussecq n’écrit pas un livre sur les migrants et encore moins un livre à thèse. Dans La Mer à l’envers (que l’on peut entendre aussi comme la mère à l’envers) le personnage principal c’est Rose Goyenetche la « psychologue bizarre » qui soigne par imposition des mains, don qu’elle tient de sa grand-mère, la mère aimante et désarmée face à l’évolution de ses enfants, la quadragénaire qui...
Les Livres de Jakob, Olga Tokarczuk
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lire Les Livres de Jakob, le dernier roman d’Olga Tokarczuk, Prix Nobel de Littérature 2018, c’est plonger dans la Pologne du XVIII° siècle, découvrir l’histoire véridique et méconnue du «messie» Jakob Frank et partager le quotidien d’une multitude de personnages. Un livre-somme foisonnant et captivant. Il y a tout d’abord l’objet-livre. Sa taille, son poids. Et son titre complet, parodiant les romans du XVIII°, qui est tout à la fois un résumé, un programme et une promesse : Les Livres de Jakob ou Le Grand Voyage A travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d’autres moindres. Rapporté par les défunts, leur récit se voit complété par l’auteure selon la méthode des conjectures puisées en divers livres, mais aussi secourues par l’imagination qui est le plus grand don naturel reçu par l’homme. Mémorial pour les Sages, Réflexion pour mes Compatriotes, Instruction pour les Laïcs, Distraction pour les Mélancoliques. Et enfin, lorsqu’on démarre la lecture, sa numérotation inversée déroute – on commence à la page 1029 et on finit à la page 4 – référence à la Kabbale et image de la vie qui, contrairement à l’idée reçue, serait une perte permanente : « Nos conquêtes, nos enrichissements sont la plus grande des illusions. En réalité, nous sommes au summum de notre richesse à notre naissance, ensuite nous ne faisons que nous délester de tout. » Tout commence par un mariage dans la demeure d’un marchand juif, Elisha Shorr : un couple se forme, une aïeule s’éteint, la joie côtoie la tristesse, et Nahman, un invité venu de Turquie, « un étranger en bas blancs et sandales », parle d’un certain Jakob. Elisha Shorr décide alors de faire venir cet homme providentiel en ce temps de pogroms et de persécutions : « Nous avons besoin de quelqu’un qui nous...
Girls, Edna O’Brien
écrit par Fleur Bournier
Edna O’Brien s’empare dans son dernier roman d’un évènement tragique qui suscita l’émoi l’international en 2014 : l’enlèvement d’une centaine de lycéennes par Boko Haram au Nigéria. Quelques années plus tard, certaines se sont enfuies, d’autres ont été libérées, d’autres encore sont toujours portées disparues. L’autrice retrace le parcours de l’une d’entre elles dans un récit bouleversant. « J’étais une fille autrefois, c’est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier. Emmenée en trombe à travers cette forêt que j’ai vue, cette première nuit d’effroi, quand mes amies et moi avons été arrachées à l’école. » Ainsi s’ouvre le dernier roman d’Edna O’Brien. Des phrases incisives qui placent d’emblée le lecteur sur la crête du soutenable. De courts chapitres, écrits à la première personne, se succèdent, comme autant d’incursions dans l’esprit chancelant de Maryam, jeune fille enlevée par Boko Haram et réduite en esclavage. Des fragments terrifiants d’une vie en lambeaux. Des instantanés qui retracent le calvaire de la jeune fille, violée, mariée de force, mais qui trouve la force de fuir, de survivre et d’être mère : « Je ne suis pas assez grande pour être ta mère. » confie-t-elle, exténuée et désespérée, à son bébé. L’horreur du camp djihadiste, la fuite éperdue dans la forêt avec son bébé, Babby, et une de ses compagnes, Buki, ne sont pas les dernières épreuves que doit endurer Maryam. Suspecte plus que victime, elle doit encore prouver qu’elle ne s’est pas convertie et ne représente aucun danger. Pire, elle reste, même aux yeux des siens, « une femme du bush » marquée du sceau de l’infamie. Les retrouvailles tant espérées avec sa mère, son père et son frère n’ont pas lieu. C’est de retour dans son village que les derniers remparts de la jeune fille cèdent : « Au milieu de toute cette prière, de ces mea culpa et de cette hypocrisie, quelque chose en moi s’est noirci. Je m’en suis approchée. Je l’ai étreinte. J’y suis entrée, dans la noirceur. » Edna O’Brien ne nous épargne aucune des violences subies par les jeunes filles enlevées, mais son écriture toute en pudeur et en retenue leur rend leur dignité. Et la belle traduction d’Aude de Saint-Loup et de Pierre-Emmanuel Dauzat ne la trahit en rien. Le lecteur s’accroche à la beauté des mots, des phrases, refuges contre la noirceur environnante : « Parfois je suis dans la forêt, une forêt peu familière, vidée de toute humanité. Les arbres sont gigantesques, leurs troncs gris noueux. Ils parlent un parler noueux. » La parole de Maryam semble se déployer dans un seul souffle, laissant le lecteur suspendu à ce flot qui le plonge dans un récit atroce et sublime. La parole se révèle au fil des chapitres l’un des enjeux du récit puisqu’elle est la clef de la liberté : censurée au camp djihadiste, impossible face à son thérapeute tant la jeune fille reste prisonnière du cauchemar vécu : « Je lui dis des choses, pour ne pas lui dire des choses […]. Il sait qu’il y a plus à dire, mais que je ne peux pas. Entre nous il y a ce fossé béant. » ; puis, elle surgit, libère, et permet de reprendre en main son destin volé : « Je n’arrive pas à croire que je lui raconte, que je confesse réellement mon massacre nocturne. A chaque rêve, la nuit, ça devient plus sanglant. Je fais bouillir mes ravisseurs dans de grandes marmites noires. » Girl vient s’inscrit dans la continuité d’une œuvre qui s’attache à des parcours de femmes courageuses qui ont lutté pour leur liberté, à l’image de l’autrice elle-même. Le titre d’ailleurs en fait entendre un autre, The Country Girls, roman autobiographique dans lequel Edna O’Brien retrace son enfance dans une famille irlandaise conservatrice où la littérature et les femmes n’ont pas voix au chapitre. Un singulier en écho à un pluriel, une destinée qui vient en dire tant d’autres. Roman magistral et éprouvant, « Girl est un livre...
My Absolute Darling, Gabriel Tallent
écrit par Fleur Bournier
Encensé par la critique, le premier roman de Gabriel Tallent a en effet tout pour plaire car il aborde, dans un style qui oscille entre poésie descriptive et oralité, bon nombre de thèmes d’actualité brûlants : le survivalisme, les dérives du deuxième amendement, la force de la Nature et surtout l’inceste. Dérangeant et haletant, My Absolute Darling met à rude épreuve le lecteur qui retient son souffle jusqu’au dernier chapitre. Le nom ou plutôt les noms de l’héroïne raconte son histoire. Julia Alveston a abandonné son prénom pour celui de Turtle, bien plus conforme à sa vie, repliée avec son père survivaliste dans une bicoque isolée sur la côte nord de la Californie, mais aussi en elle-même, sous une carapace solide, pour survivre, affronter le monde extérieur et supporter la vie quotidienne avec un père idolâtré et exécré. Ce dernier l’affuble du sobriquet affectueux de « Croquette », aussi infantilisant que réifiant. Elle est sa chose, son bon petit soldat : « Espèce de petite connasse, tu es à moi » lui assène-t-il. C’est le titre qui finalement permet de mieux percer toute l’horreur de la vie de Turtle : « my absolute darling », ces mots d’amour que Martin lui chuchote alors qu’il la viole enferment la jeune fille dans une relation incestueuse. Son père s’est érigé en seul repère fiable dans un monde qui court à sa perte. Comment lui échapper ? Chapitre après chapitre, le lecteur est plongé dans les pensées et la vie de Turtle, et quand il croit avoir atteint avec elle les limites du supportable, d’autres pages viennent lui tordre davantage les tripes : «Elle s’allonge dans le sable mouillé, elle souffre toujours dans le froid, mais elle est désormais à l’abri du vent. Elle sent les battements de son cœur dans son dos enflé et dans ses doigts...
La Douce Indifférence du monde, Peter Stamm
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Avec La Douce Indifférence du monde le romancier suisse Peter Stamm compose un récit subtil, plein de charme et de mystère, une réflexion sur le temps, le réel et l’imaginaire. Envoûtant. Toute l’histoire de ce roman inracontable est celle d’un dédoublement. A l’issue d’une représentation de Mademoiselle Julie, Christoph, le narrateur, romancier d’une cinquantaine d’années, donne rendez-vous à Lena, jeune actrice qui lui rappelle Magadalena, la femme aimée une quinzaine d’années auparavant. Dans un cimetière de Stockholm puis dans un café, il lui raconte son histoire, son amour passé pour Magadalena et ses rencontres obsédantes avec un jeune homme qui ressemble étrangement à celui qu’il a été. Au fil du récit et de leur déambulation, des similitudes troublantes apparaissent entre les vies des deux protagonistes, à la fois semblables et différentes. Il y a tout d’abord le titre -inspiré de Camus (1)- qui attire, puis l’atmosphère étrange qui séduit et l’écriture qui entraîne. Même si l’on se sent quelque peu désarçonné(e) dans ce roman qui tient de Vertigo et de Mulholand Drive, même si l’on se perd parfois, dans l’alternance des récits, entre les couples, les époques et les lieux, on se laisse emporter jusqu’au dernier chapitre. Au cours du livre, le narrateur, l’héroïne, et le lecteur, s’interrogent sur la réalité et la fiction. Qu’est-ce qui est vrai ou inventé, souvenir ou imagination? Christoph a-t-il vraiment vécu l’histoire qu’il raconte à Lena? Au fond, chacun a le désir de faire de sa propre vie une histoire, qu’il soit écrivain, acteur, lecteur ou simple noctambule un peu ivre et bavard. Mais « il n’y a que dans les livres que les histoires ont une fin. (…) Dans la réalité, il n’y a pas de fin, sauf la mort. Et elle est rarement heureuse. » L’homme mûr est...
ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman unanimement salué par la critique et cité pour les prix, Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard évoque une passion dévorante entre deux jeunes femmes dans un rythme et un style fiévreux. C’est une histoire d’amour fou qui surprend, bouleverse et emporte les deux protagonistes : la narratrice, jeune professeure de lycée, mère d’une petite fille et récemment séparée de son compagnon, et Sarah, violoniste concertiste dans un quatuor. Sarah, la tornade trentenaire aux allures d’adolescente, passionnée et imprévisible, fascinante et tyrannique. Sarah, vivante et mortifère. Cette passion se vit pendant deux ans sous le signe de l’urgence et de l’excès : des courses éperdues, des nuits volées entre deux avions ou deux trains, des retrouvailles et des départs, des larmes et des étreintes. Peu à peu, l’euphorie amoureuse fait place à la douleur d’aimer. Après les débuts idylliques, viennent les désaccords, les orages, les scènes de plus en plus fréquentes et la rupture. C’est une histoire d’amour torride, tumultueuse et tragique, forcément tragique car, comme dans le théâtre antique, l’issue fatale en est annoncée dès la première page. A l’image de la passion qu’il raconte, le roman de Pauline Delabroy-Allard se déroule et se lit à toute allure, en courts chapitres superposés et numérotés comme autant de flashs de vie – quatre vingt-deux dans la première partie, trente dans la deuxième où le temps semble suspendu à Milan et à Trieste. A l’image des quatuors de Beethoven et de Schubert que la narratrice écoute en boucle, des leitmotivs obsessionnels (mots, phrases ou paragraphes) scandent la narration comme autant de refrains entêtants. Sarah, envahissante, prend toute la place dans l’histoire. Son prénom résonne dans le titre, comme dans tout le livre, avec le S sifflant et la première syllabe :« ça raconte ça, je me souviens de ça». Son portrait est repris avec des variantes « Ça raconte Sarah, sa beauté inconnue, cruelle, son nez d’oiseau de proie, ses yeux comme des silex, ses yeux meurtriers, assassins, ses yeux de serpent aux paupières tombantes.» Sa volonté impérieuse et contradictoire rythme la phrase : « Elle veut qu’on aille au cinéma, elle veut qu’on fasse l’amour, elle veut qu’on s’endorme ensuite dans les bras l’une de l‘autre, elle veut qu’on arrête de s’écrire et de se parler pendant quelques jours, elle veut qu’on mange japonais, elle veut qu’on parte en week-end à la campagne pour se reposer, elle veut que j’arrête de pleurer, elle veut aller à une fête sans moi, elle veut ne pas avoir de responsabilité, elle veut être légère, elle veut être libre. » Omniprésente, éblouissante, Sarah prend toute la lumière et éclipse tous les autres personnages; la narratrice elle-même n’a pas de nom ni sa petite fille, tous les personnages secondaires sont effacés, réduits à leur rôle d’acteur dans cette passion aveuglante et dévoratrice. Enfermé(e) dans le point de vue de la narratrice qui raconte à la première personne, le lecteur/la lectrice partage sa subjectivité, son obsession (on pourrait presque dire sa possession) et n’a pas accès à la réalité des faits. L’une des forces du roman est ainsi de maintenir jusqu’à la dernière page la tension et l’incertitude, aux confins de la folie. Peu importe qu’il s’agisse d’une relation entre deux femmes, « Sarah » devient le symbole de toute passion, du désir impérieux, de l’impossible fusion et de la souffrance de l’absence. Même s’il n’est pas dépourvu de quelques maladresses et de tics d’écriture contemporains (comme l’usage du copier coller Wikipedia pour définir un film, une ville), ce court roman aux accents durassiens emporte et séduit le lecteur. Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard, Les Editions de Minuit, 2018, 188...
Arcadie, Emmanuelle Bayamack-Tam
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Notre coup de coeur en cette rentrée littéraire, Arcadie, le onzième roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam, nous entraîne dans une communauté libertaire à travers le regard d’une adolescente. Eden ou secte, en tout cas miroir révélateur et voyage en utopie mené avec brio. A Liberty House, zone blanche située quelque part dans le sud-est de la France, se retrouvent tous les exclus, les marginaux, les laissés pour compte de la modernité – malades, toxicos, obèses, nonagénaires… Autour d’Arcady, leur guide charismatique qui arbore en tatouage la devise latine « Omnia vincit Amor », ils cultivent leur jardin (bio, évidemment) et pratiquent l’amour libre. Farah, la narratrice adolescente, y est arrivée à l’âge de six ans avec sa mère souffrant d’électro- sensibilité, son père dyslexique passionné d’horticulture et sa grand-mère naturiste. Elle y a grandi sans contrainte, vivant une enfance heureuse entre les arbres et les livres, loin des Mac Do et des réseaux sociaux. Mais, à l’adolescence, son physique disgracieux se précise : loin d’embellir, la jeune fille se virilise et se pose alors, à l’heure des premiers désirs, la question de son identité sexuelle. A quatorze ans, elle rêve de défloration, tour à tour attirée par Arcady, figure paternelle qu’elle vénère depuis des années, puis par la jeune Maureen rencontrée hors de la communauté et enfin par Angossom, l’étranger à peine entrevu. Le récit a ainsi des airs d’adieu à l’enfance qui s’éloigne et que l’on enterre – comme les objets que les pensionnaires enfouissent dans la capsule temporelle pour les générations futures – « en cette fin d’été qui voit quatre d’entre nous battre pavillon vers les rives, sans charme ni mystère, de l’âge adulte. »Le temps, le lieu de l’innocence s’éloignent, remplacés par celui du désir ; le « nous » fait place au « je » ; l’ailleurs attire irrésistiblement au-delà de...
Le Lambeau, Philippe Lançon
écrit par Marie-Odile Sauvajon
7 janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo. Gravement blessé à la mâchoire, le journaliste Philippe Lançon passe neuf mois en hôpital et subit de nombreuses interventions chirurgicales. Le Lambeau est le récit – précis, factuel, terrible et magnifique – de cette lente et douloureuse reconstruction. Il faut tout d’abord dire que Le Lambeau n’est pas, ce que l’on aurait pu craindre, pathétique, idéologique ou résilient. Ici, ni complaisance larmoyante, ni analyse socio-politique , ni optimisme volontariste. Philippe Lançon recueille les faits, les sensations, le vécu au jour le jour depuis ce moment où la violence a fait irruption dans la salle de rédaction d’un hebdomadaire satirique, la transformant en scène de guerre. Fracassé corps et esprit, le survivant entame un long combat fait de persévérance, d’échecs et de recommencements. Entouré par ses proches – parents, frère, amis –, pris en charge par les soignants, il vit au rythme de l’hôpital. En relatant ce combat, il rend hommage au personnel hospitalier qui l’accompagne pendant ces longs mois de greffes, rejets, cicatrisation, rééducation… Dieux omnipotents qui fabriquent une mâchoire nouvelle à partir d’un os du péroné, doigts de fée qui réussissent un pansement impossible et trouvent une veine invisible, anges gardiens qui dispensent le sommeil bienfaisant de la morphine mais aussi personnages bien vivants dont il brosse les portraits. Tout l’univers de l’hôpital est là, un monde fait de professionnalisme, de compétence extrême et de bricolage. Un monde qui accueille les blessés de la vie, victimes d’accidents, de cancers, d’AVC ou de suicides ratés, qu’il croise dans les couloirs et dont les descriptions évoquent les gueules cassées de la Grande Guerre. D’ailleurs « sa » chirurgienne, personnage central avec qui se noue une belle relation, le lui rappelle : « Vous êtes un mutilé ». Roi dérisoire, défiguré, diminué, comme...
Eugenia, Lionel Duroy
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lionel Duroy délaisse l’autobiographie qu’il poursuivait depuis son premier ouvrage Priez pour nous publié en 1990 et évoque indirectement ses obsessions à travers l’histoire d’Eugenia dans la Roumanie des années 1940. Il y est question de la montée du nazisme et de l’antisémitisme, de l’engagement de l’écrivain et, encore et toujours, du poids de la famille et de la complexité des relations dans la fratrie. L’histoire se déroule entre 1935 et 1945, à Bucarest et Jassy, deuxième ville de Roumanie. Eugenia, la jeune héroïne âgée de dix-huit ans au début du récit, est aussi la narratrice de ces dix années terribles sur lesquelles elle se penche. Etudiante à l’université de Jassy, sa vie bascule quand elle rencontre le grand écrivain roumain d’origine juive Mihail Sebastian, invité par sa professeure de littérature à l’occasion de son dernier livre, Deux mille ans. Pour la jeune fille naïve, issue d’une famille où les propos antisémites sont monnaie courante, c’est une découverte intellectuelle et le début d’une histoire d’amour. S’éloignant peu à peu de son milieu d’origine et surtout de son frère Stefan, militant d’extrême droite pro-hitlérien, elle devient journaliste, couvre le pogrom de 1940 dans sa ville natale puis pousse encore plus loin l’engagement en participant activement à la résistance contre l’armée allemande. A la fin de la guerre, parce qu’elle veut tenter de comprendre, elle écrit le récit de ces dix années. Dans ce roman historique, l’auteur mêle fiction et réalité: il invente le personnage d’Eugenia qu’il place aux côtés de figures historiques, parmi lesquelles Mihail Sebastian, auteur roumain au destin tragique[1]. Avec ces personnages et le choix de la Roumanie, Lionel Duroy opère un double décentrement, à la fois biographique et géographique. On découvre l’histoire méconnue de ce pays pris en étau entre l’Allemagne et...
Désorientale, Négar Djavadi
écrit par Fleur Bournier
Dans la salle d’attente d’un hôpital parisien, une jeune femme trompe l’attente en se lançant dans le récit de ses origines. Telle Shéhérazade dans les Mille et Une Nuits, Kimiâ, la narratrice, multiplie les récits enchâssés, une digression en entraînant une autre, tissant une véritable fresque familiale dans l’Iran du siècle dernier. Sortie en poche très attendue ce mois-ci. Kimiâ attend et raconte, apostrophant le lecteur pour lui expliquer ce qu’elle fait dans cette salle d’attente, elle qui est venue seule, elle qui détonne face aux autres couples avec lesquels elle n’a rien à voir. Mais très vite le lecteur comprend que cette histoire cadre n’est que prétexte à dérouler une saga familiale marquée par l’histoire iranienne, la narratrice s’inscrivant dans cette tendance orientale à « à bavarder sans fin, à lancer des phrases comme des lassos dans l’air à la rencontre de l’autre, à raconter des histoires qui telles des matriochkas ouvrent sur d’autres histoires…« . Le conte oriental suit trois générations de Sadr, en commençant par l’arrière-grand-père paternel Montazemolmok, seigneur féodal originaire de Mazandaran et maître d’un harem ; suivent Nour la grand-mère, les oncles et surtout Darius, le père de Kimiâ, dissident politique insaisissable. Au fil des générations, les régimes se succèdent en Iran, chaque fois porteurs d’espoir, mais jouant finalement une partition de plus en plus sombre. Les parents de Kimiâ, Darius et Sara, fervents défenseurs de la liberté, n’hésitent pas à s’opposer à chacun des gouvernements, en dépit du danger et jusqu’à l’exil, car comme aime à le rappeler Emma, la grand-mère maternelle : « On a la vie de ses risques. Si on ne prend pas de risque, on subit, et si on subit on meurt, ne serait-ce que d’ennui. » Les oncles, numérotés selon leur place dans la fratrie, offrent une galerie de...
Les Passeurs de livres de Daraya, Delphine Minoui...
écrit par Marie-Odile Sauvajon
C’est une histoire incroyable que nous rapporte la journaliste Delphine Minoui: dans la ville de Daraya assiégée par les forces syriennes, de jeunes combattants créent une bibliothèque clandestine. Des livres sous les bombes, rempart fragile et dérisoire; une histoire tragique et cependant pleine d’espoir. Daraya, ville de la banlieue de Damas réputée pour ses terres fertiles et son doux raisin, est devenue ville martyre. Dès 2002, les premiers mouvements d’opposition ont entraîné une répression sanglante. Après les manifestations de 2011 et 2012, la ville est assiégée et bombardée sans trêve par l’armée de Bachar al-Assad. Bombes barils, armes chimiques, la ville est en ruines. Dans la cité qui comptait 250 000 habitants avant la révolution ne subsistent plus que 12 000 survivants qui manquent de tout. Beaucoup ont pris le chemin de l’exil, d’autres sont morts. Sous les gravats, sous les décombres des écoles et des maisons, les combattants trouvent des livres, les récupèrent. Peu à peu, des milliers d’ouvrages sont stockés. Qu’en faire? En 2013, dans le sous-sol d’un immeuble, ils aménagent une bibliothèque avec ses rayonnages, son classement, son règlement comme un îlot d’ordre au sein du chaos, un îlot de culture et de démocratie. C’est ainsi qu’ils deviennent Les passeurs de livres de Daraya. Pour pallier la pénurie d’ouvrages et de papier, les titres les plus demandés sont téléchargés, consultés sur les portables, imprimés sur des feuilles A4 en caractères minuscules. Pour répondre à la soif de savoir de ces étudiants privés d’université, des cours d’anglais, de science politique, des projections de courts métrages sont organisés. La bibliothèque devient lieu de rencontre, de résistance et même d’édition d’une petite revue photocopiée où se mêlent poésie, conseils pratiques et auto-dérision. Mais que lit-on sous les bombes? Bien sûr, des classiques – Shakespeare,...
Underground Railroad, Colson Whitehead
écrit par Fleur Bournier
Recommandé par Barack Obama1 ou encore Toni Morrison, couronné par le prix Pulitzer, Underground Railroad remporte tous les suffrages, et à raison. Colson Whitehead mêle Histoire et fiction dans une œuvre éclairante et nécessaire qui rappelle que la liberté reste un droit fragile, arraché de haute lutte par les noirs américains. Underground railroad est le récit saisissant de la fuite d’une jeune esclave, Cora, pour gagner les États libres du Nord. Elle emprunte pour cela un chemin de fer souterrain géré par un réseau clandestin d’hommes et de femmes abolitionnistes. Sous la plume de Colson Whitehead l’« underground railroad » prend vie. Historiquement, il s’agit d’une métaphore pour désigner des routes clandestines utilisées par les esclaves noirs américains pour gagner les États du Nord et le Canada. Environ 30 000 esclaves auraient ainsi été sauvés. Cette idée, l’auteur l’a gardée de son enfance – comme bon nombre d’écoliers américains-, persuadé alors qu’il existait bel et bien un chemin de fer souterrain. L’auteur s’amuse à brouiller les pistes : ainsi, l’un de ses personnages explique : « la plupart des gens croient que c’est une image, une figure de style […]. Le fameux chemin de fer souterrain. Mais je n’ai jamais été dupe. Le secret est sous nos pieds, depuis le début. » Cora n’a jamais connu la liberté. Elle est née esclave, fille et petite-fille d’esclave, dans une plantation de coton de Géorgie. Abandonnée par sa mère à l’âge de huit ans, elle est confrontée autant à la violence de ses pairs qu’à celle de ses maîtres et engage une lutte quotidienne pour sa survie. Lorsque Caesar lui propose de s’enfuir avec lui pour gagner les États libres du Nord, elle n’hésite pas longtemps. Commence alors pour elle une folle échappée et pour le lecteur un voyage aussi terrifiant qu’édifiant dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession. Le roman s’inscrit ainsi dans une longue tradition littéraire américaine de récits de voyage clandestin à la façon des hobos (vagabonds parcourant le pays à la recherche d’un travail en empruntant les trains de marchandises). Le roman est découpé en chapitres qui s’intéressent tour à tour à l’un ou l’autre des personnages, l’auteur explorant les motivations de chacun. Le point de vue du chasseur de prime qui traque Cora sans relâche, le terrible Mr Ridgeway, revient régulièrement et maintient le lecteur en haleine. Le lecteur apprend au fil du récit à connaître ce personnage et la raison de son acharnement à ramener, morts ou vifs, les esclaves en fuite. Voyageant comme la fugitive à travers les États, son regard est tout autre puisqu’il appartient à la classe des blancs dominants. Ce personnage presque démoniaque offre un contraste percutant avec les portraits des hommes du réseau clandestin qui risquent leur vie pour venir en aide aux « nègres marrons ». C’est une Amérique profondément duelle qui s’offre à nous et qui, malgré les années, l’est restée. Le succès de ce roman s’explique par la force de son récit et par le sentiment d’urgence qui l’anime. Rien n’est définitivement acquis en matière de droits et de libertés. Un chapitre particulièrement glaçant s’intéresse à la Caroline du Sud, État se revendiquant abolitionniste où se déroulent des programmes de recherche médicale : «La stérilisation contrôlée, la recherche sur les maladies transmissibles, le perfectionnement de nouvelles méthodes chirurgicales sur les inadaptés sociaux ». La Caroline du Nord quant à elle, effrayée de l’essor démographique de la population noire, décide que « la race noire n’existait pas, sinon au bout d’une corde. ». D’État en État, et toujours plus au Nord, de déconvenue en déconvenue, la jeune fille livre un combat qui semble sans fin pour simplement survivre. A ses côtés, le lecteur découvre un racisme profondément enraciné, une peur de l’autre qui conduit aux pires infamies, une noirceur de l’âme qui effraie encore une fois le livre refermé. Par bien des aspects, ce roman revêt une dimension universelle, dénonçant aussi bien l’esclavagisme que plus généralement toutes les formes d’oppression...
Article 353 du Code Pénal, Tanguy Viel
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Construit, dense et efficace, Article 353 du Code pénal, le dernier roman de Tanguy Viel, est une réussite. Il tient du roman social, du policier et fait entendre, entre confession, dialogue et plaidoyer, un ouvrier licencié, un homme floué dans la France des années 1990. Devant le juge d’instruction, Martial Kermeur, que l’on vient d’arrêter pour homicide, s’explique. Pour répondre à la question de ce dernier – «Bon sang, Kermeur, mais qu’est-ce qui vous a pris?» – il lui faut revenir sur les six années précédentes. Depuis le jour où Antoine Lazenec, l’homme providentiel, a débarqué en Porsche dans ce coin du Finistère sinistré par la fermeture de l’arsenal. Lisse et souriant, le promoteur achète le château et les deux hectares du parc avec vue sur la rade dans le but de transformer le bourg endormi en «station balnéaire». Habile manipulateur, il séduit et fait rêver en parlant avenir, investissement et rendement. Le maire lui-même est conquis et Martial Kermeur, l’ancien ouvrier spécialisé de l’arsenal, le socialiste de 1981, investit tout son argent – les 400 000 francs de l’indemnité de licenciement – dans ce projet immobilier. Et puis un jour, après six ans d’attente et de désillusion, lorsqu’il comprend qu’ils ont été bernés, qu’autour de lui des vies ont été brisées, Martial Kermeur pousse Lazenec dans l’eau froide à cinq milles des côtes parce qu’ «un type comme ça, monsieur le juge, un type comme ça, j’ai compris depuis: si ce n’est pas vous qui le faites disparaître, il ne disparaitra jamais. Il reviendra. Toujours.» Un dossier parmi beaucoup d’autres, «une vulgaire histoire d’escroquerie… rien de plus» comme le dit Kermeur au juge? Mais si l’on prend le temps d’écouter, de retracer l’enchaînement des événements depuis le début, le fait divers devient un...
L’obscure clarté de l’air, David Vann
écrit par Fleur Bournier
Fasciné par les tragédies grecques, en particulier par Médée, David Vann en propose une réécriture déroutante, interrogeant la figure du monstre mythique en la rapportant à une question de point de vue. Médée tapageuse, outrancière, et bien sûr criminelle, mais avant tout femme, aspirant de toutes ses forces à se libérer des différents jougs qui pèsent sur elle. David Vann a voulu conclure un ensemble de romans tragiques, centrés sur les liens familiaux ou sociaux, par L’obscure clarté de l’air qui en constitue l’acmé. Ce récit est bien le plus sombre et le plus troublant de son œuvre. En adoptant le point de vue de Médée, l’auteur nous fait sentir toute la complexité de ce personnage dont l’Histoire n’a retenu que le caractère monstrueux : une mère tuant ses propres enfants par dépit amoureux. L’écriture, heurtée et inspirée, épouse la violence du mythe et le chant de l’aède : « Le sillage de l’eau derrière la poupe, luminescent. S’enroulant de chaque côté, incurvé puis tourbillonnant en remous miniatures remplis d’étoiles. Pas de lune, pas de torches mais la mer qui génère sa propre lumière, les cieux submergés et projetés et brûlant sans cesse ». La phrase, à l’image de la mer sur laquelle vogue l’Argos, se fragmente et se relance dans un même mouvement, un même roulement. David Vann excelle à raconter le périple maritime, le dur labeur des Minyens à la rame, la poésie qui imprègne un vieux navire fait de bois, de cordes et de voiles. Il puise pour cela dans son expérience de capitaine d’un navire égyptien datant d’il y a plus de 3500 ans, ayant pris part à une reconstitution historique pour le tournage d’un documentaire : « Le bois épais avec son extrémité de bronze et ses douzaines d’yeux percés par les cordages,...
Zero K, Don DeLillo
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Sujet d’époque au centre de plusieurs ouvrages de la rentrée littéraire, le transhumanisme est aussi le thème de départ de Zero K, dernier livre de Don DeLillo. Mais, pour le grand romancier américain, aborder le sujet des expérimentations contemporaines c’est aussi traiter de questions universelles dans un roman métaphysique. Bouleversant et magistral. L’histoire se situe au bout du monde, à Tcheliabinsk, près de la frontière kazakhe, dans un lieu souterrain nommé la Convergence qui tient à la fois de l’hôtel, de l’hospice et de l’installation d’art conceptuel. Tout y est blanc, vide, aseptisé. Jeffrey, le narrateur, retrouve là son père, le richissime et puissant Ross Lockhart qui lui a demandé de le rejoindre. Il souhaite la présence de son fils au moment du départ de sa compagne adorée, Artis. Souffrant de maladies invalidantes, celle-ci a choisi que son corps soit cryogénisé dans l’attente d’une renaissance future. Ross, bien que sexagénaire en excellente santé, est lui-même tenté de partir avec elle, pour faire partie de ces hérauts qui tracent la voie, pour «entrer dans une autre dimension. Puis revenir. Pour toujours.» Ni utopie ni science fiction, le livre de Don DeLillo évite et dépasse les clichés du roman d’anticipation. Sa phrase blanche, efficace et rythmée, évoque à merveille l’univers glacé de la Convergence. Sa narration nous entraîne, à travers l’histoire des trois protagonistes, dans une réflexion sur le temps, la mort et l’humain. Artis, qui a exercé la profession d’archéologue, s’apprête à reposer dans un sarcophage, au sein de ce laboratoire où biologistes, généticiens et neuro scientifiques élaborent une autre façon de vivre et de mourir: «Ils fabriquent le futur. Une nouvelle idée du futur. Différente des autres.» Face aux préparatifs de ce passage, Jeffrey se souvient de la mort de sa mère Madeline, la...
L’Avancée de la nuit, Jakuta Alikavazovic...
écrit par Fleur Bournier
Histoire d’amour, quête de soi, réflexion sociologique, L’avancée de la nuit est un récit saisissant où les êtres se cherchent et se perdent dans un incessant va et vient rythmé par une écriture toute en nuances. Dès la première page, le lecteur comprend que l’histoire d’amour qu’il s’apprête à lire ne connaîtra pas de fin heureuse : « Paul était avec Sylvia quand il apprit ce qu’il en était d’Amélia Dehr. […] Ce fut un coup de téléphone, elle était entre la vie et la mort et l’issue du point de vue de Paul était certaine, Amélia Dehr n’étant pas du genre à échouer dans ses entreprises ». Le récit, déroulé en trois temps, reconstruit ensuite l’histoire de Paul et Amélia, les amants maudits. A l’image de la structure narrative, l’écriture de Jakuta Alikavazovic n’a de cesse de revenir sur elle-même, de reprendre un mot pour l’infléchir légèrement. Une écriture qui se construit et se déconstruit, reflet de l’histoire d’amour narrée – ou peut-être est-ce le contraire ? Paul et Amélia donc. Deux jeunes gens qu’a priori tout oppose. Elle, riche héritière, solaire et intrépide, est au centre de tous les regards et au cœur de toutes les rumeurs : « Quand elle entre dans une pièce, quelqu’un sort en pleurant ». Lui, solitaire, discret, travaille dans l’hôtel où elle réside. Le premier regard, loin d’être amoureux, n’est pas sans rappeler la rencontre d’Aurélien et Bérénice1: « C’est ça, Amelia Dehr ? » s’étonne Paul face à des camarades médusés. La suite de leur histoire se joue sur la même partition, à contre-temps, « une valse d’évitement ». Leurs yeux ne se rencontrent pas, et c’est d’abord à travers un écran de surveillance que Paul regarde Amelia, cherchant à percer son mystère. Simple histoire d’amour respectant ou détricotant les topoï du genre ? Non, elle est...
L’Art de perdre, Alice Zeniter
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Entre la France et l’Algérie, c’est une histoire d’amour et de haine, d’attirance, de violence et surtout de silences. Une histoire omniprésente qui, à travers ses multiples acteurs, travaille souterrainement la société française et resurgit à la moindre occasion. A cette rentrée, parmi d’autres ouvrages, L’art de perdre d’Alice Zeniter, roman familial sur trois générations, fait entendre la mémoire occultée des harkis. Il y est question de guerre, d’immigration, d’intégration et surtout d’identité. Dans son livre de facture classique, l’auteure retrace en trois parties plus de soixante ans de l’histoire de l’Algérie, à travers les destins de trois personnages. Ali, le grand-père, Hamid, le fils aîné et Naïma, la petite-fille, incarnent respectivement trois figures de l’immigration. Forcé de quitter son village de Kabylie au moment de l’Indépendance, le paysan aisé, l’ancien combattant de Monte Cassino devient un ouvrier silencieux, un homme humilié. Son fils en révolte, pur produit de l’école républicaine, s’écarte de la tradition, découvre Paris dans l’après 68, épouse une Française et prend ses distances avec la famille. A la troisième génération, la petite-fille parisienne se penche sur ses origines et prend le bateau dans l’autre sens pour découvrir d’où elle vient, ou plutôt d’où viennent ses ancêtres. Du destin subi au destin assumé la route est longue et douloureuse. Un demi-siècle d’humiliation et de silence que vient rompre ce gros roman, fruit des recherches de l’auteure. Des champs d’oliviers de Kabylie à la cité HLM de Basse-Normandie, en passant par les camps de Rivesaltes et de Jonques, la narratrice reconstitue, comme en une nouvelle Enéide, l’épopée tragique de sa famille déracinée. A partir d’images éparses et de souvenirs décousus, «vignettes» de l’ancien temps, elle tisse un récit inscrit dans le contexte de l’Histoire. Elle part à la recherche du village perdu,...
Entre eux, Richard Ford
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Réunissant deux textes écrits à plus de trente ans de distance, Richard Ford érige un tombeau à la mémoire de ses parents. Avec pudeur et sincérité, il reconstitue l’histoire de ces deux personnes qui lui ont appris, simplement, à accepter la réalité telle qu’elle est. Eternel sujet que celui des parents, mais sujet difficile, relevant autant de l’autobiographie que de la fiction, surtout quand il s’agit de raconter, de reconstituer le temps d’avant sa naissance ou celui de sa petite enfance. Ce récit, forcément hypothétique et lacunaire, ne repose que sur quelques indices: bribes de souvenirs, rares photos. Il est parsemé de «peut-être, je crois que, j’ignore...», jalonné de questions sans réponses dont la principale est celle de la raison de sa venue au monde: pourquoi, au bout de quinze ans de vie commune, ce couple fusionnel a-t-il éprouvé le besoin d’avoir un enfant? Fils unique et tardif d’un couple formé à la fin des années vingt, le petit Richard voit le jour en 1944. Pendant plus de dix ans, Parker et Edna, ses parents, ont mené d’hôtel en hôtel une vie itinérante, heureuse et insouciante, sillonnant en voiture les sept Etats du Sud que couvrait son père, représentant en amidon. A la naissance de leur enfant, leur vie s’adapte, simplement: ils prennent un appartement à Jackson, Mississippi. Edna devient femme au foyer; Parker rejoint sa famille le vendredi soir, attendu et fêté par sa femme et son fils: «Il était bel et bien une présence, sinon un père présent.» La vie s’assombrit avec la première crise cardiaque de son père puis reprend son cours pendant douze ans, jusqu’à son décès en 1960. Le texte consacré à sa mère évoque alors les années de veuvage, la relation de Richard adulte avec Edna jusqu’à sa...
Quand sort la recluse, Fred Vargas
écrit par Fleur Bournier
Où l’on retrouve le flegmatique commissaire Adamsberg, perdu et errant dans ses brumes, qui s’engage dans une enquête incertaine alors que souffle un vent de rébellion au commissariat du 13ème arrondissement de Paris. Saveur des mots, chemins détournés, héros meurtris, intrigue en poupées russes, le nouveau Fred Vargas comble les attentes de ses lecteurs. Ouvrir le nouveau Fred Vargas, c’est retrouver un univers familier qui happe le lecteur et ne le lâche plus jusqu’à la dernière page, quand « toutes les piqûres, morsures, blessures [auront] été grattées, jusqu’au sang. » C’est retrouver des personnages atypiques, qui restent avant tout pleinement humains. C’est retrouver une conception singulière de l’intrigue de roman policier. L’auteure préfère d’ailleurs le néologisme « rompol » pour parler de ses romans qui se démarquent du genre. Sa formation d’archéologue infléchit sa construction du récit : les enquêtes procèdent de la fouille, chaque indice mis à jour fait partie d’un puzzle à reconstruire avec patience. Chez Vargas, pas de scène de crime sanguinolente, pas de courses poursuites effrénées arme au poing, mais des enquêtes incertaines, qui se résolvent grâce aux aptitudes quelque peu extraordinaires de chacun des personnages : mémoire photographique, savoir encyclopédique, intuitions fines, génie de l’informatique, pour n’en citer que quelques-unes. Lorsque s’ouvre le roman, le flegmatique commissaire Adamsberg a trouvé refuge dans les brumes islandaises. Il est rapidement contraint d’abandonner cet exil plus tôt qu’il ne le souhaiterait et de rentrer à Paris. Comme souvent dans les romans de Vargas, l’affaire qui le rappelle ainsi à la réalité, résolue dès les premiers chapitres, n’est que prétexte à introduire l’enquête principale qui oppose notre commissaire à son second le plus fidèle, Danglard. En effet, l’orage gronde au commissariat du 13ème arrondissement, la dissension autour d’Adamsberg, déjà amorcée dans le volume précédent, Temps glaciaires, reprend de plus...
Quelques jours avec Tomas Kusar, A.Choplin
écrit par Marie-Odile Sauvajon
De livre en livre Antoine Choplin poursuit son exploration des rapports entre engagement et création et donne la parole aux gens simples. Dans Quelques jours avec Tomas Kusar, il évoque dans la Tchécoslovaquie communiste la rencontre d’un jeune garde-barrière avec l’écrivain dissident Václav Havel. Une belle histoire d’amitié, de courage et d’humanité. Quel personnage plus approprié en effet que celui de Václav Havel, écrivain, homme de théâtre, militant des droits de l’homme et premier président de la république tchèque pour poser les questions de l’art et de l’engagement? Mais, comme l’indique le titre, le personnage principal du roman n’est pas Václav Havel mais Tomas Kusar, le cheminot taiseux de Trustov, «un petit gars valable», amoureux de la forêt, des oiseaux et de la jolie Lenka. Un homme simple que rien ne destinait à se retrouver un jour au balcon du Château de Prague aux côtés du président. Tout commence par une brève rencontre entre le dramaturge pragois et le garde-barrière, lors d’une représentation interrompue de la troupe de la Balustrade, à l’occasion du bal des cheminots. Un verre de vodka, une poignée de mains et quelques propos échangés. Cinq ans plus tard, Tomas reconnaît Václav devenu employé de brasserie; une amitié naît peu à peu au cours de soirées au café entre verres de bière et parties d’échecs. C’est ainsi que le jeune homme va progressivement, insensiblement entrer en dissidence, cacher dans un coin de son atelier des samizdats, poster des exemplaires de la Charte des droits de l’homme, au point de perdre son travail et son logement. Accueilli par Václav et Olga, il vit alors dans la grange de Hradecek à côté de leur maison, partageant leur intimité et leurs activités clandestines, concert de rock, copies manuscrites des pièces interdites, pétition pour la...
Mémoire de fille, Annie Ernaux
écrit par Marie Fernandez
Avec son dernier récit, Annie Ernaux poursuit son opiniâtre travail d’écriture sur ses « je » passés, incertains, dont elle veut témoigner avant que tout soit emporté. Mémoire de fille part à la rencontre de la jeune fille de l’été 58, personnage opaque d’un été tissé de désir et de honte, figure inexplicable d’une amère humiliation. Cinquante ans plus tard, l’écrivaine est le « je » qui se retourne sur ce « elle » énigmatique, pour se comprendre, se relier, mais aussi, comme toujours, pour saisir la réalité sociale, familiale, qui a propulsé ce corps de femme dans le piège de l’été 58. La mémoire s’enclenche sur le souvenir de cette jeune fille débarquée le 14 août à S. dans l’Orne ; engagée comme monitrice, elle se déleste avec plaisir de sa mère qui a tenu coûte que coûte à l’accompagner. Qui est-elle? Les images ne manquent pas, ni de ce jour d’arrivée ni des semaines passées ensuite à la colonie. La mémoire, en « folle accessoiriste« , ramène volontiers la vision des vêtements portés à l’époque, des chambres occupées, des savons utilisés. « Je la vois, |mais] je ne l’entends pas ». L’écriture, précise, juste, s’emploie à retrouver le langage intérieur de ce « moi » passé. Dans cette entreprise de reconstitution, les pièces à conviction sont maigres : une correspondance avec une amie et un cahier rouge dans lequel elle consignait des citations d’écrivains. Ça et là, elle pioche des éléments du puzzle de ce discours intime disparu. Pour compléter ce texte à trous, Annie Ernaux refait le parcours de son adolescence et cherche à retrouver l’état précis de cette « pouliche échappée de l’enclos », chez laquelle trois jours de liberté suffiront à tout faire voler en éclat. « Elle attend de vivre une histoire d’amour » : ce bref portrait psychologique ne saurait suffire à l’enquêteuse au long cours, qui, inlassablement, tresse les fils...
Un paquebot dans les arbres, Valentine Goby
écrit par Marie-Anna Gauthier
Après l’encensé Kinderzimmer, Valentine Goby déconstruit le mythe des Trente Glorieuses à travers le destin de la famille Blanc, heurtée de plein fouet par la maladie. Un Paquebot dans les arbres est un très beau roman, porté par une héroïne solaire et un style remarquable. Ce paquebot blanc niché au cœur des arbres, c’est le sanatorium d’Aincourt, immense ensemble architectural construit en 1931, dont la majesté fait la fierté de toute la région. Mathilde, jeune fille à peine sortie de l’enfance, s’y rend chaque samedi pour voir ses parents atteints de tuberculose. Nous sommes au milieu des années 50, époque bénie des Trente Glorieuses, âge d’or de l’Après-Guerre, « temps miraculeux de la prospérité, de la Sécurité Sociale et des antibiotiques ». Le drame vécu par la famille Blanc semble anachronique, une histoire de maladie et de misère au temps du miracle économique. Avant la chute, les Blanc ont été les cafetiers de la Roche-Guyon, bourgade de la région parisienne. Le Balto est alors le centre névralgique du village, on y prépare la retraite aux flambeaux, on y sert les apéros de Pâques ou du 1er Mai, on y boit un verre à la sortie de l’église, on y trouve l’unique cabine téléphonique. Paul Blanc fait figure de patriarche bienveillant : il accueille les confidences, prête sans traites, oublie les dettes, ferme les yeux sur les vols : « Ma caille, c’est qu’ils en ont besoin ! » Le samedi, c’est soir de bal, tous les regards sont tournés vers lui, petit homme à l’harmonica qui fait danser les filles et les garçons. Mais la maladie passe par là, et avec elle, vient la dégringolade. Totalement imprévoyant, non éligible à la Sécurité Sociale réservée aux salariés, le couple bascule rapidement dans la spirale de la pauvreté : dettes, huissier, saisie, scellés, assistante...
Lettres à Anne, François Mitterrand
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Et si Lettres à Anne de François Mitterrand était LE livre de l’année 2016? Mille deux cent dix-huit lettres écrites à la femme aimée pendant plus de trente années! Roman d’amour et roman épistolaire bien sûr, mais aussi autobiographie, essai politique et même œuvre poétique, jouant de tous les styles, longs épanchements lyriques, brèves factuelles, portraits caustiques, poèmes en prose… Une œuvre totale et peut-être la dernière correspondance amoureuse. On est subjugué, submergé par l’intensité de cette passion sans cesse réaffirmée, comme Mitterrand le remarque lui-même : « Et je suis là, à te récrire pour la centième fois, la même lettre ». Mais qu’est-ce que l’amour sinon le ressassement ? La répétition incessante du nom de l’aimée comme une incantation : « Tu t’appelles Anne et je t’aime » ? La déclinaison du verbe aimer, sous une forme simple : « Tu es ma forêt dont j’aime chaque arbre » ou plus alambiquée : « Tu es mon bouquet de fleurs claires. Bouche en forme d’iris, rire au chrysanthème d’or simple, gravité de la tulipe noire, ô mon front de lilas, ô mon corps de varech, mon amour à l’odeur de violette et de mer » ? Lettres à Anne, c’est l’histoire d’un homme et d’une femme et c’est aussi une page de l’histoire de France dans ces lignes qui ressuscitent les années 60 et 70. François Mitterrand appelle le 106 à Château-Chinon, Littré 10-77 à Paris mais comme « le téléphone reste un instrument du Moyen-Age » il a aussi recours au courrier et aux télégrammes ; il roule en DS 21, surnommée « la pantoufle », en 2 CV ou en GS, atterrit en Viscount à Orly, prend le Mistral pour descendre dans le Sud, le Bourbonnais pour aller de Nevers à Clermont-Ferrand ; les filles portent les cheveux « en catogan », en Amérique il découvre les premiers « hippies » et, chroniqueur...
Illska, Eirikur Örn Norddhal
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman traduit en français du jeune romancier islandais Eirikur Örn Norddhal, Illska est un récit étrange, déroutant, décapant, roman à la fois historique et contemporain, mené de main de maître. Le point de départ du roman est l’histoire d’amour d’un couple d’étudiants, Agnes et Omar, qui se rencontrent à Reykjavik par une nuit glaciale de 2009. Au cours de ses interviews pour son mémoire sur le racisme populiste en Islande, Agnes fait ensuite la connaissance d’Arnor, néo-nazi qui devient son amant. Un enfant naît – de qui est-il le fils?- le couple se défait, Omar incendie leur maison et part à travers l’Europe. Encore un roman islandais ! Mais cette fois une Islande loin des clichés, sans volcan ni geyser, sans bélier ni macareux, une Islande contemporaine, mondialisée, aseptisée : « En fait, l’Islande n’est rien d’autre que le Danemark. Rien de plus que la béarnaise. Fabriquée industriellement et conditionnée dans des pots en plastique. » On s’y nourrit d’hamburgers-frites et de pizzas, seules les vieilles grands-mères à la campagne préparent encore « de l’aiglefin et des pommes de terre, le tout arrosé de graisse de mouton fondue » ; les banques sont en faillite, on manifeste en lançant des œufs et tapant sur les casseroles; on rencontre des Lituaniens, des Polonais, des caissières de supermarchés thaïlandaises et les mouvements d’extrême-droite se développent. Grâce à un va-et-vient constant entre passé et présent, l’histoire individuelle et familiale des trois jeunes gens s’inscrit dans l’Histoire collective de l’Europe au XX° siècle; en effet, les parents d’Agnes sont originaires de la petite ville de Jurbarkas en Lituanie où la population juive fut massacrée pendant la seconde guerre mondiale et le souvenir de l’Holocauste hante la mémoire de l’héroïne. Au cœur du roman, la question de l’identité : qu’est-ce qu’être Islandais(e) quand on est...
Giboulées de soleil, Lenka Hornakova-Civade
écrit par Elodie Roca
Lenka Hornakova-Civade, originaire de Moravie, petite province de République Tchèque, signe un premier roman d’une beauté crue sur son pays d’origine, « dans la langue de [son] pays d’adoption ». Comme elle le précise dans sa postface : « Je ne pouvais exprimer qu’en français ce qui reste indicible dans ma langue maternelle ». Une très belle réussite couronnée par le prix Renaudot des lycéens 2016. Tout, dans ce roman, dit l’expatriation : c’est une histoire de femmes, dont les pères sont absents, une histoire de bâtardes héréditaires, qui se transmettent cette fatalité de génération en génération, pour former un clan matriarcal marginal et fort. Des femmes sans père et sans patrie, contraintes de se déraciner sans cesse pour fuir les hommes et l’Histoire, qui les pourchassent également. Il y a d’abord Marie, sage-femme autodidacte, belle et raffinée, qui s’est formée auprès d’un gynécologue juif de Vienne mais qui, pour survivre, arrache sa fille à la ville, s’entoure de silence et devient une rude paysanne de la campagne morave. On découvre peu à peu son histoire à travers le récit de Magdalena, sa fille, la première bâtarde. Elle-même devient mère hors du mariage et, alors que le pays bascule dans le communisme, elle donne naissance à Libuse. On perd alors la voix de Magdalena pour écouter le récit de sa fille qui grandit sous le communisme le plus strict. En 1968 pourtant, quelque chose a changé, l’air semble plus léger, c’est indéfinissable. Un vent léger a soufflé de Prague jusque dans le petit village. De ce printemps naît Eva, fille de Libuse, petite-fille de Magdalena, arrière-petite-fille de Marie. La dernière petite bâtarde prend en charge l’ultime récit : elle découvre, au contact d’une mystérieuse professeure de français, les parts les plus sombres de son histoire familiale et met un terme...
Le Beau-Fils, Emmanuel Bove
écrit par Marie-Odile Sauvajon
La réédition de son roman Le Beau-fils paru en 1934 est l’occasion de redécouvrir Emmanuel Bove, auteur discret et grand romancier de l’entre-deux-guerres. Un classique méconnu. C’est l’histoire d’un jeune homme sans histoire, Jean-Noël, un déclassé. Enfant illégitime, il est élevé après la mort de son père par l’épouse de celui-ci, Annie Villemur de Falais qui appartient à la grande bourgeoisie. Marqué par sa bâtardise et la modestie de son origine, il éprouve pour sa belle-mère une admiration sans borne. Ce qui le fascine en elle, c’est autant son élégance, son assurance, sa détermination (tout ce qu’il n’est pas) que le prestige de la famille Villemur, l’appartement luxueux avenue de Malakoff et l’impression de sécurité qui en émane. Car Jean-Noël, comme son père, est un homme indécis, indolent, velléitaire. Incapable de prendre une décision, il se laisse porter par les événements : « Ce n’était pas lui qui avait fait sa vie, mais celle-ci qui l’avait fait. » Sur un coup de tête, il devance l’appel et s’engage en 17, refuse d’entrer dans le monde du travail au lendemain de la guerre, commence des études de droit sans les achever, rencontre une jeune fille et se trouve contraint de l’épouser quand celle-ci est enceinte. Il la quitte quelques années plus tard pour vivre avec Laure Mourier, jeune femme distinguée séparée de son mari ; grâce aux relations de cette dernière, il entre comme clerc chez un notaire. Toujours insatisfait et aspirant à une autre vie, il épouse Odile Wursel, jeune fille fortunée rencontrée par les Villemur, après avoir, non sans difficulté, convaincu sa femme de divorcer. Mariage d’intérêt sans véritable amour – mais, comme le lui demande sa fiancée : « Etes-vous seulement capable d’aimer ? » – cette nouvelle union se termine elle aussi par une séparation. Harcelé par sa mère...
Chanson douce, Leïla Slimani
écrit par Marie-Anna Gauthier
L’infanticide n’est pas le sujet de Chanson douce. La mort des deux enfants est évacuée dès le premier chapitre. Impossible d’en faire l’objet d’un suspense malsain et racoleur. Le prix Goncourt 2016 est bien plus ambitieux : il allie de façon très subtile art du portrait psychologique et réflexion sociale. Chanson douce est un roman social, au sens balzacien du terme. Il explore la société dans ses franges, met le nez dans l’univers inconnu de ces nounous souvent venues d’ailleurs, ces invisibles, ces oubliées, déjà mères dans leur pays, réunies par origine près des bacs à sable. Leila Slimani évoque le monde à l’envers de ces femmes qui « bossent pour qu’on puisse bosser ». C’est l’histoire éminemment moderne d’une lutte des classes feutrée, confinée entre les quatre murs d’un appartement parisien, et qui s’incarne sous les traits de Louise, la nounou, et de ses employeurs, Paul et Myriam. Comment vit-on l’émergence de la mixité sociale dans un foyer de trentenaires citadins ? Comment traduire la complexité d’une relation par nature marchande, mais basée sur l’affectif? Y a t-il lien plus ambigu ? Tout commence par un coup de foudre : « Paul et Myriam sont séduits par Louise, par ses traits lisses, son sourire franc, ses lèvres qui ne tremblent pas. Elle semble imperturbable. Elle a le regard d’une femme qui peut tout entendre et tout pardonner. Son visage est comme une mer paisible, dont personne ne pourrait soupçonner les abysses. » Louise est la perfection, elle est « une fée » qui transforme les petites filles caractérielles en êtres dociles, les appartements brouillons en parfaits intérieurs bourgeois. Elle devance tous les désirs, coud les boutons des vestes condamnées au fond des placards, lave les rideaux jaunis par le tabac, note dans un petit carnet les phrases de la maîtresse, trie les papiers....
Le dernier Voyage de Soutine, Ralph Dutli
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Ralph Dutli convoque à travers ses trois dernières journées toute l’existence tourmentée du peintre Chaïm Soutine. Voyage halluciné à travers la vie et l’oeuvre d’un artiste maudit. Violent et passionnant. Août 1943. Alors qu’il souffre d’un ulcère à l’estomac au dernier degré, Soutine est transporté de Chinon à Paris pour y être opéré. Au cours de ce transfert interminable et clandestin, dans un corbillard et hors des routes principales pour éviter les points de contrôle dans la France occupée, il revoit tout : l’enfance misérable dans le ghetto de Smilovitchi, l’académie des Beaux-Arts de Vilna, l’arrivée à Paris en 1913, les années de vache enragée à Montparnasse, l’amitié avec Modigliani, les amours avec Gerda Groth puis avec Marie-Berthe (ex-femme de Max Ernst), la rencontre miraculeuse avec le riche collectionneur Julian Barnes en 1923, les séjours à Cagnes et à Céret, la guerre et les caches successives à Paris et à Champigny. Et tout se confond dans le délire comateux de la morphine d’où n’émergent, à travers un constant aller-retour entre passé et présent, que deux couleurs : le rouge et le blanc. Rouge comme la douleur qui le torture, comme les pogroms de la Russie natale et les carcasses de bœuf ensanglantées qu’il ramène de l’abattoir pour les peindre à la manière de Rembrandt. Blanc comme le lait qui apaise l’ulcère, comme le vêtement du petit pâtissier de Céret et la robe de la première communiante, comme les médecins de la clinique, le lit mortuaire et le paradis de l’oubli. L’histoire mouvementée et tragique de Soutine se confond avec celle de la Ville Lumière, « la ville de ses rêves », « la capitale mondiale de la peinture », Paris où se pressent les artistes venus de toute l’Europe en ce début de XX° siècle. A son arrivée, le peintre...
W ou le souvenir d’enfance, George Perec...
écrit par Elodie Roca
Comment écrire son autobiographie quand on ne possède aucun souvenir d’enfance ? Comment parler de ses proches quand ils ont irrémédiablement été éloignés, engloutis dans le chaos de l’histoire ? Comment même oser poser des mots sur leur tragédie alors qu’ils sont tous morts et qu’on reste seul vivant ? Tiraillé entre l’impossibilité et l’implacable nécessité d’écrire, Georges Perec trouve dans la sophistication formelle de son récit une issue à ses dilemmes. Avec W ou le souvenir d’enfance, le carcan des contraintes oulipiennes prend alors tout son sens. Pour nous éviter la déroute, la quatrième de couverture livre une première clé de lecture : « Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait presque sembler qu’ils n’ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister seul, comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu’ils jettent l’un sur l’autre, pouvait se révéler ce qui n’est jamais tout à fait dit dans l’un, jamais tout à fait dit dans l’autre, mais seulement dans leur fragile intersection. » Si l’on veut bien passer outre l’ironie du « simplement », on peut alors commencer à démêler l’inextricable canevas. Le récit en italique, dans les chapitres impairs, retrace, à la première personne, l’histoire d’un orphelin, qui a déserté l’armée française pour trouver refuge en Allemagne sous le pseudonyme de Gaspard Winckler. Les phrases grandiloquentes aux accents épiques nous plongent au cœur d’un intrépide roman d’aventure qui entraîne le narrateur à l’autre bout du monde, sur les traces du jeune garçon disparu dont il a pris le nom, à son insu. On croit d’abord pouvoir s’abandonner sans vergogne à ce récit de fiction débridé mais d’inexplicables manques empêchent le lecteur de se laisser aller sans réserve. Les noms de lieu sont...
Les Petites Chaises rouges, Edna O’Brien...
écrit par Marie-Anna Gauthier
Après la publication de ses Mémoires, parus en France il y a quatre ans sous le titre Fille de la Campagne, Edna O’Brien revient au roman avec Les Petites Chaises Rouges, une magnifique histoire de honte et de rédemption. Le roman commence comme un conte maléfique. Un inconnu, vêtu d’un manteau noir et de gants blancs, observe avec fascination le lit d’une rivière tourmentée. C’est un soir d’hiver, « dans un trou perdu glacial qui passe pour une ville et qu’on appelle Cloonoila ». Le narrateur prête alors sa voix aux habitants pour réinterpréter cette apparition à l’aune de ses funestes conséquences: « Longtemps après, d’aucuns rapporteraient d’étranges événements ce même soir d’hiver ; les aboiements des chiens, comme s’il y avait du tonnerre, et le timbre du rossignol dont on n’avait jamais entendu si à l’ouest le chant et les gazouillis. L’enfant d’une famille de Gitans, qui habitait une caravane au bord de la mer, jura avoir vu le Pooka s’approcher d’elle par la fenêtre, montrant du doigt une hachette ». Le lecteur, averti par un texte glaçant placé en exergue, connaît déjà l’identité de ce mage apparemment inoffensif: Vladimir Dragan, dit Vlad, poète autoproclamé, exilé, visionnaire, guérisseur, sexothérapeute, est recherché par toutes les polices. Il est accusé de génocide, nettoyage ethnique, massacres, tortures. Edna O’Brien s’inspire de la figure de Rodovan Karadzic : pendant sa cavale longue de douze ans, le sinistre chef politique des Serbes de Bosnie se dissimulait sous les traits d’un gourou de la vie alternative, le soi-disant Dr. Dragan Dabic, les cheveux ramassés en chignon, tenant la rubrique hebdomadaire « Méditation » dans un magazine lifestyle. Pourtant, Les Petites Chaises rouges n’a rien d’un vulgaire roman à clef qui tirerait son sujet vers le sensationnel. L’intrigue ne tourne pas autour de la révélation de l’identité de l’imposteur....