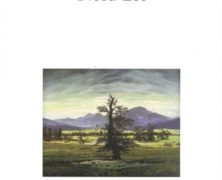Roman policier et métaphysique, L’Archipel d’une autre vie plonge le lecteur dans une traque haletante en plein cœur de la taïga. Un grand Makine. Telle une poupée russe, L’Archipel d’une autre vie enchâsse différents récits, différentes époques. Le roman s’ouvre sur un récit rétrospectif, qui, sans être autobiographique, offre un narrateur qui emprunte beaucoup à l’auteur. Orphelin né dans un camp de travail, le narrateur du récit-cadre est envoyé à quatorze ans en tant que géodésiste en Sibérie, dans la « petite localité de Tougour […] coin perdu de l’Extrême Orient ». Par goût de l’aventure plus que par réelle cupidité, il entame une traque dans la forêt sibérienne qui bientôt se retourne contre lui. Le chercheur d’or qu’il pensait détrousser n’en est pas un : que fait cet homme seul, bien équipé et alerte, dans la taïga ? Le jeune homme écoute alors, médusé, cet homme, Pavel Gartsev, lui raconter son histoire. En 1952, les Russes se préparent à la troisième guerre mondiale. Pour cela, ils envoient en Sibérie de jeunes réservistes : ce fut le destin de Pavel. Un jour, on lui donne la mission de se lancer, avec quatre autres hommes, à la poursuite d’un fugitif du goulag. La chasse à l’homme dans la taïga, écrite comme une intrigue policière, constitue le cœur du roman. L’écriture épouse le rythme sinueux de la traque : « Marcher » dans la taïga est une façon de parler. En réalité, on doit s’y mouvoir avec la souplesse d’un nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un passage s’épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces vagues de branches, de brande, de broussailles qui déferlent sur lui. » La narration est en effet à la fois haletante -puisqu’il s’agit d’une course-poursuite- et lente. Elle donne à observer la forêt primaire et le fugitif qu’elle abrite, mais aussi à connaître peu à peu les cinq hommes qui le poursuivent. Le capitaine Louskass, le commandant Boutov et le sous-lieutenant Ratinsky ont à cœur leur avancement et sont prêts à tout pour obtenir les faveurs du parti. Vassine, comme Pavel, est enrôlé dans cette affaire malgré lui ; il admire le fugitif et voudrait bien l’aider. Les deux hommes finissent par ressentir une communion avec celui qu’ils poursuivent. Ils voient en lui un semblable, un frère, et non cet ennemi du peuple qu’ils doivent traquer sans relâche et rapporter au camp vivant afin qu’il serve d’exemple. Sa frêle silhouette laisse deviner celle d’« un adolescent caché. Assez semblable, tout compte fait, à ce « pantin de chiffon » que je gardais en moi. Fiévreux symbole de notre volonté de vivre, d’aimer, d’être reconnu, d’être aimé… ». Le fugitif ne cesse de les surprendre : il leur échappe toujours. Lorsque les cinq poursuivants comprennent enfin à qui ils ont affaire, la traque prend une toute autre tournure et s’accélère. Le désir de la capture tourne à l’obsession et fait ressortir le pire chez ces hommes. La construction virtuose de L’Archipel d’une autre vie repose sur une série de rebondissements et retournements de situation, tenant le lecteur en haleine, d’une course-poursuite à l’autre. Les traqueurs d’un jour deviennent à leur tour traqués. Ainsi Pavel marche sur ses propres pas dans la taïga mais cette fois pour sauver sa peau : « dans ma course, je vivais ce qu’aurait éprouvé une bête blessée. J’étais presque nu sous mes haillons. Mon dos et mes épaules saignaient. Ma bouche, déchirée par les coups de Ratinsky, se crispait de douleur quand, me mettant à quatre pattes, je buvais l’eau des courants. La nuit, le froid me secouait, mais je n’allumais que de tout petits feux, pour ne pas me trahir » Ainsi le jeune narrateur croit traquer Pavel alors que c’est sur lui que l’étau se referme. A cette intrigue policière se lie, dès les premiers mots du roman, une réflexion métaphysique : « A cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à...
Lumière d’été, puis vient la nuit, Jón Kalman Stefánsson...
écrit par Fleur Bournier
Quel plaisir de retrouver la prose poétique et mélancolique de l’islandais Jón Kalman Stefánsson en cette rentrée littéraire où il fait bon s’évader. Lumière d’été, puis vient la nuit, paru en 2005 mais dont la traduction nous parvient seulement cette année, immerge le lecteur dans un petit village des fjords de l’ouest de l’Islande, s’attachant tour à tour à certains de ses habitants. Quotidiens ordinaires et monotones, mais aussi extraordinaires et poignants. Dès le titre, Lumière d’été, puis vient la nuit, la plume de Jón Kalman Stefánsson – et de son remarquable traducteur- fait tinter à notre oreille sa douce et mélancolique poésie, qui se poursuit dans le titre des chapitres : « L’univers et la robe de velours noir », ou encore « les larmes ont la forme d’une barque à rame ». Qui se déploie dans le roman : « Au printemps, il attire des oiseaux des tourbières joyeux et optimistes, ses rives regorgent de toutes sortes de coquillages, au loin, des milliers d’îles et d’écueils surgissent de l’eau comme une denture aléatoire – et le soir, le soleil répand son sang à la surface de l’océan, alors, nous méditons sur la mort. » Cette prose enchanteresse et mélodieuse accompagne un complet dépaysement. Nous voici dans un petit village islandais, partageant sa douce torpeur loin des fracas du monde. Le narrateur nous y accueille, à l’orée du roman, avant de commencer son récit, ou plutôt ses récits, puisque c’est de la vie de certains de ses habitants dont il va être question. Le nom du village reste tu car il importe peu, il est le miroir de tant d’autres. Le narrateur lui aussi tait son nom, il se pose en simple observateur, en conteur, et sa voix s’élève comme dans un prologue d’une tragédie antique : « nous vous parlerons du désir...
Un jour ce sera vide, Hugo Lindenberg
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Premier roman très abouti de Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide raconte, le temps d’un été au bord de la mer, les peurs, les émois et les secrets d’un enfant de dix ans. Délicat, subtil et touchant. En vacances en Normandie avec sa vieille grand-mère et sa tante obèse qu’il surnomme « la folle », le jeune narrateur rencontre Baptiste, un garçon de son âge qui le fascine. Il fait tout pour l’imiter, pour mériter son amitié et surtout pour être accueilli chez lui, dans cette famille parfaite, qui apparait si différente de la sienne sur la plage : « je distinguais le triangle impeccable que formaient ses parents et sa soeur. Plus loin, seule sur une chaise pliable, ma grand-mère ressemblait à un rocher.» L’enfant éprouve une immense tendresse pour sa grand-mère, présence rassurante : « Je m’imagine lionceau perdu dans la savane, sous la protection d’un vieux fauve. » Mais il ressent aussi de la honte, honte de ses robes à fleurs, de son accent polonais, et du bol de foie haché qu’elle offre à la mère de Baptiste : « J’aimais le foie haché comme j’adorais ma grand-mère : dans l’intimité du foyer. Offerts à la vue de tous, l’un et l’autre m’embarrassaient terriblement. » Tiraillé entre deux mondes, le jeune garçon tente d’adopter les codes d’un autre univers, de se faire accepter et de voler un peu de la présence maternelle qui lui manque. Peu à peu, on devine les secrets enfouis derrière les mensonges et les silences, les histoires passées qui hantent cet enfant solitaire et sensible. Un jour ce serait vide pourrait aussi avoir pour titre « Les Méduses ». Omniprésentes dans le livre, elles s’échouent sur la plage où les garçons les décortiquent d’un bâton avec cette innocente cruauté de l’enfance. Elles habitent, hantent le...
Nord-Est, Antoine Choplin
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Plaisir en cette rentrée littéraire de retrouver Antoine Choplin dans les jolies éditions de La fosse aux Ours. Nord-Est, son dernier roman, reprend les thèmes qui lui sont chers – la catastrophe, la place de l’Art, les rapports humains – à travers le récit d’une aventure intemporelle et universelle. Ils sont quatre : Garri, Emmet, Jamarr et Saul qui décident de quitter le camp pour essayer de gagner à pied « les longues et douces plaines du nord-est », comme une terre promise lointaine au-delà des montagnes. Rusla, qui reproduit les pétroglyphes gravés par les anciens et les sauve de l’oubli, se joint ensuite à eux; puis Tayna, rencontrée dans le premier village traversé. Ils étaient paysan, maçon, écrivain ou sage-femme. Chacun a son caractère – meneur, introverti, écervelé ou posé -, ses passions, ses secrets. Que s’est-il passé? Que fuient-ils? Que cherchent-ils? On l’ignore, comme on ignore toujours le lieu et l’époque. On sait seulement qu’il y a eu un « avant », avant les incendies qui ont tout ravagé; à présent la population est répartie dans des camps, ravitaillée par des cantiniers. Ils croisent un cheval blessé, un berger fou qui ne parle plus que par bribes de mots, traversent des villages en ruines. Ils avancent avec difficulté, sous le soleil ou dans la tempête, gravissent la montagne encordés, descendent les pierrées dans une quête sans cesse recommencée : « Tu commences par monter, longtemps. Et quand t’arrives en haut de ce qui te fermait l’horizon, tu vois une nouvelle montagne se dresser entre toi et l’horizon(…) et quand t’arrives en haut de cette deuxième montagne, t’en découvres encore une autre qui te barre encore les perspectives. Et, à la fin, l’horizon, le vrai, celui qui te tire le regard au lointain (…) c’est comme si tu...
Comédies françaises, Eric Reinhardt
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Comédies françaises, le dernier roman d’Eric Reinhardt, croise, ou plutôt superpose, plusieurs histoires. Au risque de paraître parfois didactique ou éclaté, il pose la question du poids du hasard dans nos vies. Foisonnant et richement documenté. Refusant tout suspens, Eric Reinhardt commence par la fin et dévoile à la première page le faire-part de décès de son héros, Dimitri Marguerite, mort accidentellement à l’âge de vingt-sept ans. Il enchaine ensuite sur le moment de sa rencontre à Madrid avec une belle inconnue, puis retrace le parcours de ce brillant élève, pur produit de l’élitisme républicain. Fils d’une directrice d’école maternelle communiste, il intègre le lycée Louis-le-Grand et la prépa scientifique, bifurque vers le théâtre, échoue au concours du conservatoire et fait un master à Sciences-Po Paris. A la suite de la rencontre d’un soir avec un riche industriel, il est embauché comme consultant en affaires publiques dans un cabinet réputé et le lecteur découvre avec lui « une activité aussi romanesque, aussi mystérieuse, aussi opaque et sulfureuse que le lobbying ». Il quitte ensuite ce premier emploi, devient journaliste à l’AFP tout en menant différents projets de roman. L’auteur suit aussi les aventures amoureuses, homosexuelles et hétérosexuelles, de son héros et surtout sa quête obsessionnelle de la jeune femme rencontrée à Madrid et revue par hasard à Paris. Dimitri incarne le malaise d’une certaine jeunesse : il s’ennuie, n’arrive pas à être en accord avec lui-même, cherche le grand amour tout en enchaînant les aventures, envisage d’écrire des romans, se laisse porter par le hasard des rencontres et préfère parfois le rêve à la réalité: « Je me sens de plus en plus attiré par le hors champ. Sortir du réel. Creuser. M’enfouir. ». C’est seulement au théâtre qu’il a trouvé la possibilité « d’assouvir ce besoin impérieux de sens, de vérité et de perfection dans l’agencement des données du monde sensible » Il y a plusieurs romans dans ce livre. Au sein des aventures de Dimitri Marguerite s’insèrent deux autres histoires, sujets des romans que le héros projette d’écrire et pour lesquels il accumule des notes sur ses carnets : la rencontre de Max Ernst et Jackson Pollock et le rôle d’Ambroise Roux dans le ratage de l’internet français. A cela s’ajoutent aussi de nombreuses digressions au cours desquelles le narrateur expose ses théories sur le théâtre, les rues piétonnes ou l’épilation féminine. On peut trouver le livre décousu, disparate, passant du classique roman d’apprentissage et de l’histoire d’amour au quasi documentaire. Mais l’auteur tisse des liens ténus qui relient entre elles ces histoires : l’histoire de l’art abstrait d’après-guerre comme celle d’internet montrent la prise d’influence des Etats-Unis au détriment de la France et de l’Europe, Ambroise Roux pratique un lobbying efficace comme tente de le faire Dimitri, et surtout tous deux sont de grands admirateurs des surréalistes. C’est en effet surtout la question du hasard cher aux surréalistes – « le hasard objectif, forme de manifestation de la nécessité » comme l’écrivait André Breton – qui est au centre du roman et lui donne son unité. Ce qui intéresse l’auteur ce sont les moments historiques et « les coïncidences pétrifiantes », ces jours où tout bascule dans un pays comme dans une vie : ce jour d’octobre 1973 où la France de Giscard, poussée par le puissant industriel Ambroise Roux, met fin aux recherches de Louis Pouzin sur les transmissions de données et choisit le minitel au détriment d’internet; ce jour de juin 1942 où Max Ernst enseigne la technique du dripping au jeune Jackson Pollock – ce qui va faire de New-York la nouvelle capitale de l’art-; ce jour où Dimitri retrouve par hasard la jeune femme de Madrid (comme Breton croise Nadja à Paris). « Il y a comme ça des moments inconnus – qui devraient être exhumés et marqués d’une pierre noire, pensait Dimitri. » Eric Reinhardt joue avec le lecteur, trompe ses attentes, l’étonne parfois. L’histoire de Louis Pouzin, plusieurs fois annoncée, amorcée, interrompue...